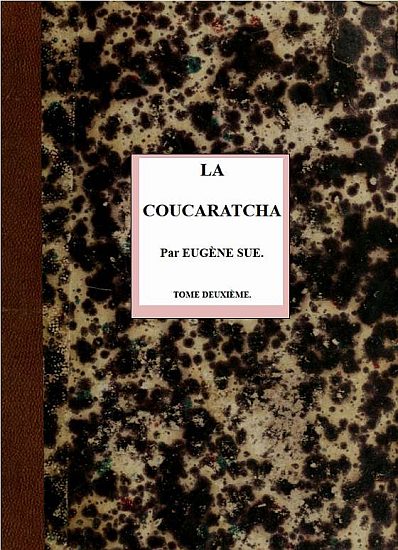
The Project Gutenberg EBook of La coucaratcha (II/III), by Eugène Sue This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: La coucaratcha (II/III) Author: Eugène Sue Release Date: March 1, 2012 [EBook #39024] Language: French Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LA COUCARATCHA (II/III) *** Produced by Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images available at The Internet Archive)
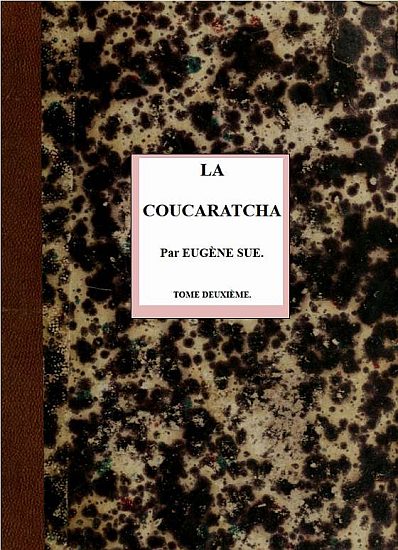
ŒUVRES COMPLÈTES
DE
EUGÈNE SUE.
![]()
LA COUCARATCHA.
| OUVRAGES DU MÊME AUTEUR. | |
|---|---|
| Le Juif errant | 10 vol. in-3. |
| Les Mystères de Paris | 10 vol. in-8. |
| Mathilde | 6 vol. in-8. |
| Deux Histoires | 2 vol. in-8. |
| Le marquis de Létorlère | 1 vol. in-8. |
| Deleytar | 2 vol. in-8. |
| Jean Cavalier | 4 vol. in-8. |
| Le Morne au Diable | 2 vol. in-8. |
| Thérèse Dunoyer | 2 vol. in-8. |
| Latréaumont | 3 vol. in 8. |
| La Vigie de Koat-Ven | 4 vol. in-8. |
| Paula-Monti | 2 vol. in-8. |
| Le Commandeur de Malte | 2 vol. in-8. |
| Plik et Plok | 2 vol. in-8. |
| Atar Gull | 2 vol. in-8. |
| Arthur | 4 vol. in-8. |
| La Coucaratcha | 3 vol. in-8. |
| La Salamandre | 2 vol. in-8. |
| Histoire de la Marine (gravures) | 4 vol. in-8. |
| Sceaux.—Impr. de E. Dépée. | |

| PARIS, | ||
| CHARLES GOSSELIN, Editeur de la Bibliothèque d'élite, 30, RUE JACOB. |
PÉTION, ÉDITEUR, Libraire-Commissionnaire, 11, RUE DU JARDINET. | |
| 1845 | ||
—Mais comme cette nouvelle volonté ne faisait pour ainsi dire que de naître, elle n'était pas encore assez forte pour vaincre l'autre, qui avait toute la force qu'une longue habitude peut donner. Cependant ces deux volontés, l'une ancienne et l'autre nouvelle, l'une charnelle et l'autre spirituelle, se combattaient dans mon cœur, et chacune le tirant de son côté, elles le mettaient en pièces.
Confessions de Saint-Augustin, LIV. VIII, ch. V.
.......Pendant une relâche que nous fîmes à Malte en 18.., les officiers du vaisseau anglais le Genôa voulurent recevoir à leur bord l'état-major de notre frégate.
A dîner, je me trouvais placé entre deux officiers supérieurs; mon voisin de gauche était un grand homme sec, à cheveux grisonnants, taciturne, peu buveur, et ne parlant pas un mot de français:—je lui versai à boire trois fois, et n'y pensai plus.—
Mon voisin de droite était un homme de trente ans au plus, d'une belle figure, brun, svelte, élégant, s'exprimant dans notre langue avec une merveilleuse facilité,—quoiqu'un accent presqu'imperceptible trahît son origine étrangère.—Il m'apprit qu'il était Danois, mais naturalisé Anglais.
Il fallait qu'une singulière attraction me portât vers lui, car avant le dîner nous ne nous connaissions pas du tout, et au pudding nous étions déjà fort liés;—enfin, plus tard, quand on enleva la nappe pour servir les fruits secs et les vins de France, nous n'avions, je crois, plus rien à nous apprendre sur notre passé, notre présent, je dirais presque notre avenir.
Suivant l'usage, l'intimité commença d'abord par un échange confidentiel d'horreurs et de calomnies sur les personnes de nos commandants respectifs, et par des remarques satiriques sur nos inférieurs; après quoi vint la relation impartiale des injustices et des passe-droits qu'on nous avait fait subir, des grades qu'on nous avait volés.—Puis, comme nous finîmes par maudire notre état, après nous être mutuellement prouvé qu'il n'en était pas au monde de plus détestable,—ce fut entre nous à la vie et à la mort.
D'après la coutume admise dans les repas que nous nous donnions avec les Anglais, on commençait par casser les pieds des verres à pattes, de façon qu'il était impossible de laisser son verre plein après avoir salué du geste à chacun des innombrables toasts que l'on portait à l'union des deux pavillons.—Or comme les toasts se succédaient sans interruption toutes les cinq minutes, et qu'il y avait à peu près trois heures que nous étions à table;—comme après les vins on avait servi le punch, et qu'en fumant nous avions prodigieusement bu de ce punch, nous finîmes par être, sinon gris, au moins fort communicatifs et disposés les uns envers les autres à une confiance sans bornes.
Mon nouvel ami surtout qui, selon ce qu'il m'apprit, ne buvait ordinairement que de l'eau, avait voulu faire ce jour-là, en mon honneur, une exception à son régime.—Malgré les paternelles remontrances du vieil officier de gauche qui lui répétait sans cesse en anglais:—Ne buvez pas, voilà deux ans que nous sommes embarqués ensemble, vous n'avez pas avalé une goutte de grog.—Ne buvez pas, vous vous tuerez, n'en ayant pas l'habitude.
Mais mon intime improvisé, que je nommerai Wolf, ne tenait pas compte de ces exhortations;—il paraissait se trouver fort bien de l'effet du punch, sa figure d'abord pâle, s'anima, se rosa peu à peu, ses yeux brillèrent, sa conversation devint plus vive, plus énergique, plus intime, enfin.—Cet homme que j'aurais d'abord cru froid, s'exalta peu à peu, et je trouvai chez lui les signes de cette impétuosité concentrée des gens du Nord, si différente de la vivacité molle et éphémère des méridionaux.
Le punch flambait toujours et nous faisions un furieux tapage à bord du Genôa, on parlait bruyamment, on disputait, on criait, et le thême de cette discussion orageuse était autant que je puis m'en souvenir, l'amour et les sacrifices qu'il imposait parfois.
C'était une question bien amusante à entendre discuter par une vingtaine de marins fort débauchés qui d'ordinaire s'occupaient très-peu de la théorie de ce tendre délassement, mais comme l'importance que l'on attache à une discussion est toujours en raison inverse des connaissances que l'on peut y déployer,—on échangeait de pitoyables raisons,—pour et contre—avec un acharnement singulier.
—«Bah, dit Wolf, en posant son verre sur la table avec tant de force qu'il le brisa:—Ils sont stupides, ils parlent de cela comme les aveugles des couleurs... Venez-vous faire un tour de dunette?»
—Volontiers, répondis-je... car il fait horriblement chaud ici...
Nous montâmes, l'air était tiède, le temps lourd, et les pavillons des navires pendaient collés le long des mâts.
—«Tenez, me dit mon ami Wolf, en m'arrêtant par le bras et fixant sur moi ses yeux étincelants,—nous nous entendons si bien tous deux qu'il faut que je vous dise une histoire qui m'est arrivée; mais ceci est entre nous au moins, ajouta-t-il avec un regard presque féroce, que le bon Dieu m'étrangle si je sais pourquoi je vous fais cette confidence, si c'est le punch, ou l'air, ou la fatalité, ou le diable qui m'y force, mais je ne puis m'empêcher de vous raconter cela, et pourtant, quand vous m'aurez entendu, je suis sûr que vous me regarderez comme le dernier des misérables,—mais c'est égal encore une fois, je ne puis m'en empêcher...—
Il y avait dans l'expression de la figure, dans l'accent de la voix de mon ami Wolf, un tel caractère de vérité que je compris parfaitement cette influence de l'ivresse qui vous pousse à l'indiscrétion, influence fatale, dont on se rend compte, que l'on maudit, mais qu'on n'a pas la force de combattre, s'agirait-il d'un secret sacré.
Aussi dis-je prudemment à mon ami, j'aimerais mieux attendre à demain, nous serions plus calmes et alors...
—«Pardieu, je crois bien que nous serions plus calmes, mais alors je ne vous dirais plus mon histoire, et il faut que je vous la raconte... Pourtant voyez-vous il est possible que demain quand je penserai à la folie que je fais étant gris, il est possible que je vous propose de nous brûler la cervelle à pair ou non, afin que mon secret soit éteint par votre mort, ou rendu sans importance par la mienne... Je sais bien que vous allez me dire que c'est ridicule, mon cher, mais que voulez-vous y faire, c'est comme cela...»
Ce diable de Wolf avait tant de naïveté et d'abandon dans ses manières que je n'eus pas la force de lui en vouloir, moi, et encore moins la pensée de reculer devant une confidence dont les résultats promettaient autant...—Je me disposai donc à écouter, nous nous assîmes sur le couronnement et il commença après m'avoir affectueusement serré la main.
«Il y a environ deux ans de cela me dit Wolf,—c'était pendant la guerre, je commandais une goëlette dans la Méditerranée, ma mission se bornait à convoyer de temps à autre des bâtiments marchands,—Je me trouvais alors mouillé à Porto Venere, petit port d'Italie entre le golfe de Gênes et celui d'Especia, près des îles Palmeries.—
«J'avais la plus entière confiance dans mon second, et j'allais fréquemment à terre, quoique la ville de Porto Venere fut horriblement triste, mais le fait est que j'y avais fait la connaissance d'une fort jolie demoiselle dont le père était capitaine de port.
«Je ne sais comment diable elle était venue en Italie, mais elle était Péruvienne et s'appelait Pépa.
«Figurez-vous,—mon cher,—dix-huit ans,—un teint orangé,—des lèvres rouges comme du corail, des dents bien blanches, une taille... à tenir là dedans,—une gorge un peu forte, et des hanches... ah! des hanches comme une Andalouse,—et puis des yeux... vous savez, toujours fermés à demi, comme ceux de quelqu'un qui sommeille... et puis une forêt de grands cheveux noirs et épais... et puis encore des sourcils à l'avenant.
«Aussi, mon ami, si vous l'aviez vue avec un peignoir serré seulement autour de sa taille par une ceinture, nu-tête, et se balançant au frais dans son hamac de jonc... Vrai Dieu... c'était à en devenir fou.—Aussi j'en devins fou.—
«Sa mère était morte, et son père était un vieux brave homme, assez butor; je me trouvais avec lui en relation continuelle de service, je m'arrangeai pour lui être utile, il m'en sut gré, m'ouvrit sa maison, c'est tout ce que je voulais.—
«C'était beaucoup;—mais Pépa avait une vertu fort tenace, et des principes religieux, profonds et arrêtés; pour tâcher de me mêler à leur influence,—je les partageai.—
«Je m'agenouillai donc avec elle pour invoquer Dieu, et vous ne sauriez croire combien je trouvais de charme dans ces prières, car je lui avais dit une fois:—
«Pépa, il y a ce me semble une pensée d'égoïsme à prier pour soi... si vous vouliez, vous prieriez pour moi, Pépa? et alors moi, je prierais pour vous?...—
«La pauvre enfant accepta l'échange, et comme elle me demandait un jour la forme de l'invocation que je faisais pour elle, je lui dis franchement, qu'elle consistait en ceci:—mon Dieu, faites donc qu'elle m'aime, car je l'aime bien.—
«Elle me bouda, rougit, et finit par me dire, qu'elle au contraire ne demandait ardemment qu'une chose au ciel,—c'était de ne pas m'aimer.—
«Vous jugez que cet aveu me rendit plus amoureux que jamais, je ne la quittais pas, je l'obsédais, et enfin je parvins à la convaincre de ma passion, qui entre nous, je l'avoue, était aussi violente qu'on puisse l'imaginer,—jusque là voyez-vous, je n'avais eu que des filles; aussi j'aimais pour la première fois, j'aimais avec délire, parce qu'il y avait un cœur et un noble cœur, chez cette femme-là.—Savez-vous qu'un jour elle me dit,—je suis bien contente que vous soyez marié, Wolf, comme je suis pauvre,—au moins vous ne penserez pas que je vous aime pour vous épouser,—que je vous aime parce que vous êtes riche.»
—Vous êtes donc marié? dis-je à mon ami Wolf.
—Pas du tout me répondit-il, mais j'avais dit cela pour voir au juste quelle espèce d'amour on me portait, car j'aurais toujours craint, sans cette précaution, d'être aimé comme mari futur:—Ce qui entre nous est fort abject.
Je continue:—«Un jour, le père de Pépa ayant voulu aller lui-même visiter en mer un navire suspect, il le trouva rempli de malades qu'on n'avait pas d'abord déclarés, et fut obligé de partager avec eux une quarantaine de huit jours; veillé, gardé à vue par les gardes sanitaires.
«Vous pensez ma joie; Pépa restait seule avec une vieille gouvernante.—Après avoir consolé le père en me tenant à une honnête distance de son navire, je me rendis à terre pour rassurer la fille et lui demander... ce que je lui demandais toujours;—car elle ne m'avait encore rien accordé, craignant, disait-elle, qu'une fois mes désirs satisfaits je ne me lasse d'elle,... et qu'au bout de quelque temps la satiété ne vînt me glacer; car vois-tu, me disait-elle naïvement:—je t'aime pour moi, et non pour toi.... et j'éprouve un plaisir inouï à être désirée.
«Pendant les six premiers jours de la quarantaine du père, mêmes demandes de ma part, même refus de la part de Pépa.
«—Or, le matin du septième jour, j'étais littéralement résolu à me brûler la cervelle si elle me refusait encore; mais, comme j'ai toujours fermement voulu, ce que j'ai voulu, j'aurais possédé Pépa de gré ou de force avant que de mourir.—Elle m'avait avoué son amour;—la possession n'était donc plus alors qu'une formalité, n'est-ce pas?»
Je répondis à mon ami Wolf par un hum... légèrement dubitatif, et le priai de continuer.
«—Comme j'allais me rendre à terre, on signala un aviso au large, j'envoyai mon embarcation, et un aspirant m'apporta des dépêches de mon amiral; il m'ordonnait de mettre à la voile le lendemain au point du jour, sans me dire pourquoi, et de rallier l'escadre.
«Je fus attéré, je me croyais, moi, mouillé là jusqu'au jugement dernier, et je n'avais pas un instant pensé à mon départ;—je donnai néanmoins les ordres pour appareiller le lendemain, et j'allai à terre apprendre cette nouvelle à Pépa;—sans m'être décidé à rien, j'avais toujours pris des pistolets avec moi.
«—Je pars demain,... Pépa... peut-être pour ne plus nous voir, lui dis-je.
«—Vrai,.. vrai,.. tu pars,.. et demain! s'écria-t-elle avec une joie qui me rendit sombre!—Il part demain, oh! mon Dieu, je te remercie, s'écria-t-elle en se jetant à genoux!
«—Pépa,... lui dis-je!
«—Mais elle, se précipitant à mon cou avec délire, fut la première à me couvrir de baisers; tu pars,... me disait-elle, mais tu ne pars que demain;... mais cette nuit,... cette nuit est à nous!—elle est à nous tout entière, cette nuit que tu regretteras.—Oh! oui,.. parce qu'elle sera la première et la seule; oui, ainsi tu regretteras ta Pépa,.. tu la regretteras, disait-elle avec une joie d'enfant et une exaltation de femme passionnée,—tu la quitteras en la désirant encore,.. en la désirant plus que tu ne l'auras jamais désirée,.. car tu ne sais pas, non, tu ne pourras jamais savoir combien je t'aime, et ce qu'il m'en a coûté pour te résister jusqu'ici.—Mais vois-tu, c'est toujours ainsi que j'avais rêvé l'amour;—avoir à moi un jour, un seul jour rempli des plus ardentes et des plus inexprimables voluptés;—mais un seul jour,—afin qu'il fût unique dans tous mes jours! car, si ce jour avait des lendemains, vois-tu, Wolf, auprès de lui,.. chaque lendemain serait pâle et lui ôterait de son prestige et de son éclat,.. et songe donc que je dois vivre toute ma vie de ce seul jour; car si mon pressentiment ne me trompe pas,... je ne te verrai plus,.. et, s'il me trompe, tu n'obtiendras pas plus de moi dans l'avenir!»
—Sacredieu, dis-je à Wolf, votre Pépa était un peu originale, mais malgré cela j'aurais voulu me trouver à votre place... vous deviez être un homme bien heureux...
—«Heureux à perdre la tête, aussi, vite, je retourne à bord afin de donner mes dernières instructions pour le lendemain matin.
—«Il était à peu près trois heures de l'après-midi, je fais préparer une petite yole que je manœuvrais moi seul pour me rendre à terre sans témoins; je passe encore le long du navire du père de Pépa, afin de bien m'assurer que la quarantaine ne finirait que le lendemain, je vois le digne capitaine, il me charge de ses tendresses pour sa fille, je lui fais signe de la main, et je me dirige vers cette partie de la côte où aboutissait le petit jardin de la maison de Pépa...»
—Ah ça, mais vous ne me parlez pas des scrupules que vous dûtes avoir,—dis-je à mon ami Wolf,—des scrupules que vous dûtes avoir quand vous vîtes ce bon homme si confiant, dont vous alliez séduire la fille...
—Mais mon ami me répondit avec une violence que je me plais à attribuer au punch.
—«Ne me dites donc pas des choses que vous ne pensez pas, et auxquelles vous n'eussiez pas songé non plus à ma place!
—«Des scrupules!...—est-ce qu'on a des scrupules quand on va posséder une femme comme Pépa! mais rappelez-vous donc qu'elle m'attendait, qu'elle avait éloigné sa vieille gouvernante... qu'elle était seule... toute seule... que je la voyais d'avance couchée sur son divan rouge avec son grand peignoir blanc et ses cheveux noirs, la gorge palpitante,—les yeux voilés;—car quoiqu'elle m'eût résisté, elle m'aimait autant que je l'aimais, et ses désirs étaient aussi violents et avaient été aussi comprimés que les miens. Or, vous concevez, mon cher, les délices que je rêvais, lorsque sur le point d'arriver à la plage, je crus apercevoir un homme qui nageait vers moi, venant du large en contournant les rochers qui bordaient la passe.
«Bientôt je n'en doutai plus, et je vis un homme nu, basané, crépu, qui toujours nageant me faisait signe de l'attendre.
—«Amenant ma misaine, je restai en panne, il me rejoignit et me demanda en anglais, si j'étais un officier de la goëlette.
—«J'en suis le commandant, lui dis-je.
—«Alors, capitaine, je n'aurai pas la peine de nager jusqu'à votre navire, voici pour vous seul,—et il décrocha de son col une petite boîte de plomb qu'il me donna d'une main, tandis qu'il s'appuyait de l'autre sur le gouvernail de mon embarcation, restant ainsi soutenu à fleur d'eau sans nager,—je cassai la boîte avec la lame de mon poignard et je lus... Savez-vous ce que c'était?...
—Non, mon cher Wolf...
—«Un nouvel ordre de l'amiral qui m'enjoignait de mettre à la voile, non plus le lendemain comme l'autre,—mais à l'instant que je recevrais sa missive.—La vitesse de ma goëlette était connue, et il m'ordonnait de me rendre immédiatement auprès de lui pour remplir une mission de la dernière importance; j'avais, me mandait-il, encore le temps de sortir du port; mais le lendemain, mais la nuit, mais le soir même, mais d'heure en heure cela me deviendrait peut-être impossible; car les Français devaient venir croiser devant Porto-Venere!... Ils y croisaient peut-être déjà,—Aussi dans cette crainte, l'amiral m'envoyait d'Especia, son patron, homme sûr, à lui dévoué, lui ordonnant de laisser son canot le long des rochers en dehors de la passe et d'entrer à la nage dans la rade, s'il le pouvait, afin que son embarcation ne donnât pas l'éveil à l'ennemi, dans le cas où il aurait déjà établi sa croisière aux environs du port.
«Enfin ce patron maudit avait réussi à exécuter les ordres de son amiral et il était là une main appuyée sur le gouvernail de ma yole, fixant sur moi ses yeux gris, et me disant:
—«Puisque nous allons partir, capitaine, voulez-vous me prendre avec vous, l'amiral m'a ordonné de revenir à bord de votre goëlette si j'échappais aux requins et aux Français, et de vous recommander encore de partir aussitôt que je vous aurais remis cette babiole qui me pesait furieusement au col.—J'ai échappé aux Français, non sans peine; car j'ai vu au vent une frégate et un brick, et pour peu que nous ne filions pas nos câbles par le bout, d'ici à une demi-heure... il sera trop tard, capitaine.»
—Mille diables, et... Pépa? dis-je à Wolf.
Il changeait de visage.—Il sentait ses veines brûler, sa poitrine s'embraser et ses pieds se glacer. La parole expirait dans sa bouche, la pensée dans son cerveau, il résista un moment.
P. L. JACOB.—La Danse Macabre.
—Mais Pépa, Pépa?—demandai-je encore à mon ami Wolf.
—«Attendez, me répond-il.—Puisque je suis comme à confesse, il faut que je vous dise tout ce qui me passa par la tête dans ce moment diabolique,—et je ne sais pas comment cela se fait,—mais je me rappelle toutes ces idées d'alors, comme si c'était hier.—C'est peut être parce que j'y pense souvent,—voyez-vous, ajouta Wolf après un moment de sombre silence.
«—D'abord la première pensée qui me vint, celle qui fut la base de toutes les autres—fut que je ne partirais pas,—après quoi je pensai que je serais naturellement fusillé net;—ce qui m'était égal, puisque le matin j'étais décidé à me fusiller moi-même si je n'obtenais rien de Pépa.—La question n'était pas là,—elle était dans cet infernal patron de l'amiral.—Il ne fallait pas songer à corrompre ce matelot,—je le connaissais.—Or, lors-même que je refuserais à partir, cet homme allait retourner à mon bord—parler des ordres que je venais de recevoir; et peut-être qu'une fois que mon second et mes officiers en seraient instruits:—de gré ou de force je me verrais obligé de partir... Or vous concevez ce que signifiait pour moi, ce mot,—partir.—Maintenant que vous connaissez Pépa...»
—Je le conçois si bien, dis-je à mon ami Wolf... que je n'ai qu'un regret...—on peut dire cela entre soi...—c'est que votre animal de patron n'ait pas été dévoré par un requin,—ajoutai-je tout bas...
«Vraiment...—me dit Wolf avec un accent singulier.—Pardieu je pensai tout juste comme vous..., moi!—quel dommage! me disais-je! comme vous,—car enfin un requin eût dévoré ce patron, je suppose...—eh bien! je n'avais pas de nouvelles de l'amiral,—et je n'étais obligé qu'à partir le lendemain au risque, il est vrai, de rencontrer l'ennemi, mais aussi j'avais ma nuit à moi..., une nuit de délices,—et demain au point du jour...—un dernier baiser à Pépa,—et peut-être un combat acharné à soutenir,—un combat enivrant, glorieux comme un combat inégal, concevez-vous,.. Sortant des bras de Pépa,—un pareil combat où j'aurais joué ma vie avec tant de bonheur et de joie; un combat qui avec cette nuit d'ivresse eût si bien complété ou fini ma vie...»
—C'était admirable en effet... dis-je à Wolf... et sans ce misérable patron...
«—Ah voilà, c'était ce maudit patron, répondit Wolf;—mais j'oubliais de vous dire, ajouta-t-il,—que pendant l'instant qui me suffit pour faire ces mille réflexions sur les ordres de l'amiral,—j'oubliais de vous dire que ma yole n'étant plus soutenue par la voile avait suivi un courant assez fort et qu'elle se dirigeait insensiblement vers un endroit de la rade, rendu extrêmement dangereux par un de ces tourbillons volcaniques si fréquents dans la Méditerranée.., et que je fus tiré de ma méditation par un cri du patron... qui ne se défiant de rien, suivant mon canot, auquel il se tenait sans nager, s'était senti tout à coup entraîner par le remous du tourbillon, avait lâché le gouvernail... et tournoyait, au milieu du gouffre... en criant,—jetez-moi un aviron ou je me noie...»
—Je ne pus dire un mot,—et je regardai Wolf en pâlissant, il était impassible et froid.
—Wolf continua d'une voix seulement un peu sourde.
«—Je dois vous avouer que si j'avais suivi mon premier mouvement, j'aurais jeté ma gaffe à cet homme pour lui sauver la vie.»
—Mais le second..., Wolf..., m'écriai-je... quel fut votre second mouvement.
«—Mon second mouvement, répondit Wolf,—fut de n'en rien faire et de voir, au contraire, cette mort avec joie.—Aussi le patron disparut en m'appelant:—assassin; il avait raison, car sa vie avait été entre mes mains,—et il m'eût été aussi facile de le sauver,—que de boucler mon ceinturon...»
—Je me levai violemment... mais Wolf me retint et me dit en souriant avec amertume.
«—Je vous l'avais bien dit... que j'étais un misérable. Mais, vous, l'homme aux scrupules, descendez dans votre âme intime... tout au fond... déroulez un de ces plis secrets et cachés que l'homme de sang-froid ose à peine interroger... acceptez toutes les chances de ma position, toute l'ivresse de mon amour forcené, auquel j'avais fait le sacrifice de ma vie;—persuadez-vous bien que l'impunité la plus entière m'était assurée, qu'un mystère profond... profond comme le gouffre sans fin qui avait englouti le patron enveloppait mon crime... qui après tout n'était qu'un déni d'humanité; dites-vous bien que le hasard seul avait tout fait,—que je ne connaissais pas cet homme, moi; dites-vous d'ailleurs ces mots devant lesquels se briseraient des vertus bien rudes:—Personne ne pouvait le savoir—car souvent la vertu c'est la peur du scandale;—dites-vous enfin tout ce que je pouvais me dire de consolant dans ma fatale position.—Songez surtout que j'aimais avec fureur,—songez à ce que j'avais été sur le point de perdre et à ce que la mort de cet homme pouvait me rendre...—Une nuit avec Pépa!!!—Et après cela osez me jurer par votre mère que vous n'eussiez pas agi comme moi,»—s'écria Wolf avec un regard perçant et froid qui me traversa le cœur.
—J'ai le courage ou la honte d'avouer que je ne pus trouver un mot à répondre.
Wolf n'ayant pas l'air de s'apercevoir de mon silence continua:—
«Je ne vous parlerai pas de la nuit que je passai avec Pépa,—il y a deux ans de cela,—Pépa est morte,—et pourtant à ce souvenir seul, voyez comme mes artères battent et comme je pâlis... car je le sens, je pâlis encore.
«Le lendemain ce que l'amiral avait prévu arriva, une croisière française était établie au vent de Porto-Venere.
«Je regagnai ma goëlette au point du jour et je dois encore vous avouer que j'eus la plus entière indifférence pour les pauvres gens que j'allais faire hacher par ma désobéissance; car, si j'avais suivi les ordres de l'amiral, nous eussions évité un combat bien meurtrier.
«—Mon équipage était excellent,—j'exaltai encore son courage et nous sortîmes de la passe décidés à nous faire couler,—moi surtout—comme vous pensez.—Ma goëlette marchait comme un poisson,—j'avais des pièces de dix-huit allongées en couleuvrines—nous aperçûmes un brick et une frégate,—le brick au vent,—la frégate sous le vent.
«Le brick nous appuya la chasse et nous joignit.—Après un combat sanglant où je fus blessé deux fois, il nous abandonna presqu'entièrement désemparé.—La frégate dut courir des bordées pour nous atteindre, elle commençait à nous canonner, et c'était fait de nous, je crois,—lorsqu'un coup du sort nous fit la démâter de son grand mât...—Nous n'avions que quelques agrès coupés,—rien d'essentiel d'endommagé.—Nous prîmes chasse à notre tour, et nous ralliâmes l'amiral vers le soir.
«—J'avais quatre-vingts hommes d'équipage et quatre officiers avant le combat.—En arrivant auprès de l'amiral, il ne me restait qu'un aspirant et vingt-trois matelots,—le reste était mort.—
«L'amiral, tout en me félicitant sur mon courage et en me promettant un grade supérieur, ne put s'empêcher de regretter son patron qu'il supposait avoir été dévoré par un requin, ou pris par une crampe avant d'avoir pu gagner mon bord.—
«Quel dommage, me dit-il,—si le malheureux avait réussi à vous porter mes ordres,—nous n'aurions pas à regretter la perte de tant de braves gens... Mais aussi ajouta-t-il par forme de compensation,—nous n'aurions pas à vous féliciter d'un si glorieux combat, capitaine Wolf.
«Deux mois après, le grade de capitaine de frégate, vint me récompenser de ma belle action comme dit le ministre dans sa lettre.—
«Voilà mon histoire, mon cher..., avouez donc après cela que je puis parler de dévouement en matière d'amour,—me dit Wolf d'un air tristement moqueur,—puis il ajouta:—Mais voilà nos convives qui montent, où en sont-ils de leur discussion?»
Les convives n'y pensaient ma foi plus.—On convint de se rendre à terre,—comme je me trouvais séparé de Wolf par un groupe,—je fus forcé de me placer dans une embarcation où il n'était pas.—Descendu au débarcadère, ne le rencontrant pas non plus, je supposai qu'il était resté à bord,—enfin pour chasser les idées un peu sombres que m'avait laissées la confidence de mon ami Wolf; j'allai passer la nuit chez une danseuse portugaise appelée Loretta, que j'entretenais assez magnifiquement depuis notre station à Malte.
Le lendemain matin j'étais couché et je m'amusais à tresser les cheveux de Loretta, qu'elle avait fort longs et fort beaux;—lorsque sa camériste vint me prévenir que mon valet de chambre qui savait où me trouver—voulait absolument me parler.—Je me levai,—et il me remit un billet ainsi conçu.
—Je vous attends sur le rempart, en face le palais des Grands-Maîtres, il faut absolument que je vous parle, soyez assez bon pour y venir,
WOLF.
—Qui t'a remis cela,—demandai-je à mon laquais?
—Capitaine, c'est un officier anglais,—un beau, grand jeune homme brun.—
—C'est bien, va m'attendre à bord.
J'embrassai Loretta, et je gagnai le rempart.—Mon ami Wolf s'y trouvait déjà.—Il était un peu pâle, mais il souriait; et sa figure avait même une expression de douceur que je n'avais pas remarqué la veille.—
Il vint à moi, et, me tendant la main:—J'étais sûr de vous voir, me dit-il... tant je comptais sur votre obligeance et sur les effets d'une sympathie que je n'avais ressentie pour personne, je vous jure...
Je lui secouai cordialement la main, et lui demandai à quoi je pouvais lui être utile.
—Mon cher ami,—puisque vous me permettez de vous donner ce nom,—répondit-il,—j'ai d'abord mille excuses à vous faire d'avoir abusé hier de vos moments, pour vous raconter une bien misérable histoire.
—Ma foi,—lui dis-je (et c'était vrai)—que le diable m'emporte si j'y pensais... mais bah... le Madère et le Xérès vous auront poussé au roman, mon cher Wolf... et vous vous serez vanté,—ne parlons plus de cela... encore une fois je l'avais oublié.
—Oh non, ajouta-t-il avec un sourire triste, je ne me suis pas vanté;—tout cela s'est passé comme je vous l'ai dit,—et vous êtes le seul,—ajouta-t-il en attachant sur moi ses grands yeux bleus mélancoliques,—vous êtes le seul qui sachiez cette aventure fatale.
—Et vous pouvez compter sur ma discrétion, répondis-je.—Fausse ou vraie, cette histoire est à jamais perdue dans le plus profond oubli.
—Cela ne peut pas être ainsi, répéta-t-il toujours avec sa voix douce et sonore.—Vous savez qu'hier je vous avais prévenu; désormais ce secret ne peut être possédé que par vous—ou par moi,—par tous deux c'est impossible.
—Mon cher Wolf, est-ce bien sérieusement que vous me dites cela?
—Très sérieusement...
—C'est une plaisanterie.
—Non, mon ami...
—Mais c'est absurde...
—Non ce n'est pas absurde; vous avez un secret qui, divulgué, peut me faire passer pour ce que je suis:—Un meurtrier,—ajouta Wolf péniblement,—puisque je n'ai pu le garder, moi, qu'il intéresse au point que vous devez croire... pourriez-vous le garder, vous, à qui il est indifférent;... ce doute serait trop affreux, or il faut en finir, et il en sera ainsi.
—Voilà qui est fort...—il en sera ainsi parce que vous le voulez, Wolf.
—Sans doute;—puis, me pressant les deux mains, il dit avec tendresse: Ne me refusez pas cela,—ne me forcez pas, je vous en supplie, à un éclat qui vous obligerait bien à m'accorder ce que je vous demande; vous me l'accorderiez pour un autre motif, il est vrai, mais cela serait toujours, n'est-ce pas.
—Allons, il faut nous brûler la cervelle,—parce qu'il vous a plu de me gratifier de votre diable d'aventure... J'y consens, mais c'est désagréable, vous l'avouerez au moins,...—dis-je avec humeur, sans pouvoir pourtant me fâcher tout-à-fait.
—Je le conçois, mais c'est comme cela... Pardonnez-moi,... mon ami, dit Wolf.
—Pardieu, non; ce sera bien assez de vous pardonner si vous me cassez la tête... car, pour que la plaisanterie soit complète, c'est toujours à cinq pas, et à pair ou non,—j'imagine.
—Toujours,...—répéta le damné Wolf, avec sa voix de jeune fille.
—Vos témoins, lui demandai-je...
—Votre voisin de gauche d'hier, me dit-il.
—Aurez-vous vos armes,... Wolf?
—Oui, j'aurai les miennes;—ainsi n'apportez pas les vôtres, c'est inutile... à moins pourtant que vous vous défiez...
—Capitaine,... lui dis-je très-sérieusement cette fois...
—Pardon, mon ami; mais dites bien à votre témoin que c'est une affaire à mort, inarrangeable, qu'il y a eu des voies de fait.
—Il le faut pardieu bien, m'écriai-je... et à quand cette belle équipée?... car en vérité, mon ami Wolf, il faut l'avouer, nous sommes aussi fous, tranchons le mot, aussi bêtes que deux aspirants sortant de l'école de marine; mais enfin, à quand?
—Mais, mon Dieu, dans une heure... trouvons-nous aux ruines du vieux port...
—Va pour les ruines du vieux port.
—Votre main, me dit Wolf.
—La voici.
—Vous ne m'en voulez pas au moins, me demanda-t-il encore.
—Parbleu si, je vous en veux, et beaucoup.
Il sourit, me salua de la tête, et nous nous séparâmes.
J'étais revenu à bord pour faire quelques préparatifs, écrire quelques lettres, car en vérité je croyais rêver.—Un capitaine de frégate de mes amis consentit avec peine à me servir de témoin quand il sut quelles étaient les conditions de ce duel meurtrier.—A cinq pas, un pistolet chargé et l'autre non.—
Ce qui me désespérait surtout, c'étaient les véhémentes sorties de mon digne témoin sur ce qu'il appelait ma crânerie.—Vous aurez cherché l'affaire, me disait-il,—comme cette fois à la Martinique.—Vous avez aussi la main trop légère, mon cher ami,... il vous arrivera malheur... Quel dommage, un jeune officier d'une si belle espérance... et tutti quanti.
—J'avais beau dire et redire que je n'étais pas l'agresseur,—il me répondait à cela:—Le capitaine Wolf, m'a-t-on dit, ne boit ordinairement que de l'eau;—il est connu pour sa douceur, son humeur triste et solitaire.—Comment diable voulez-vous qu'il se soit grisé et vous ait insulté le premier;... c'est impossible.
—Mais cordieu, Monsieur, m'écriai-je...
—Bon, bon, faites-moi une autre querelle à moi, me répondit l'imperturbable, pour me prouver que vous n'êtes pas querelleur...
—C'était à devenir fou, aussi je me tus.—Je fermai mes lettres,—donnai quelques commissions à mon valet de chambre,—demandai un canot et me dirigeai vers le vieux fort avec mon témoin.
—Quand nous débarquâmes, Wolf y était déjà;... Il vint au-devant de moi;—il n'était plus pâle, ses joues étaient légèrement rosées, ses cheveux soigneusement bouclés, ses yeux brillants, j'avais peu vu d'hommes d'une beauté aussi remarquable.
—Allons donc, paresseux, me dit-il, d'un ton d'amical reproche...
—Chose bizarre, pendant la traversée, j'avais fait tout au monde pour me monter comme on dit,—pour me mettre au niveau de cet horrible combat:—impossible:—j'allais là me brûler la cervelle sans colère, sans haine, sans fiel, sans prétexte, et seulement par point d'honneur,—car je connaissais assez Wolf pour être certain que, si j'eusse refusé le combat, il m'eût contraint à l'accepter par une insulte irréparable.—Aussi j'aimais encore mieux me battre presque sans savoir pourquoi;—sans lui en vouloir;—car malgré son crime je ne le haïssais pas, il s'en faut.
—Oui, je l'avoue, cet être bizarre exerçait sur moi une singulière influence.—Son air triste, sa voix douce, son calme, une inconcevable sympathie de pensées qui s'étaient développées entre nous avant sa maudite confidence;—et puis, enfin, un amour inné chez moi pour tout ce qui est extraordinaire.—Tout cela faisait que je ne pensai pas un instant à la mort qui allait peut-être m'atteindre, occupé que j'étais à m'étonner de tant de choses inconcevables.
—Messieurs, dit mon témoin,—toute représentation est sans doute inutile...
—Inutile! répéta Wolf.
—Vous savez que c'est un assassinat que l'un de vous deux va commettre, dit le témoin de Wolf.
—Nous le savons,—répéta Wolf.
—Allez donc, messieurs, et que Dieu vous pardonne, dit le bon capitaine d'une voix grave.
—Ce témoin de Wolf—mesura cinq pas...
—Mon témoin prit les pistolets que Wolf avait apportés et voulut les visiter.
—Je m'y oppose formellement, Monsieur,—m'écriai-je en l'arrêtant...
—Wolf me prit la main, la serra fortement et me dit:—Capitaine,—bien,—mais j'ai à vous faire une demande:—Vous confiez-vous assez à ma loyauté pour me laisser choisir—quoique ce soient mes armes?
—Avant que nos témoins aient pu rien empêcher—j'avais pris les pistolets et je les présentais à Wolf,—Il en prit un.
—Je pris l'autre.
—Le cœur me battait horriblement.
—Quoique la conduite singulière de Wolf me fît penser que peut-être tout ce duel n'était-il qu'une bizarre et mauvaise plaisanterie,—pourtant je me plaçai en face de Wolf.
—De ma vie je n'oublierai son attitude calme, souriante, je dirai presque heureuse.—Il passa ses doigts dans sa belle chevelure noire, et appuya un instant son front dans sa main comme pour se recueillir, puis levant les yeux au ciel, il y eut dans son regard une expression de reconnaissance ineffable... puis il abaissa les yeux sur moi,—leva son pistolet et m'ajusta.
—Je l'ajustai à mon tour;—les canons des deux pistolets se touchaient presque.
—Êtes-vous prêts, Messieurs, dirent les témoins.
—Oui...
—Mon Dieu, pardonnez-leur,—dit en anglais le vieil officier taciturne, en frappant dans ses mains.
—Nos deux coups partirent ensemble.
—J'eus un moment d'éblouissement,—causé par la flamme et l'explosion du coup de Wolf,—et quand au bout d'une seconde je revins à moi,—je vis nos deux témoins courbés près de Wolf... qui s'appuyait sur son coude...
—Mon Dieu, mon Dieu... Vous l'avez voulu, lui dis-je avec désespoir... car le malheureux était tout sanglant. Vous savez que ce n'est pas moi... Pardon, mon ami,...—pardon... pardon...—
—J'ai été l'agresseur, et je suis justement puni,—je vous pardonne ma mort, dit-il d'une voix faible...—Puis s'approchant du mon oreille,—ses derniers mots, que seul j'entendis, furent ceux-ci:—Mes mesures étaient prises pour mourir de votre main... Merci....—oh Pépa!...
—Ma balle lui avait traversé la poitrine.
—Je compris alors pourquoi Wolf avait voulu choisir entre les deux pistolets.....
C'était le 15 mai—1789.
Vers le milieu de la rue Saint-Honoré il y avait une haute et obscure maison de six étages, au sixième étage une petite chambre, dans cette petite chambre une fenêtre étroite, et à cette fenêtre un jeune homme d'une taille moyenne et assez laid. Ce jeune homme était Claude Belissan, clerc de procureur, légèrement atteint de l'épidémie philosophique qui régnait alors.
L'eau tombait à torrents d'un ciel gris sombre, menaçant, et de fortes raffales de vent faisaient fouetter les ondes contre les carreaux qui ruisselaient de pluie.
Pour la première fois, Claude Belissan blasphémait Dieu d'une épouvantable façon, car jusque-là il avait été élevé par sa mère dans de saintes et religieuses croyances.
—Tombe... disait-il, tombe... donc, averse maudite! change les rues en rivières, les places en lacs, la plaine en océan... Bien... allons, le déluge... un nouveau déluge... et un dimanche encore! un dimanche!... quand on a travaillé toute la semaine... Bah!... les philosophes ont bien raison; il n'y a pas de Dieu... il n'y a qu'un destin, un hasard... et encore!!!
Et voilà, comme de croyant qu'il était, Belissan devint furieusement fataliste et incrédule.
Et la pluie redoublant, cinglait, pétillait sur les vitres, et Belissan trépignait et se damnait en regardant avec douleur et rage sa culotte luisante de gourgouran, ses bas de coton blanc, sa chemise à jabot et à manchettes.
Et Belissan se damnait encore en jetant un coup-d'œil de profond et amer regret sur sa veste de bazin à fleurs et son habit de ratine bleue soigneusement étendus sur son lit virginal... car le lit de Belissan était virginal.
A une nouvelle ondulation de l'averse, Belissan fit un tel bond de fureur qu'un nuage de poudre blanche et parfumée s'échappa de sa tête, et flotta indécis dans sa chambre... On eût dit el signor Campanona dans toute la fougue de son exaltation musicale.
—Enfer, malédiction... s'écria-t-il! et Catherine... Catherine qui m'attend... Une promenade, un rendez-vous calculé, combiné depuis cinq semaines... le voir manquer, j'en deviendrai fou... fou... à lier... Dieu me le paiera!!
Et après avoir montré le poing au ciel, en manière d'Ajax, Belissan cacha sa tête dans ses mains...
Au bout de quelques minutes d'une cruelle rêverie, où il ne vit que ruisseaux débordés, gouttières gonflées, boue et parapluies, le jeune clerc suspendit sa respiration, puis son cœur palpita, bondit... Il dressa la tête, prêta l'oreille... mais sans ouvrir les yeux, tant il craignait une amère déception... Figurez-vous que le malheureux croyait ne plus entendre la pluie tomber que goutte à goutte et rebondir sur le toit!!!
Et ce ne fut pas une illusion.
Le ciel s'éclaircit; bientôt une légère brise de nord-est s'éleva, grandit, souffla, et après une demi-heure d'attente et d'angoisse inexprimable, les nuages chassèrent, se refoulèrent à l'horizon, le soleil étincela sur les toits humides, le ciel devint bleu, l'air tiède et chaud, enfin jamais journée de printemps commencée sous d'aussi funèbres auspices ne parut se devoir terminer plus riante et plus pure.
Belissan, au lieu de remercier Dieu, ne pensa qu'à sa culotte de gourgouran, à son habit de ratine, prit son chapeau sous son bras, rajusta sa coiffure, et en sept minutes fut au bas de son escalier, fringant, pimpant, lustré, pomponné, éblouissant à voir.
—Mais hélas! quel horrible spectacle! les pavés étaient fangeux, les gouttières filtraient l'eau, et une foule d'équipages se croisaient dans la rue.
Alors Belissan prit résolument le parti de marcher sur ses pointes et entreprit la périlleuse tournée qui devait le réunir à sa Catherine. Il n'était plus qu'à quelques pas de la boutique de cette jolie fille, lorsque les piétons se refoulent à la hâte, se pressent, se heurtent, avertis par un piqueur à livrée verte et orange qui précédait un bel équipage à quatre chevaux.—Mais quatre magnifiques chevaux bai-bruns, les deux de volées surtout étaient du plus pur sang danois, circonstance qui ne pouvait échapper à la vue de Belissan, car le malheureux, par une incroyable fatalité, fut placé au premier rang des piétons, et les chevaux danois, qui piaffaient beaucoup, ayant un pas fort relevé, couvrirent le pauvre clerc d'une pluie de boue, mais si noire, mais si épaisse, mais si grasse, qu'elle tacha affreusement l'habit de ratine et la culotte de gourgouran.
Ce seigneur qui venait de passer était M. le marquis de Beaumont; il revenait de Versailles, et allait visiter M. le duc de Luynes.
Belissan resta stupéfait et moucheté comme un tigre, mais comme un tigre aussi il se prit à rugir en montrant le poing au brillant équipage, comme naguère il l'avait montré à Dieu, le montrant surtout à un grand coureur tout chamarré d'or et de soie qui, perché derrière la voiture, se pâmait de rire insolemment.
De ce moment, de cette minute, de cette seconde, Belissan jura haine éternelle à Dieu, aux marquis, aux voitures, aux coureurs, aux chevaux danois, et se proclama l'égal de tout le monde, grand seigneur, laquais ou cheval danois.
Il allait peut-être se livrer à une longue et fougueuse méditation sur l'inégalité des positions sociales, lorsqu'il se souvint de Catherine; il remit donc sa colère à plus tard, jeta un triste coup-d'œil sur ses mouchetures, et dit en soupirant:
—Après tout, il vaut peut-être mieux laisser sécher la boue que de l'étendre; d'ailleurs, Catherine me plaindra...
Et il continua sa route, la tête bouleversée, exaspérée par ses idées d'amour et d'égalité, de bonheur et de haine. C'était alors une fournaise que le cerveau de Claude Belissan, et, quand il entra dans la rue où demeurait sa maîtresse, sa tête devait certainement fumer, tant ses pensées étaient brûlantes et effervescentes...
Mais, hélas! plaignez Belissan,.... figurez-vous ce que devint, ce qu'éprouva, ce que ressentit Belissan... mettez-vous à la place de Belissan quand il vit arrêté, presqu'en face la porte de Catherine, l'équipage maudit qui l'avait si curieusement tigré!
Or, le père de Catherine était parfumeur-gantier, à la Bonne-Foi, et sa boutique se trouvait toute proche de l'hôtel de Luynes.
Belissan respira pourtant lorsqu'il ne vit plus le grand coureur. Il s'approcha de la porte de la boutique, jeta un dernier regard de désespoir sur sa toilette souillée, et entra...
Mais en entrant il passa par toutes les nuances du prisme, à partir du blanc jusqu'au violet; ses yeux se troublèrent, il vit des flammes bleues, la tête lui tourna, il ne put que s'asseoir convulsivement sur le comptoir, et sur la main du gantier, qui s'écria: Prenez donc garde, monsieur Belissan.
Mais Belissan ne prenait pas garde. Belissan avait vu en entrant la jolie gantière essayer des gants au grand coureur, fort bel homme en vérité, Belissan avait encore vu le grand coureur serrer les mains de Catherine, qui avait souri en rougissant...
Et puis il n'avait plus rien vu.
Mais il avait pensé...
Le clerc fit alors un mouvement désordonné, comme si un fer rouge lui eût traversé la cervelle, et frappa un grand coup de poing sur le comptoir.
A ce bruit, Catherine leva la tête.
Le beau coureur leva la tête.
Et tous deux, voyant Belissan si tigré, si moucheté, si colère, si pâle, si singulier, si effaré, partirent d'un éclat de rire prolongé, dans lequel le timbre pur et frais de la jolie Catherine se mêlait à la basse sonore et retentissante du coureur.
Belissan fit une grimace colérique et un geste de possédé.
Et le duo de rire recommença de plus belle; seulement, le rire sec et cassé du mercier, vint gâter l'harmonie.
Belissan ne se possédant plus, s'avança contre le coureur en levant une aune; mais au même instant ses deux poignets furent emprisonnés de la large main du coureur et il entendit l'honnête gantier s'écrier: Comment! vous osez porter la main sur un des gens de M. le marquis de Beaumont, dont nous espérons avoir la pratique! pour un ami, c'est mal à vous, monsieur Belissan.
Et Catherine aussi lui dit aigrement:
—Eh! quand on est fait de la sorte, on ne vient pas chez les gens.
Et le beau coureur reprit:
—Mon petit monsieur, sans les beaux yeux de cette jolie demoiselle, vous passiez par la porte, vrai comme je m'appelle Almanzor, vrai comme j'ai l'honneur d'être au service de M. le marquis de Beaumont.
—Pardonnez-lui pour cette fois, monsieur Almanzor, dit Catherine d'un air caressant, en lorgnant le beau coureur.
—Allez vous changer... vous nous faites peur, monsieur Belissan, dit le gantier en contraignant à peine un éclat de rire.
—Il y a un baigneur étuviste, là-bas au numéro 15, dit enfin Almanzor en conduisant Belissan à la porte de la boutique avec une politesse moqueuse...
Le clerc se croyait sous l'obsession d'un affreux cauchemar... il ne répondit pas un mot, n'entendit rien, ne vit rien, partit comme un trait, et ne s'arrêta qu'aux Champs-Elysées.
Et encore il ne s'arrêta que parce qu'il se heurta avec un homme qui s'écria: Tiens, c'est Belissan!
Belissan rappela ses esprits...
—Qui me parle? où suis-je? que me veut-on?... soupira-t-il.
—C'est moi, Lucien, qui te parle; tu es aux Champs-Elysées, crotté jusqu'à l'échine. Je veux te dire adieu, car je vais au Hâvre.
—Tu vas au Hâvre? Je pars avec toi!
—Mais je pars aujourd'hui, à l'instant!
—Je pars aujourd'hui, à l'instant!
—Je prends le coche; je vais par eau...
—J'irai par eau, par le coche, par le diable; mais je veux quitter cet infâme Paris; je veux aller vivre dans un désert, dans une île où tout me soit égal et où je sois égal à tout... Comprends-tu, Lucien?..
—Non, mais l'heure presse... Viens-tu?... Mais enfin du linge... des vêtements?
—Tu m'en prêteras, Lucien, répondit Belissan avec une touchante mélancolie, tu m'en donneras des vêtements; les hommes sont frères.
—De l'argent.
—Je partagerai avec toi, bon Lucien; les hommes sont égaux, va.
—A la bonne heure! dit Lucien;
Il est malade ou fou, pensa-t-il; ce petit voyage ne peut que lui faire du bien, je l'emmène.
—Adieu, vil égout, vil Paris, dit dédaigneusement le clerc en se jetant sur le coche.
Et voilà comment Claude Belissan quitta Paris.
Le capitaine Dufour, commandant le trois mâts la Comtesse de Cérigny, n'attendait plus qu'un passager ou deux pour partir du Hâvre et se rendre à sa destination. Il devait porter d'abord des marchandises dans la mer du Sud, les vendre, aller ensuite aux Moluques acheter des épiceries, et revenir par le cap de Bonne-Espérance; c'était une circumnavigation, presque le tour du monde.
Un matin son mousse lui annonça un monsieur.
—Qu'est-ce que c'est que ça, mousse?
—Un pâlot, capitaine, qui a une queue.
—Fais entrer le pâlot.
Le pâlot entre; c'était Belissan.
—Monsieur, dit-il au capitaine, votre vaisseau va partir prochainement?
—Oui, Monsieur, je n'attends plus qu'un passager, et je désirerais bien que ce fût vous, répondit fort spirituellement le capitaine.
—C'est possible, dit Belissan, pourvu que vous me conduisiez dans une île...
—Dans quelle île, Monsieur?
—Dans une île quelconque, Monsieur, cela m'est égal, pourvu que ce soit dans une île, une île déserte ou sauvage, dans laquelle je ne rencontre ni grands seigneurs, ni chevaux danois, ni coureurs, ni filles trompeuses. Dans une île, reprit Belissan avec une agitation croissante, où l'égalité soit proclamée comme le seul des biens, dans une île déserte, sauvage, où je puisse savourer à mon aise le premier, le plus inestimable de tous les dons octroyés aux humains; dans une île...
Permettez, dit le capitaine Dufour, persuadé qu'il n'interrompait qu'un fou, est-ce bien sérieusement que vous me dites tout cela?
—Il me semble que je n'ai pas l'air de crever de rire, objecta sourdement Belissan.
—Alors, Monsieur, il m'est impossible de vous prendre à mon bord; je vous le répète, je vais à Callao, dans la mer du Sud, puis je reviens par la mer des Indes. Mais attendez donc, pourtant, si en route vous voulez descendre à Otahity, nous y relâcherons sans doute, et...
—Vous relâcherez à Otahity, la nouvelle découverte de Bougainville, la Cythère du nouveau monde! j'irai à Otahity... nation généreuse et nouvelle! Là, pas de coureurs, de marquis, de chevaux danois; là une existence douce et pure comme l'eau de ses ruisseaux; là du soleil; là des fleurs; là des arbres pour tous, là une nature primitive et bonne, là pas de différences sociales; là des frères; là des sœurs. A Otahity, monsieur le capitaine! A Otahity!... j'abjure mon titre d'Européen: dégénéré, abruti par la civilisation, je reviens à mon état de nature, dont je suis fier.—J'étais descendu homme, je remonte sauvage! (Ici une pose académique; ici Claude se dresse sur ses pieds et tâche de grandir sa petite taille et de se draper à l'antique avec son habit de ratine, qui s'y refuse.) A Otahity! Là, pas de Dieu qui prenne un malin plaisir à contrarier nos projets, là, pas de roi, là, pas de courtisans, de vils courtisans qui dévorent la substance du peuple, là, pas de ces insignes stupides, de ces habits ridicules qui classent et numérotent votre position sociale... A Otahity!... O Voltaire! O Dalembert! O Diderot! O philosophes, lumière éternelle des nations! c'est là que vous devriez être, c'est à Otahity que votre véritable place est désignée... O vous philanthropes, qui rêvez la paix et la famille universelle... à Otahity... à Otahity, venez-y... venez, nous y ferons une seule famille! une grande famille!
Ici l'invocation bienveillante et philanthropique de Belissan prit un tel caractère de rage et de frénésie que M. Dufour fut obligé de le prendre par le milieu du corps et d'appeler son mousse.
Le mousse vint, et, se joignant à son maître, ils finirent par calmer Belissan, qui ne criait plus que faiblement et par saccades:—A Otahity! à Otahity!
Le capitaine Dufour agita longtemps la question de savoir s'il prendrait à son bord Claude Belissan, qui lui paraissait fou. Pourtant, ayant considéré que Belissan le payait bien, il consentit.
Claude quitta la France sans prévenir son vieil oncle, vendit le peu qu'il avait, persuadé qu'à Otahity le vil argent serait tout-à-fait inutile.
On partit; et, lorsque l'écrivain du bord demanda la profession de chaque passager pour l'inscrire sur le rôle d'équipage, Belissan le stupéfia en lui répondant d'un air majestueux:
—Homme!!!
—Homme! fit l'écrivain en sautant de sa chaise.
—Homme, réitéra Belissan...
—Comment cela, homme? dit encore l'écrivain ébahi... mais homme, quoi? quel titre!
—Mais, hurla Claude, qui devenait bleu de fureur... homme simplement... homme de la nature, si vous aimez mieux... Les voilà bien! dit Belissan avec un sourire amer, en haussant les épaules de pitié; les voilà bien, quel titre! il leur faut un titre... ils vous demandent un vain titre... une ignoble profession... quand ils sont les rois... les géants de la création! Je suis sauvage, entends-tu, être dégradé, abruti par une société égoïste et bâtarde, par une civilisation corruptrice, dit Belissan tout d'une haleine et en tournant le dos au commis, qui avait pourtant une figure bien respectable, je vous assure.
—Il est dans ses lunes, objecta l'écrivain déjà prévenu de la singularité de Belissan; puis il ajouta sur son livre de bord:—Claude Belissan se prétendant homme de la nature, mais allant à l'île d'Otahity, pour affaires de commerce.
Le trois mâts la Comtesse de Cérigny partit du Hâvre le 13 juin 1789.
Un mois après son embarquement à bord de la Comtesse de Cérigny, Claude Belissan était déjà borgne; six semaines après, il avait perdu deux dents molaires, plus une incisive; quatre mois ensuite; il avait eu trois côtes d'enfoncées comme on doublait le cap Horn. Enfin, ce fut un bien beau jour pour lui que le jour où l'on mouilla à Callao, car si la traversée eût duré plus long-temps, Claude Belissan, homme, eût été dissipé en détail.
Ces accidents variés avaient eu pour cause la tendance philosophique et philantropique du jeune homme, sa soif du bien général, son horreur des inégalités sociales, et son rêve de perfectionnement universel.
Et, d'abord, ayant vu un grand, gros et large matelot, fouetter un mousse, parce que le mousse n'avait pas assez vite serré le petit cacatoës, Belissan s'écria:
—Horreur! Frémis, ô nature!... voici un frère qui bat son frère! Marin, ce mousse est ton frère et ton égal; laisse ce mousse, ô marin!
Et le matelot, mordant sa chique avec insouciance, répondit honnêtement à Claude, sans abandonner son mousse:
—Bourgeois, ce mousse n'est pas mon égal, vu qu'il est mousse et que je suis gabier, vu qu'il est enfant et que je suis homme, vu qu'il serre mal une voile et que je la serre bien. Quand il sera gabier, il fouettera les mousses à son tour. Or, bourgeois, je lui dois quinze coups de garcette, je suis au septième, laissez-moi finir... car je lui apprends son état, voyez-vous, bourgeois!
—D'abord, je ne suis point bourgeois, je suis homme, simplement homme, et, comme homme, je te dis que tu ne finiras pas de lâcher cet enfant, ton frère et le mien, tyran, despote, antropophage? hurla Belissan en tâchant d'étreindre dans ses petites mains le large bras du marin... Tu ne finiras pas! car je suis ton égal, et comme ton égal, je t'ordonne de finir! c'est-à-dire de ne pas finir!
—Bourgeois, répondit le marin avec un ton stoïque, vous n'êtes pas mon égal, parce que je suis de mer et vous de terre; vous n'êtes pas mon chef non plus, aussi...
Et, comme Belissan l'interrompit avec une prodigieuse violence:
—Alors, dit le marin, puisque nous sommes égaux, voici un coup de poing, bourgeois, rendez-moi son égal...
Duquel coup de poing Belissan ne rendit pas l'égal, et fut borgne, comme on sait.
Un autre jour, Belissan malmena furieusement le capitaine, qui, pendant la tempête, avait toujours tenu son équipage sur le pont. Claude pérorait, Claude se démenait pour prouver à ces braves gens qu'ils avaient bien le droit de ne pas manœuvrer du tout, et qu'étant nés libres ils avaient la liberté de se laisser couler à fond. Fatigués des cris du petit homme, ils le bâillonnèrent et l'envoyèrent dans la cale; mais comme Claude résista pendant l'opération, il y laissa les dents que vous savez.
La conséquence immédiate de cet accident fut pour Claude un accès de misanthropie la plus prononcée et la plus dédaigneuse. Claude se prit à haïr l'humaine espèce.—Et tu n'es ainsi dégradée, infâme société, hurlait Claude avec un sifflement aigu qu'il devait à la perte de ses incisives; tu n'es ainsi dégradée, continuait-il, que par la civilisation et par la féroce influence des grands, des rois, des prêtres, des coureurs et des chevaux danois! c'est la civilisation qui t'a perdue. Ah! qu'ils t'avaient bien jugée, les immenses philosophes qui, pour te régénérer, te renouveler, voulaient te ramener à la loi naturelle, à l'état de nature, car c'est là le bonheur, le vrai bonheur. O état de nature! je t'offre en holocauste tous mes tourments, mes souffrances, mon œil et mes trois dents! O Otahity!... Otahity! tu seras mon paradis, car je fais ici mon purgatoire! et je ne me sers de ces ridicules mots de paradis et de purgatoire que parce que je n'en ai pas d'autres, ajouta Belissan avec dégoût. Puis Belissan eut une idée.
Belissan se dit: Voilà sur ce bâtiment un parti, un segment, une fraction de la société. Qui m'empêche d'humilier la société tout entière dans ce segment! de l'écraser!... Qui m'empêche de la mettre sous mes pieds, de la fouler sous mes pieds... en lui prouvant que j'aime mieux vivre avec un animal, un brute et stupide animal, que d'endurer plus long-temps son contact flétrissant, impur et dégradant. Et à la grande mortification de cette société qu'il méprisait, Belissan élut pour domicile un endroit du faux pont où l'on avait renfermé un veau destiné à la nourriture de l'équipage. Il vécut avec ce veau, parlait à ce veau, mangeait avec ce veau, s'ébattait avec ce veau, et s'écriait parfois, en roulant avec le veau dans son fumier... Rougis et pleure... pleure... société! voilà le cas que je fais de toi! et l'équipage ne fondait pas en larmes; non, l'équipage se pâmait d'aise, car cette nouvelle folie de Belissan l'avait débarrassé de l'ancien clerc.
Mais à force de se rouler et de causer philosophie et perfectionnement avec son veau, Belissan vint à vouloir distraire son ami; il lui souffla dans les yeux, lui entra des fétus de paille dans les narines, tant et si bien, que le veau se fâcha, s'irrita et d'un coup de tête enfonça trois des meilleures côtes de Belissan. Or, arrivant à Callao, il était mourant. On comptait assez sur sa mort; mais, grâce aux soins du supérieur de la Mission à Lima, le damné clerc en revint, et fut prêt à retourner à bord au moment où le brick appareilla pour les Moluques.
Le capitaine étant trop honnête homme pour laisser Belissan au Pérou, le reprit à son bord en jurant; mais pensant qu'il touchait au terme de son voyage et voulant l'abréger encore, il proposa à Claude de le débarquer aux îles Marquises, reconnues, visitées par Marchand, et à son dire, au moins aussi cythéréennes que les îles des Amis.
Leur nom aristocratique éloigna bien un peu Belissan; mais ayant navigué sur la Comtesse de Cérigny, il pouvait bien aborder aux îles Marquises. Il consentit donc avec joie à ce changement, surtout quand on lui eut montré sur la carte que ces îles Marquises étaient infiniment plus rapprochées qu'Otahity.
Deux mois après une relâche à Acapuleo, le brick mit en panne au vent des îles les plus orientales du groupe des Marquises, on envoya un canot bien armé, qui déposa, à la grande joie de l'équipage, Claude Belissan à la pointe méridionale de l'île Hatouhougou, un peu avant le lever du soleil, et puis l'embarcation rejoignit le brick, qui fit voile vers le sud.
Enfin je te foule,... cria Belissan, sol de la liberté, de l'égalité! Je te foule, sol natal des fils de la nature restés hommes de la nature! ici l'eau des fontaines pour boisson, les fruits des arbres et quelques coquillages pour nourriture; pour lit ce gazon parfumé, pour vêtements... Non, pas de vêtements. Est-ce que la nature m'a donné des vêtements à moi!... C'est du vêtement que naissent ces infâmes inégalités sociales. Ici, c'est la nature:... ici donc le costume de la nature. Arrière l'Europe, nargue de la civilisation, mépris pour la France, foin des rois, des courtisans et des chevaux danois! hurlait Belissan en jetant bien loin et sa culotte de gourgouran, et son habit de ratine, et sa veste piquée.
Vive la nature! reprit-il, la nature qui n'emprunte rien à cette ridicule et mesquine industrie d'eux autres civilisés.
Ici Claude fut interrompu par l'explosion d'une arme à feu; il tressaillit... puis, comme le soleil s'était levé, et qu'il pouvait parfaitement distinguer les objets, il eut une peur affreuse à la vue de Toa-ka-Magarow, chef souverain, autocrate, empereur ou roi de l'île Hatouhougou.
Ce digne seigneur était d'une haute et puissante stature, tatoué de rouge et bleu, avait le nez droit et long, le front déprimé, et la lèvre inférieure prodigieusement allongée par le poids d'une espèce de petite écuelle de coco qu'il y avait suspendue au moyen d'un anneau passé dans les chairs. De plus, Toa-Ka-Magarow tenait à la main un fusil anglais, et marchait fièrement vêtu d'un vieil uniforme galonné qu'il possédait probablement par échange ou par vol; du reste, excepté une pagne serrée autour de ses reins, il était absolument nu. Je ne parle pas d'une croix de Saint-Louis dont l'anneau passait par le cartilage du nez, cet ornement étant de mauvais goût.
Dès que Toa-Ka-Magarow eut tiré son coup de fusil, il poussa un cri sauvage et guttural qui stupéfia Belissan, car c'était à l'aspect de l'ancien clerc que ce cri avait été poussé. Toa-Ka-Magarow poussa un troisième cri, mais celui-ci fut court; puis une espèce de rire ou de grincement de dents agita la petite écuelle de coco, et fit osciller la croix de Saint-Louis d'une narine à l'autre.
Claude Belissan, un peu rassuré parce que la crosse n'était plus dans une position horizontale ne recula pas. Après tout, se dit-il, c'est mon égal, je suis son égal, son frère, pourquoi donc craindrais-je; et Claude s'avança bravement en tendant la main au grand chef.
A cette démonstration amicale et familière de Belissan, à cette démarche inouïe, bizarre pour l'autocrate de Hatouhougou, celui-ci poussa un quatrième cri, mais si furieux, mais si colère, mais si aigu, que Claude fit un bond énorme de surprise.
Et sa surprise se changea en terreur lorsque le grand chef, par une pantomime aussi expressive qu'effrayante, montrant au clerc son habit galonné, sa croix de Saint-Louis et de vieux morceaux de cuivre attachés à ses bras avec des ficelles, lui fit entendre clairement qu'il était chef, roi, maître, et que Belissan lui devait respect, soumission et obéissance, ce qu'il exprima par une demi-génuflexion, et la position de ses bras croisés sur sa poitrine; enfin, la péroraison fut un terrible tournoiement du fusil dont la crosse bourdonnait aux oreilles de Belissan, tant le sauvage maniait cette arme avec dextérité.
Et Belissan s'agenouilla trempé de sueur, et ce fut un tableau bizarre que de voir ce sauvage d'une taille athlétique, avec sa figure mi-partie rouge et bleue, ses yeux ardents, ses lèvres gonflées, ses dents noircies par le bettel, ses haillons galonnés, sa chevelure crépue, hérissée, nouée, mêlée et toute couverte d'une poudre orange et semée de coquillages de mille couleurs, que de le voir imposant, debout, la tête dédaigneusement penchée, considérer Belissan, nu, grelottant de frayeur, vert de terreur, agenouillé, les bras croisés et les yeux fixes.
Il faudrait être un bien profond psychologiste pour analyser les pensées tumultueuses qui luttaient alors dans la tête de Belissan, lutte acharnée, impitoyable, des anciennes idées du clerc contre l'évidence des faits. Et dans un espace de temps incommensurable, Belissan se fit mille reproches, Belissan préférait les mouchetures des chevaux danois, les sarcasmes du grand coureur, la coquetterie de Catherine, à l'effroyable susceptibilité de son ami, de son frère, de son égal, l'homme de la nature.
Et ce qui l'irritait davantage, c'était encore moins de s'être prosterné devant l'emblème du pouvoir que de voir cet emblême formulé par un vieux habit européen qui lui rappelait si cruellement les distinctions sociales qu'il voulait fuir.
On ne sait dans quelle haute région spéculative Belissan eût été entraîné par sa pensée, si Toa-Ka-Magarow ne lui eût fait signe de se relever, et en manière d'ordre ne lui eût donné un coup de crosse au milieu des reins.
Et les deux égaux arrivèrent aux cases.
Et si Belissan eût eu la force de contracter les mâchoires, il eût indubitablement grincé des dents en voyant une case élevée, haute, peinte de couleurs tranchantes, en tout enfin distinguée des autres, case aristocratique, case seigneuriale, case princière, case royale, s'il en fut.
C'était la case de Toa-Ka-Magarow.
Et Claude Belissan, marchant toujours devant l'homme de la nature, descendit sur son indication dans une espèce de petit caveau assez proche de l'habitation du chef.
Claude Belissan fut enfermé dans le caveau.
Pendant huit jours, il n'eut pour société qu'une espèce de bambou, auquel on attachait une corbeille de jonc remplie de cocos et de fruits d'arbre à pain. Ce bambou arrivait et sortait par une petite fenêtre.
Pendant ces huit jours, les idées politiques et sociales de Claude subirent de bien nombreuses variations. Mais ces pensées sont tellement intimes que nous ne les développerons pas par discrétion.
Ces huit jours passés, on tira Belissan de sa cave, on le baigna, on le parfuma, on le tatoua, on lui serra le nez et les oreilles, on lui mit des bandelettes de toutes couleurs autour du front, on l'étendit sur une espèce de civière, et deux vigoureux sujets de Toa-Ka-Magarow le portèrent au sommet d'une montagne, sur laquelle était bâti un temple en roseaux.
Ils vont me canoniser à leur manière, ou jouer à colin-maillard, pensait Belissan qui n'y voyait plus, ayant les yeux cachés par des bandelettes, et commençait à perdre la tête de terreur.
Arrivés là, on mit Claude debout, et on l'attacha à un poteau.
Au-dessous du poteau était une auge de pierre.
Et on chanta une multitude d'hymnes, de cantiques et de prières.
Et Toa-Ka-Magarow, qui unissait le pouvoir théocratique au pouvoir despotique, fit quelques contorsions, et s'avança tout près de Claude Belissan, en brandissant un long poignard fait d'une arrête de poisson.
Et le sang du clerc coula dans l'urne.
Et à cette sensation aiguë, douloureuse et froide, Claude, par une rétroaction singulière de la pensée, vint à songer à sa petite chambre, et à cette pluie d'été qui avait seule déterminé la série de causes et d'effets qui l'amenait sous le couteau des anthropophages; et par une soudaine puissance intuitive, il put embrasser tout cet espace de temps en moins d'une seconde.
Et dans l'espèce de vertige fantastique qui le saisit, il lui sembla voir des chevaux danois, le grand coureur et Catherine qui tournoyaient autour de lui en poussant de singuliers cris.
Et il ne lui sembla plus rien.
Et ce fut fait de Claude Belissan, ex-clerc de procureur, homme de la nature, duquel les naturels de Hatouhougou se régalèrent, après avoir respectueusement offert ses oreilles à Toa-Ka-Magarow, comme la partie la plus délicate de l'individu.
L'ange est tombé,—l'homme est tombé,—et leur chute a fait voir que les substances mêmes spirituelles ne sont autre chose, par le fond même de leur nature, qu'un abîme flottant et ténébreux.
Confession de Saint-Augustin, liv. XIX, ch. 9.
Albert a dix-huit ans, et déjà le front d'Albert est triste et soucieux.
Il est pâle, et fuit les jeux et les compagnons de son âge.—Comme autrefois il n'attend plus, inquiet, le réveil de sa mère pour être le premier à lui sourire, et disputer ce doux privilège à sa sœur qu'il chérit pourtant.—Mais il pouvait tout céder à sa sœur, hors le premier baiser de sa mère; pour sa crédulité naïve, c'était un présage de bon, ou de mauvais jour.
Maintenant, dès que l'aube a blanchi les nombreuses tourelles du château, Albert monte son cheval favori,—jette en passant un regard sur les fenêtres fermées de l'appartement de sa mère,—soupire,—et pressant sa monture de l'éperon, franchit le vieux pont qui tremble, fait crier la grille sur ses gonds et gagne avec rapidité les bois sombres et touffus qui s'étendant au loin comme un vaste océan de feuillage, dont le vent fait aussi bruire et balancer les flots, qu'un soleil ardent nuance aussi de lumières changeantes.
Mais ainsi qu'une clarté vive et pure est douloureuse aux vues affaiblies par les larmes. Ainsi ces jours bleus et dorés de l'été, paraissent maintenant insupportables à l'âme sombre et chagrine d'Albert.
Les jours qu'il aimerait à cette heure, seraient les jours nébuleux de l'automne, où les feuilles rougies et desséchées par le vent tombent lentement une à une sur un sol humide; où les montagnes se dessinent au loin, noires sur un ciel gris; où les plaines dépouillées de leur riante couronne de trèfles verts ou de blés jaunissants, sont labourées par de tristes sillons bruns et glacés.
Aussi à défaut de cette nature pâle et décolorée que reflèterait si bien sa tristesse,—Albert recherche au moins le silence et l'obscurité de la forêt, les ténèbres profondes que traverse parfois la lueur incertaine d'un rayon de soleil.
Alors il éprouve une sorte de bien-être mélancolique, à se sentir ainsi isolé,—à entendre le chant monotone du ramier, venir se mêler seul, au bruit sonore et retentissant des pas de son cheval.
Alors Albert laissant flotter ses rennes—insouciant de son chemin, s'ensevelit dans une cruelle rêverie, et souvent ses sourcils contractés, la rougeur qui colore tout à coup ses beaux traits, annoncent que ce cœur d'enfant connaît déjà la souffrance.
La souffrance! quoi si jeune!—oui la souffrance,—car il sait ce que c'est qu'un remords.
Un remords, ce souvenir fatal de chaque minute de votre vie,—qui s'accouple à vos rêves, qui vous éveille en sursaut,... qui comme la main fatale du festin de Balthazar, s'écrit partout au sein du luxe et des fêtes, et s'accroupissant au fond le plus intime de votre âme, précipite ou suspend à son gré les battements de votre cœur.
Le remords, enfin, qui n'est pas un vain mot, Albert le sait bien.
Le remords!—Mais encore quel crime a-t-il commis,—ce pauvre enfant, si candide, si croyant aux nobles choses, si aimant et si doux,—si gracieux et si beau,—car la laideur de l'âme naît souvent des conséquences de la laideur du visage.
Encore une fois, quel crime Albert peut-il avoir commis,—lui élevé par une mère si tendre et si éclairée, qui par une incroyable puissance d'amour maternel s'était pour ainsi dire faite de son âge, de son sexe, pour deviner ses goûts, ses penchants et les diriger ou les combattre...
Oh! Albert commit une de ces fautes qu'on se reproche toute la vie, et sur lesquelles on ne peut pas plus étendre le voile épais de l'oubli, que l'on ne peut regagner un jour passé.
Une de ces fautes irréparables dont le souvenir au lieu de s'effacer avec l'âge s'envenime de plus en plus, et finit par devenir incurable.
Une de ces fautes contre lesquelles les lois n'ont pas de cours, parce que le coupable étant à la fois criminel, juge et bourreau, est encore abandonné aux mépris du monde, punition plus sanglante que la hache de l'échafaud.
Mais ne prenez pas ceci pour un paradoxe au moins! écoutez plutôt ce qu'il advint à Albert.
Il y avait bientôt un an de cela.
Une amie de la mère d'Albert étant venue passer l'été au château, avait amené avec elle sa fille,—Emma,—blonde, blanche et rose, avec de grands yeux noirs bien tendres, un pied furtif et une taille d'abeille, vive et folle comme un oiseau, parce qu'elle avait dix-sept ans, mais parfois rêveuse parce qu'elle allait en avoir dix-huit.
Et puis Emma avait été élevée dans un pensionnat à la mode, et puis sa mère qui ne l'aimait pas, allant beaucoup dans le monde, l'avait confiée aux soins d'une gouvernante.
Et puis encore Emma était de ces jeunes filles précoces, qui les yeux humides et voilés, font quelquefois à leurs amies de pension, d'amoureuses confidences à propos d'un rêve,... d'un souvenir, et toutes troublées leur demandent,—et toi?
Et puis enfin, Emma avait souvent lu, le soir, la nuit en cachette, de ces livres dangereux qui brûlent et enflamment des sens jeunes, par je ne sais quel parfum de volupté vive et pénétrante.—Pauvre, pauvre Emma, elle était née un siècle trop tard;—avec son caractère, sa naissance et sa figure,.. elle eut gouverné des royaumes.
On laissa la plus entière liberté aux deux enfants, c'est comme cela qu'on appelait Albert et Emma.
Était-ce imprudence ou calcul, ou connaissance intime du caractère d'Albert? je ne sais; mais ce qui devait arriver, arriva:—ils s'aimèrent.
Albert avec toute la foi, toute la candeur respectueuse de son âme pure;—Emma avec toute la curiosité inquiète d'une imagination vive et ardente.
Cette pauvre enfant, dévorée du désir de savoir, aurait en vérité fait une Ève bien commode, car elle eût commencé, je crois, par lutiner le Tentateur,—à en juger du moins par les agaceries enfantines qu'elle se permettait envers Albert, qui n'était pas un serpent.
Non, Albert n'était pas un serpent, car Albert élevé par une tendre mère dans des principes rigides, n'avait pas quitté le château depuis son enfance.
Albert pleurait en lisant Plutarque,—croyait à la vertu,—rougissait quand on lui demandait devant une femme, fût-ce sa mère, si une fois marié il désirerait des filles ou des garçons,—et s'étonnait parfois que les hommes fussent injustement privés, lors de leur union, du symbolique bouquet de fleurs d'oranger!...
On conçoit qu'avec cette pensée chaste et vierge, Albert ne comprenait pas d'autre bonheur que celui de regarder Emma,—d'entendre sa voix,—de marcher dans son ombre,—d'aimer la fleur qu'elle aimait,—et tout cela en silence de peur d'offenser Emma, tout cela en se maudissant, car ces deux mots toujours si distincts, amour et mariage n'en faisaient qu'un, selon l'admirable croyance de ce précieux jeune homme.
Or sa mère l'ayant prévenu qu'il ne se marierait qu'à vingt-cinq ans révolus, Albert se trouvait le plus grand misérable du monde d'oser aimer avant l'heure, et c'était un crime qu'il se fût bien gardé d'avouer à Emma, car il en rougissait trop lui-même.
Et qu'on ne vienne pas m'objecter que ce caractère si primitif, que cette organisation si candide soient exagérés!
Il est permis, je crois, au poète d'essayer de créer le type du beau, du parfait.—Il me semble louable d'imiter (hélas de bien loin), d'imiter Praxitèle, et de faire pour le moral ce que ce grand statuaire faisait pour le physique.—
De chercher avec acharnement dans notre égout social, çà et là, une vertu de l'âge d'or, une conscience limpide, un cœur tout débordant de belles croyances et de composer de tant de rares perfections un être à part,—un homme d'une pureté d'ange,—une manière d'Appollon moral, puis de le poser comme exemple, comme point de comparaison à tous les hommes corrompus ou égarés.
Si Albert n'eût pas été si beau, si doux, si aimable, malgré ses scrupules,—certainement Emma eût cessé d'effaroucher sa candeur de jeune homme par ses œillades agaçantes...—Mais Albert avait toutes ces qualités... et puis il aimait tant sa mère... il était si pieux... il savait si bien le grec... le latin... et puis...
Et puis il était seul.
Aussi Emma jura dans sa jolie petite tête qu'Albert serait forcé de lui avouer l'amour qu'il ressentait pour elle;—car quelle jeune fille,—quelle femme a jamais eu le courage de ne pas s'apercevoir qu'elle était adorée.
Un soir donc, après avoir chanté une délicieuse romance qu'Albert avait accompagnée,—Emma se trouvait seule avec lui dans le salon, le soleil était couché depuis longtemps, et l'obscurité commençait à envahir cette pièce.
Albert était resté au piano,—écoutant encore la voix ravissante d'Emma, quoiqu'elle ne chantât plus, et se laissant aller à une tendre et profonde rêverie.
Les femmes comme Emma aiment bien que leur amant rêve,—mais quand elles ne sont pas là.—Au bal,—dans le monde,—au milieu d'un cercle de jolies personnes coquettes et légères,—oh qu'il rêve alors... rien de mieux... mais en tête-à-tête—c'est à n'y pas tenir.—Aussi le pur Albert fut-il arraché à sa méditation par la pression d'une petite main qui s'appuya sur son épaule et par le son d'une jolie voix qui lui dit:
—A quoi pensez-vous donc,.. Albert?
Par une de ces anomalies psychologiques, par une de ces contradictions du cœur, par un de ces bizarres caprices de l'âme que l'homme n'expliquera jamais, Albert jusque là si timide répondit, sans doute emporté par une exaltation passionnée.
«—Je pense à vous, Emma!!!
«—Vrai... oh! si vous saviez quel plaisir vous me faites en me disant cela,... Albert, répondit-elle d'une voix émue...»
Et je ne sais non plus comment la main de la jeune fille descendit de l'épaule, pour s'arrêter sur la main d'Albert, qui frissonnant de tout son corps sentant l'impression électrique de cette peau douce et fraîche, s'écria...
«—Pardonnez-moi, Emma... je sais que je suis bien coupable...»
—Le fat,—pensait Emma en disant pourtant: «—je vous pardonne,.... Albert,..., mais répétez que vous pensez souvent à moi...»
—Et, comme elle avait, par pudeur, dit ces mots à voix basse, sa figure était tout proche de celle d'Albert, quand il s'écria de nouveau...—«J'y pense toujours à vous, Emma, malheureusement et malgré moi.... toujours!...
Je ne sais encore par quel nouveau hasard la bouche d'Emma se trouvait si près de la bouche d'Albert, quand il prononça ces derniers mots;—mais ce fut entre deux baisers qu'elle demanda: «—Albert, vous m'aimez donc... et qu'il répondit: «—Emma, pour la vie...»
Après quoi se levant brusquement, égaré, pâle, tremblant comme s'il venait de commettre un crime,—il se précipita hors du salon,—y laissant Emma radieuse, rose, animée, qui après un long soupir... murmura ce mot avec un accent de reconnaissance et d'espoir ineffable.
—Enfin!!!
Une fois seul dans sa chambre Albert se prit à penser à tout ce que sa conduite avait d'infâme, de déloyal, de lâche; il se reprocha vingt fois d'avoir séduit une jeune fille qu'il ne pouvait pas épouser de si long-temps, d'avoir abusé du droit sacré de l'hospitalité—pour faire sa déclaration bien avant le temps marqué pour que son notaire fît la sienne au notaire de sa future,—de s'être exposé enfin au mépris d'Emma;—car, combien Emma ne devait-elle pas mépriser un homme assez peu maître de ses passions pour oser insulter une innocente jeune fille par l'aveu d'un amour déshonnête...
Aussi, Albert ayant passé la nuit la plus affreuse, se décida à prendre un parti violent qu'il exécuta le lendemain.
Au point du jour il partit, après avoir demandé à sa mère la permission d'aller visiter un de ses grands oncles qui demeurait à la ville voisine,—promettant de revenir le soir même...
Le matin, Emma ignorant ce cruel départ,—Emma qui s'était endormie bercée par un doux rêve,—Emma se leva, plus heureuse, plus souriante que jamais,—tant elle comptait sur l'influence de ce baiser qu'elle avait presque ravi au chaste Albert.
Oh! qu'il y avait de joie puissante et intime épanouie dans l'âme de cette jeune fille qui aimait et qui se savait aimée;—comme elle grandissait à ses yeux,—comme elle méprisait ses compagnes qui n'en étaient peut-être encore qu'à l'amour filial,—comme elle répétait avec fierté ces jolis mots:—mon amant!—comme elle était plus belle.
Oui plus belle... Si vous l'aviez vue Emma,—comme elle embellissait sa toilette,—comme ses cheveux semblaient plus luisants, ses yeux plus vifs, sa taille plus souple, ses pas plus légers.
Si vous l'aviez vue, qu'elle était belle lorsqu'effleurant le gazon tout trempé d'une rosée odorante, elle marchait sans autre but que de marcher, de jouir du soleil, des fleurs, du Ciel, des arbres, que de respirer l'air du matin, que d'entendre les oiseaux bruire sous le feuillage—que de se sentir vivre, en un mot, tant la sève de cette jeune et ardente organisation était animée par cette pensée:—j'ai un amant.
Si vous l'aviez entendue fredonnant, je ne sais quel air improvisé sans doute, tant il était bizarrement coupé, là par des roulades brillantes,... ici par des accents de voluptueuse langueur.
Si vous l'aviez entendue, elle ne disait pas de paroles sur cet air singulier, et pourtant sa voix fraîche et sonore vibrait si éclatante que ces sons confus et sans suite paraissaient renfermer un sens... On eût dit un chant d'amour tout étincelant d'espoir, d'ardeur et de jeunesse.
Mais n'allez par maudire Emma.—Pauvre enfant, avait-elle jamais eu le cœur d'une mère pour cacher sa rougeur, ou répandre ces larmes amères que toute jeune fille pleure à quinze ans en demandant: pourquoi pleurai-je?...
Non, sa mère ne l'aimait pas, c'étaient des âmes de valets qui avaient reçu les chastes confidences de ses premières émotions;—c'étaient des mains mercenaires qui lui avaient donné les livres corrupteurs dont le poison la brûlait, cette pauvre Emma...
Ne la maudissez pas, c'était par chagrin qu'elle cherchait quelqu'un à aimer. Seulement, des principes froids et sévères n'avaient pu engourdir et glacer les sens neufs et irritables qu'elle avait reçus de la nature.
C'était au milieu de nos mœurs mystérieusement corrompues, une folle jeune fille qui agissait tout haut, au lieu d'agir tout bas comme les autres... Une adorable fille d'Otahity livrée à tout l'instinct de ses désirs, et ne connaissant pas de raisonnements capables d'empêcher son cœur de battre—quand il battait,—ni sa pensée—d'errer—quand elle errait.
C'était une de ces femmes nées pour régner au sérail, et se baigner sous les sycomores de Stamboul, amoureuse, impressionnable, colère, nerveuse, aimant la musique, mais faible et éloignée, aimant encore la molle paresse du Divan, la rêverie dans l'ombre;... fuyant le grand jour, et s'énivrant avec délices des parfums les plus forts;... mangeant à peine, aimant le bal à la fureur,... et bonne et secourable aux malheureux.
Encore une fois, ne maudissez pas Emma.—Telle que vous la savez,... n'est-elle pas assez à plaindre d'aimer Albert.
Aussi, qui pourrait exprimer ce que ressentit Emma lorsque le matin, elle, si heureuse,—elle apprit le départ d'Albert!
Elle bouda, pleura et maudit cette journée qu'elle s'était promise si belle.
Enfin, le soir, Albert revint, mais non pas seul, car le grand-oncle l'accompagnait. En vain Emma se plaça sur son passage, en vain Emma chercha son regard... elle n'obtint rien de lui qu'un froid salut,—qu'une marque de politesse glaciale...
Seulement, après une longue conférence qui dura près de deux heures,—et qui se passa entre Albert, sa mère et le grand-oncle; le digne jeune homme, le Bayard, le Scipion, s'approcha furtivement d'Emma qui, toute rêveuse, assise devant la fenêtre du salon, sa tête appuyée sur sa main, regardait les étoiles briller.—Le Bayard donc s'approcha d'Emma sans rien dire, lui glissa, ma foi, un billet sur les genoux, et s'échappa...
Son mouvement surprit Emma qui, baissant la tête, vit le bienheureux billet un peu grand il est vrai,—ployé à peu près comme une lettre de faire part;... mais pour Emma qu'importait la forme, je vous le demande,... la jeune fille plia, replia, surplia vingt fois cette énorme missive qui, écrite sur un papier épais s'ouvrait toujours, rebelle aux plissements que tâchaient de lui imprimer les doigts effilés d'Emma... Enfin elle parvint à grand'peine à glisser cette lettre colossale dans son sein palpitant.
Misérable Albert,... au lieu d'écrire sur un tout petit papier mince, soyeux, parfumé... d'écrire d'une écriture si fine, si fine, qu'Emma eût été forcée de baiser sa lettre en la lisant.
Misérable Albert, il écrit en jambages qu'un vieillard déchiffrerait à vingt pas sans lunettes,... il écrit sur un papier rude qui va peut-être écorcher par son grossier contact cette jolie gorge si rose et si blanche, ce frais et mystérieux asile où une femme dépose son secret le plus cher,—où elle enferme la pensée d'un amant, comme pour dire,—repose là,—pensée chérie,—billet adoré,—les battements précipités de mon cœur te diront si je pense à toi, pour toi et par toi...
Misérable, encore trois fois misérable Albert!
Mais après tout, il me semble que j'ai tort d'invectiver Albert,... est-il donc moins vertueux,—moins sage, moins délicat, moins homme de mœurs,—moins chaste,—moins vierge,—moins à genoux devant l'honneur des dames,—parce qu'il écrit en grosses lettres sur du gros papier.
Sa grande lettre aurait-elle fait plus de plaisir à Emma si elle eût été moins vaste,—non sans doute, à en juger par l'impatience qui agita la jeune fille jusqu'au moment où seule, retirée dans sa chambre, elle put ouvrir le délicieux billet.
Mais que pouvait contenir le billet?
Quand Emma eut renvoyé ses femmes tout étonnées qu'elle voulût se coiffer et se délacer elle-même,... la jeune fille tira peu à peu de son corset la lettre d'Albert et se mit à la déplier.
Puis soit qu'elle pensât qu'un tel travail serait bien long, soit qu'elle voulût mieux savourer le plaisir en le retardant... elle posa le gros vilain papier sous les dentelles de son oreiller et se déshabilla lentement.
Il y eut un instant où ses joues devinrent pourpres, ce fut au moment où debout devant sa glace, demi nue, elle élevait au-dessus de sa tête ses beaux bras blancs et arrondis, pour soutenir son épaisse et longue chevelure blonde.
Ainsi placée, éclairée à demi par la lueur des bougies placées derrière elle, qui trahissaient par un reflet doré les délicieux contours de ce corps charmant à travers les plis diaphanes de la batiste... Ainsi placée, Emma ne pouvant s'empêcher de se trouver belle, adorable, ne put pas non plus s'empêcher de rougir de plaisir et d'orgueil, ou peut-être même de modestie.
Et puis aussi il lui sembla qu'elle en aimait deux fois plus Albert; car il y a quelquefois dans le cœur des femmes de ces moments d'abnégation entière;—ils sont rares—où elles aiment leur amant en raison du bonheur et de l'ivresse dont elles peuvent le combler.
Emma se coucha donc, prit une bougie près d'elle et après avoir vingt fois approché ses jolies lèvres du rude papier, elle le déplia lentement, soupirant à de longs intervalles... souriant... s'arrêtant pour réfléchir une seconde et après continuer son travail avec ce soin minutieux, cette attention dévorante que met l'antiquaire à dérouler un précieux papyrus Syrien...
Enfin la lettre se déploya tout entière, et Emma lut bien facilement ce qui suit.
MADEMOISELLE,
«Je ne me serais jamais permis de vous écrire, si le motif qui me décide n'était licite et honorable,—pour vous donner toute confiance, pour vous engager à lire cette lettre en entier, Mademoiselle, je me hâte de vous dire que ma mère, que mon grand-oncle l'ont approuvée...
Emma s'arrêta, et eut bien envie de ne pas continuer; mais le dépit,—mais la curiosité,—la colère l'emportant, elle lut encore.
«J'ai été sur le point d'être bien coupable, Mademoiselle, mais heureusement que les principes solides que ma mère m'a donnés—m'ont arrêté à temps.—J'ai senti que j'allais vous aimer, que je vous aimais... j'ai même poussé l'audace jusqu'à vous l'avouer... avant de vous dire que mes vues étaient légitimes... avant de vous avouer que d'après les ordres de ma mère, je ne pouvais penser à me marier qu'à l'âge de vingt-cinq ans...—mais pardonnez ces détails à un malheureux égaré un instant et qui fuit loin de vous.
«Oui, Mademoiselle,—je pars,—je vais tâcher de vous oublier,—l'honneur et la vertu le commandent et je réussirai, j'en suis sûr;—plus tard je vous reverrai peut-être, assez fort pour ne rien craindre,—assez heureux pour vous rappeler le moment qui a failli nous être si fatal, et qui n'a au contraire servi qu'à faire sortir notre vertu plus pure et plus brillante de cette dangereuse épreuve.
«Adieu, Mademoiselle, j'emporte avec moi la conscience d'un noble sacrifice, d'une action honorable,—cette conviction consolante adoucira, je n'en doute pas, les regrets que j'éprouverai d'être éloigné de vous, et ma raison, et ma vertu les calmeront tout-à-fait.
«Agréez, Mademoiselle, l'assurance des sentiments respectueux avec lesquels j'ai l'honneur d'être,
«ALBERT DE NÉRIS.»
La pauvre Emma lut cette lettre,—en entier,—sans passer un mot,—une virgule,—avec l'attention désespérante qu'on met à lire une chose curieuse,—inusitée, singulière, originale.
Puis pâlissant de colère, elle froissa le papier dans ses petites mains, le jeta loin d'elle disant en pleurant:—Mon Dieu! comment se fait-il que j'aie aimé un pareil imbécile... que je l'aie aimé sans arrière-pensée, que je l'aime peut-être encore... Mon Dieu! comme je suis malheureuse. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le lendemain matin Albert partit sans voir Emma, pour se rendre chez son oncle,—au grand contentement de madame de Néris qui avait d'autres vues sur Albert, et qui trouvait d'ailleurs Emma beaucoup trop coquette pour ce fils chéri.
L'été, l'automne, l'hiver se passèrent.
Albert ne revint chez sa mère que huit mois après son départ.—Emma, comme on le pense bien, n'était plus au château, elle l'avait quitté avec sa mère trois mois après la vertueuse fuite du Scipion—à la fin de l'automne.
Comme toute première passion,—l'amour d'abord s'était fortement enraciné dans le cœur d'Albert,—et pendant les deux premiers mois de sa séparation avec Emma, il se trouva si malheureux,—que pour le distraire, le bon oncle le mena à Paris.
Albert n'ayant pas encore fait son académie, comme disait son vieux gentilhomme d'oncle, selon l'antique usage de nos pères.—Il l'envoya au manége, à la salle d'armes, au tir.
Là et dans quelques salons, Albert vit le monde, se forma, s'éclaira, se grisa même parfois, et enfin, poussé par je ne sais quel Méphistophélitique ami, il séduisit,—mais tout-à-fait et bien positivement,—il séduisit la maîtresse de son bon vieil oncle, qui s'était occupé d'une fort jolie figurante de l'Opéra.—Coin du roi—comme disait encore le vieux gentilhomme.
Entre nous, c'est le dépit du bon oncle qui causa, je crois, le retour un peu subit d'Albert, qui quitta Paris avec le regret que vous pouvez concevoir.
Quand sa bonne et sa tendre mère le revit,—elle le trouva changé, et commença par gémir comme mère;—mais comme femme elle ne put s'empêcher de dire:—il est bien mieux maintenant.
En effet Albert avait perdu cet heureux et mol embonpoint de l'adolescence élevée sous l'aile maternelle,—ces fraîches et vigoureuses couleurs qui dénotent une santé généreuse, une âme engourdie par une existence régulière et monotone.
Albert n'avait plus tout cela,—il était pâle maintenant, sa tournure était amincie, partant plus svelte, plus élégante,—ses joues un peu amaigries n'avaient plus cette rondeur couleur de rose qui le faisait ressembler à un chérubin, ses yeux avaient plus d'éclat, son sourire plus de malice.
Et puis il avait ramené deux beaux et vigoureux chevaux anglais,—pour remplacer le bon vieux poney pacifique sur lequel il s'aventurait parfois,—tremblant de tous ses membres...
Et maintenant il faisait frémir sa pauvre mère à chaque saut, à chaque bond qu'il exigeait audacieusement de sa monture, et dont il profitait avec une grâce parfaite.—Enfin Albert était parti candide comme,... la comparaison est difficile,... candide comme.... une jeune fille,.. oh! non,—j'y suis,—candide comme un vieux savant, et il revenait hardi et expérimenté comme un page de cour.
J'oserais même certifier au besoin que le changement était si grand chez Albert, que passant le long d'un corridor noir,—il serra très cavalièrement, ma foi, la taille d'une jolie femme de chambre de sa mère, en lui disant quelques mots si lestes que la pauvre fille... sourit et rougit en même temps.
Quand Albert se retrouva seul avec ses pensées,—elles se tournèrent naturellement vers Emma... Car maintenant il appréciait tout ce que valait cette jolie fille,... tout ce que surtout elle aurait pu valoir pour lui; Mais Albert n'était pas corrompu, et par cela même qu'alors il savait un peu le monde maintenant,—il éprouvait une sorte de satisfaction, de plaisir à avoir aidé Emma à échapper à la séduction;—une de plus,—une de moins, disait-il,—qu'importe,.. autrefois,.. j'en étais ravi, parce que je croyais que, dans le cas contraire, elle eût été une exception, et aujourd'hui j'en suis ravi encore,.. un peu moins peut être;.. enfin je suis à peu près consolé de ma vertu, en pensant qu'Emma est encore une exception... En sens inverse.—
Albert faisait ces judicieuses et morales réflexions, assis dans son fauteuil et nettoyant avec insouciance les nombreux tiroirs d'un antique secrétaire qu'il ouvrait pour la première fois depuis son retour, et dans lequel il se disposait à ranger quelques papiers.
Car pendant son absence,—un de ses amis ayant occupé sa chambre,—avait laissé de ces traces qu'on rencontre toujours à la suite des gens peu soigneux; ici un livre déchiré,—là des capsules pour amorcer un fusil,.. là un vieux gant...
Enfin Albert secouait chaque tiroir,—en disant de son ami, dont le moral lui paraissait connu;—diable d'Alexandre... pas plus d'ordre qu'à l'ordinaire,... toujours brouillon,... sans soin,... bon garçon au reste,.., qui m'effrayait beaucoup avec ses principes faciles et sa morale complaisante, avant ma conversion... Eh bien! avec tout cela il est imprudent, audacieux, laid, assez médiocre d'esprit, et c'est pourtant un homme qui, m'a-t-on dit, a des succès dans le monde,... auprès des femmes, je le conçois, il les obsède, il ne les quitte pas, il les entoure de tant de soins, qu'elles doivent enfin lui céder par amour,... ou pour s'en débarrasser;... mais,... tiens,... que vois-je donc, un petit papier,... une écriture de femme sans doute;—l'insouciant,... je le reconnais bien là,... et puis,... un autre... oh diable!... quel papier froissé, on dirait une pétition mal reçue et égarée dans la poche d'un ministre... Voyons donc,... est-ce que mon ami Alexandre... solliciterait?... Ah! mon Dieu!... s'écria Albert, en jetant la pétition avec violence.
Puis il prit le petit papier le déplia et lut avidement.
Après quoi il pâlit,—blasphéma horriblement, et trépigna comme un enfant en colère.
Voici pourquoi:
Le papier froissé,—c'était cette belle page de vertu et de dévouement qu'il avait autrefois écrite à Emma.
Le petit papier couvert d'une écriture de femme,—c'était une lettre d'Emma adressée à Alexandre,—qui s'était rencontré avec elle au château, et avec qui elle y était restée pendant trois mois, après la vertueuse fuite d'Albert.
Voici quelle était la lettre d'Emma:
«Tu m'as demandé encore un sacrifice, mon Alexandre,—et je croyais n'en avoir plus aucun à te faire.—Tu veux donc lire ce chef-d'œuvre d'innocence et de candeur dont nous avons tant ri,—le voici, après l'avoir lu, déchire-le, ou plutôt garde-le... S'il te prenait jamais fantaisie de séduire une pauvre jeune personne, relis cette page édifiante, tâche de te bien pénétrer de la sublime morale qu'elle respire,—et si tu parviens une fois à te mettre à cette hauteur de pureté d'émotions, je te verrai sans crainte auprès d'une rivale.
«Pourtant pour te punir de ta jalousie, sans motif, je dois t'avouer qu'il était spirituel et beau comme un ange, et que je l'aurais peut-être aimé à la folie;—mais il avait malheureusement un vice que nous ne pardonnons jamais en amour, la vertu.
«Mais, vous, qui n'avez peut-être que la vertu contraire,—rassurez-vous,—adieu,—à cette nuit,—maudite lune qui se couche si tard...»
Voilà ce qui fit pâlir si soudainement Albert, voilà pourquoi nous répéterons ce que nous avons dit au commencement de ce conte.
—«Albert est rongé par un cruel remords,» parce qu'Albert a commis une de ces fautes qu'on se reproche toute la vie,—sur lesquelles il n'est pas plus possible d'étendre le voile de l'oubli, qu'il n'est possible de regagner un jour passé.
Une de ces fautes irréparables dont le souvenir, au lieu de s'effacer avec l'âge, s'envenime de plus en plus, et devient incurable,—une de ces fautes contre lesquelles les lois n'ont pas de cours,—parce que le coupable étant à la fois, son juge et son bourreau,—est encore livré,—quand sa conduite est connue,—au mépris et aux railleries du monde,—punition souvent plus sanglante que la hache du bourreau.
Aux railleries du monde,—oui ceci n'est malheureusement pas un paradoxe, oui au mépris du monde, soyez de bonne foi, qu'on vous montre l'Albert vertueux, qu'on vous dise: Vous voyez bien ce frais et beau garçon, si bien portant, si vermeil, si bien nourri. Eh bien... il s'est trouvé une fois,—une jeune fille, jolie comme un ange, passionnée, qui lui a fait des avances beaucoup par curiosité,—et encore plus par désir;—figurez-vous qu'assez béni du ciel pour rencontrer un trésor pareil,—une jeune fille de bonne compagnie, aussi délicieusement mal élevée... qui d'un mot pouvait être à lui... toute à lui... une jeune fille, dont le premier il a fait battre le cœur... figurez-vous que cet Albert trouvant cela... a résisté, a fait le Scipion, et que le lendemain d'un baiser que la petite lui avait à peu près ravi, il s'est sauvé pour ne pas succomber!!!...
Eh bien le monde dira c'est un sot, un animal,—un niais,—je n'en voudrais pas pour mon ami, tout au plus pour mon intendant, ou pour mon notaire,—à la bonne heure.
Voilà ce que dira le monde, cette majorité de la société qui seule fait la représentation,—classe ce qui est bien ou mal,—reçu ou blâmé.
Ce monde enfin par lequel et pour lequel on vit—méprisera profondément le vertueux Albert,—le méprisera comme homme du monde,—et on a beau dire, on n'accepte que les jugements de ce monde-là,—on y compte,—on y croit,—on s'en pare, et d'être réputé un homme bien moral par un épicier, si même les épiciers croient encore à la vertu—ne dédommagerait pas des sarcasmes et des railleries de ce monde.
Maintenant qu'on dise à ce même monde:—l'Albert d'autrefois a quelque peu vécu.——Il arrive, et trouve une lettre qui lui apprend qu'un autre, laid, bête, vain et insolent, a joui de ce qu'il a refusé.—Aussi maintenant, Albert est poursuivi d'un remords atroce, cuisant, profond; car il ne se pardonne, ni ne se pardonnera jamais sa sottise, car il a toujours devant les yeux—ces charmes ravissants qui pouvaient être à lui—et qu'il a refusés, par je ne sais quelle sotte susceptibilité.—Maintenant, Albert cherche la solitude, poursuivi encore une fois par ce remords implacable.
Le monde répondra:—cela prouve qu'il a au moins le sens commun.—Péché avoué est à moitié pardonné;—qu'il ne recommence plus, et l'on verra... Mais par Dieu, il aura fort à faire pour faire oublier une pareille énormité.
Oui, voilà ce que dira le monde et ce qui m'oblige à conclure par cet aphorisme qui est peut-être désolant,—mais qui avant tout est vrai, je crois.—
—On se repent toujours du bien qu'on a fait,—et l'on regrette souvent le mal qu'on aurait pu faire,—ou mieux,—disons avec la Rochefoucault.—
Le mal que nous faisons ne nous attire pas tant de persécution et de haine, que nos bonnes qualités.
......Ayant obtenu de mon amiral un congé de quelques mois, je visitais alors en curieux tous les ports de la Manche, qui dans notre dernière guerre avec les Anglais, ont fourni une si grande quantité d'intrépides corsaires.
J'étais fort jeune alors, et comme je n'avais jamais vu de corsaire, j'aurais tout donné au monde pour en voir un, mais un vrai, un type, le blasphème et la pipe à la bouche, fumant de la poudre à défaut de tabac, l'œil sanglant, et le corps couvert d'un réseau de cicatrices profondes à y fourrer le poing.
Comme dans une de mes stations sur la côte, j'exprimais ce naïf désir à un ami de ma famille, homme fort aimable et fort spirituel auquel j'étais recommandé, il me dit:—Eh bien! demain je vous ferai dîner avec un corsaire.—Un corsaire! lui fis-je—Un vrai corsaire reprit-il, un corsaire comme il y en a peu, un corsaire qui à lui seul a fait plus de prises que tous ses confrères depuis Dunkerque jusqu'à Saint-Malo.
Je ne dormis pas de la nuit, et le jour me parut démesurément long, quoique j'eusse essayé de lire Conrad, de Byron, pour me préparer à cette sainte entrevue.
A cinq heures j'arrivai chez mon ami. C'est stupide à dire, mais j'avais presque mis de la recherche dans ma toilette. En entrant je trouvai à mon hôte un aspect soucieux qui m'effraya, et je frémis involontairement.
—Notre corsaire ne viendra qu'à la fin du dîner, me dit-il; il est en conférence avec le capitaine du port.—Hélas! j'attendrai donc, répondis-je, en sentant mon cœur se rasséréner.
On se mit à table. J'étais placé à côté de la femme de mon hôte, et, à ma droite, j'avais un monsieur de soixante ans, qui paraissait fort intime dans la maison, et qu'on appelait familièrement Tom.
Ce monsieur, fort carrément vêtu d'un habit noir qui tranchait merveilleusement sur du linge d'une éblouissante blancheur, ce monsieur, dis-je, avait une franche et joviale figure, l'œil vif, la joue pleine et luisante, et un air de bonhomie répandue dans toute sa personne qui faisait plaisir à voir. Il me fit mille récits sur sa ville dont il paraissait fier, me parla des embellissements projetés, de la rivalité de l'école des frères et de l'enseignement mutuel, et finit par m'apprendre, avec une sorte d'orgueilleuse modestie, qu'il était membre du conseil municipal, capitaine de la garde nationale, et qu'il jouissait même d'un certain crédit à la fabrique. Je le crus sur parole. Ces détails m'eussent prodigieusement intéressé dans toute autre circonstance; mais, je dois l'avouer, ils me paraissaient alors monotones, dévoré que j'étais du désir de voir mon corsaire. Et mon corsaire n'arrivait pas. En vain notre hôte, par une charitable attention, et dans le but de me distraire, s'était mis à taquiner M. Tom sur je ne sais quelle fontaine qui tombait en ruines quoique lui, Tom, fût spécialement chargé de la surveillance de ce quartier. Je ne retirai de ce charitable procédé de mon hôte que cette conviction: que M. Tom, au nombre de ses autres qualités sociales et municipales, joignait le caractère le plus doux, le plus gai et le plus conciliant du monde.
On servit le dessert. Les gens se retirèrent: j'étais désespéré; n'y tenant plus, je m'adressai d'un air lamentable à l'amphitrion.—Hélas! votre corsaire vous oublie, lui dis-je.—Quel corsaire? dit M. Tom, qui cassait ingénument des noisettes.—Mais le commissaire de marine que j'avais invité, dit mon hôte en riant aux éclats de cette bêtise.
J'étais rouge comme le feu, et pardieu si colère qu'il fallut la présence des deux femmes pour me contenir.
Je ne sais où ma vivacité allait m'emporter, lorsque pour toute réponse, je vis mon hôte sourire en regardant les autres convives, qui sourirent aussi. J'en excepte pourtant M. Tom, qui devint rouge jusqu'aux oreilles, et baissa la tête d'un air honteux.
Il n'y a que cet honnête bourgeois qui soit indigné de cette scène ridicule, pensai-je en vouant un remercîment intime au digne conseiller municipal.
—C'est assez plaisanter, Monsieur, me dit alors l'hôte d'un air sérieusement affectueux; excusez-moi si j'ai ainsi usé ou abusé de ma position de vieillard pour vous mettre à l'abri des impressions calculées à l'avance, car, grâce à ces préventions, Monsieur, on juge mal, je crois, les hommes intéressants. Oui, quand on les rencontre tels qu'ils sont au lieu de les trouver tels qu'on se les était figurés, votre poésie s'en prend quelquefois à leur réalité, et par dépit d'avoir mal jugé, vous les appréciez mal, ou vous persistez dans l'illusion que vous vous étiez faite à leur égard.
Je regardai mon hôte d'un air étonné. J'avais seize ans; il en avait 60, et puis je trouvai tant de raison et de bienveillante raison dans ce peu de mots, que je ne savais trop comment me fâcher.
—Une preuve de cela, ajouta-t-il, c'est que si tout à l'heure je vous avais montré notre corsaire, en vous disant: le voici, vous eussiez, j'en suis sûr, éprouvé une tout autre impression que celle que vous avez éprouvé, et pourtant cet intrépide dont je vous ai parlé est ici au milieu de nous, il a dîné avec nous.—Je fis un mouvement.—Je vous en donne ma parole dit mon hôte d'un air si sérieux que je le crus.
Alors je promenai mes yeux sur tous ces visages, qui s'épanouirent complaisamment à ma vue, mais rien du tout de corsaire ne se révélait.
—Regardez-nous donc bien, me dit M. Tom avec un rire singulier.
Alors mon hôte me dit, en me désignant M. Tom de la main:—J'ai l'honneur de vous présenter le capitaine Thomas S....—Le capitaine S...! vous êtes le brave capitaine S...? m'écriai-je, car le nom, l'intrépidité et les miraculeux combats de l'homme m'étaient bien connus, et je restai immobile d'admiration et de surprise: mon cœur battait vite et fort.
—Eh! mon Dieu oui, je suis tout cela... à moi tout seul, me dit le corsaire, en continuant d'éplucher et de grignoter ses noisettes.—Vous êtes le capitaine S...? dis-je encore à M. Tom en le couvant des yeux, et m'attendant presque à voir depuis cette révélation, le front du conseiller municipal se couvrir tout-à-coup des plis menaçants, son œil flamboyer, sa voix tonner...
Mais rien ne flamboya, ne tonna; seulement le corsaire me dit avec la plus grande politesse:—Et je me mets à vos ordres, Monsieur, pour vous faire visiter la rade et le port.
Après quoi il se remit à ses noisettes. Il me parut trop aimer les noisettes pour un corsaire.
En vérité, j'étais confondu, car, sans trop poétiser, je m'étais fait une tout autre figure de l'homme qui avait vécu de cette vie sanglante et hasardeuse. Je ne pouvais concevoir que tant d'émotions puissantes et terribles n'eussent pas laissé une ride à ce front lisse et rayonnant, un pli à ces joues rieuses et vermeilles.
Mon hôte voyant mon étonnement dit au corsaire: «Oh! maintenant il ne vous croira pas, Tom; pour le convaincre, parlez-lui métier, ou mieux, racontez-lui votre évasion de Southampton.»
Ici le capitaine Tom fit la moue.
Sur mon observation, mon hôte n'insista pas, et je me mis à causer avec le capitaine, serein et placide, de quelques-uns de ses magnifiques combats avec lesquels nous avons été bercés, nous autres aspirants.
Cette attention de ma part flatta le capitaine Tom, la conversation s'engagea entre nous deux; il me donna même quelques détails sur la façon de combattre, mais tout cela d'un air, d'un ton doux et calme qui faisait un singulier contraste avec la couleur tragique et sombre du sujet de notre conversation.
Entre autres choses, je n'oublierai jamais que, lui demandant de quelle manière il abordait l'ennemi, il me répondit tranquillement en jouant avec sa fourchette: «Mon Dieu je l'abordais presque toujours de long en long, mais j'avais une habitude que je crois bonne et que je vous recommande dans l'occasion, car c'est bien simple,» ajouta-t-il à peu près du ton d'une ménagère qui hasarde l'éloge d'une excellente recette pour faire les confitures; «cette habitude, reprit-il, la voici: au moment où j'étais bord à bord de l'ennemi, je lui envoyais tout bonnement ma volée complète de mousqueterie et d'artillerie bourrée à triple charge. Eh bien, vous n'avez pas d'idée de l'effet que ça produisait,» ajouta le capitaine en se tournant à demi de mon côté et secouant la tête d'un air de conviction.
—Je pris la liberté d'assurer au capitaine que je me faisais parfaitement une idée de l'effet que devait produire cette excellente habitude qui, dans le fait, était bien simple.
—Bah!... Tom fait le crâne comme ça, dit mon hôte d'un air malin, il ne vous dit pas qu'il a peur des revenants!
—Oh! des revenants! dit joyeusement Tom en remplissant son verre d'excellent curaçao.
—Des revenants, reprit mon hôte, enfin l'homme aux yeux mangés ne vous visite-t-il jamais, Tom?...
La figure du capitaine prit alors une bizarre expression: il rougit, son œil s'anima pour la première fois, et, posant son verre vide sur la table, il me dit en passant la main dans ses cheveux gris et découvrant son large front: «Aussi bien il veut me faire raconter mon évasion de Southampton; cette diable d'aventure s'y rattache. Écoutez-moi donc, jeune homme.»
—Ah çà, Tom, songez à ces dames, dit mon hôte, en montrant sa femme et une de ses amies.
—Ma foi, dit le capitaine, si la chaleur du récit m'emporte, figurez-vous bien, Mesdames, qu'au lieu du mot il y a des points.
Je ne sais si ce fut une illusion, ou l'effet du curaçao réagissant sur le capitaine, ou le charme sombre et magique que jette sur tout homme ce fier nom de corsaire qu'on lui a écrit au front..., toujours est-il que lorsque le capitaine commença son récit, il s'empara de l'attention par un geste muet de commandement. Il me sembla un homme extrêmement distinct du conseiller municipal.
Le capitaine commença donc en ces termes:
«C'était dans le mois de septembre 1812, autant que je puis m'en souvenir. Il ventait un joli frais de nord-ouest, j'avais fait une pas trop mauvaise croisière, et je m'en revenais bien tranquillement à Calais grand largue avec une prise, un brick de 280 tonneaux, chargé de sucre et de bois des îles, lorsque mon second, qui le commandait, signale une voile venant à nous. Je regarde; allons bien... Je vois des huniers grands comme une maison: c'était une frégate du premier rang. Le damné brick marchait comme une bouée, je donne ordre à mon second de forcer de voiles, et je commence à couvrir mon pauvre petit lougre d'autant de toile qu'il en pouvait porter; il était ardent comme un démon, et ne demandait qu'à aller de l'avant; aussi voilà que nous commençons à prendre de l'air..... et à filer ferme..., ce qui n'empêcha malheureusement pas la frégate d'être dans nos eaux au bout de trois quarts-d'heure de chasse.
«Pour me prier d'amener, elle m'envoya deux coups de canon qui me tuèrent un novice et me blessèrent trois hommes.
«Pour la forme, seulement pour la forme, je lui répondis par ma volée à mitraille, qui pinça une demi-douzaine d'Anglais; c'était toujours ça, et tout fut dit. Je fus genoppé, mais par exemple traité avec les plus grands égards par le commandant anglais qui avait entendu parler de moi, c'était la troisième fois qu'on me faisait prisonnier, mais j'avais toujours eu le bonheur de m'échapper des pontons.
«Nous ralliâmes Portsmouth et nous y arrivâmes à peu près à l'heure à laquelle je comptais rentrer à Calais. Oui, au lieu d'embrasser ma mère et mon frère, de conduire ma prise au bassin et de coucher à terre, j'allai droit vers un ponton, et peut-être pour y rester longtemps. C'était dur; mais alors j'étais entreprenant, j'étais jeune et vigoureux, j'avais une bonne ceinture remplie de guinées, et par-dessus tout une rage de France qui me rendait bien fort, allez. Aussi quand le commandant devant tout son animal d'état-major, me fit un grand discours pour me dire que désormais j'allais être serré de près..., mis dans une chambre à part, surveillé à chaque minute..., que c'était ma vie que je jouais en tentant de m'évader....; enfin une bordée de paroles superbes, je ne lui répondis, moi, pas autre chose que je m'en....»
«Tom..., Tom...., s'écria fort heureusement mon hôte...., car le capitaine, dans la chaleur du récit, avait déjà fait entendre certaine consonne sifflante qui annonçait un mot des plus goudronnés.
«—Mais c'est que c'était vrai, c'est comme je vous le dis, reprit le capitaine, je m'en....
«—Tom, s'écria encore mon hôte, ce n'est nullement votre véracité que j'interromps; mais songez à ces dames, Tom!
«—Ah! tiens, c'est vrai, reprit le capitaine.—Eh bien! non, je dis au commandant: Je m'en moque. Je m'évaderai tout de même.—Nous verrons, répondit l'Anglais.—Je l'espère bien, lui dis-je. Et on m'envoya à Southampton-Lake, à bord du ponton la Couronne.
«Southampton-Lake est un assez grand lac, situé à environ quinze lieues de Portsmouth; ce lac n'a d'autre issue qu'un étroit chenal, ce chenal débouche dans un bras de mer qui court du N.-O. au S.-E., et ce bras de mer après avoir formé les rades de Portsmouth, de Spithead et de Sainte-Hélène, se jette enfin dans la Manche, après avoir contourné les îles Portsea, Haling et Torney.
«Je ne vous donne tous ces détails qu'afin de vous faire voir que ce diable de lac était une position inexpugnable, et, à cause de cela même, parfaitement choisie pour servir de mouillage à une douzaine de pontons qui renfermaient alors quelques milliers de prisonniers de guerre français, au nombre desquels j'allais me trouver, et au nombre desquels je me trouvai bientôt comme je vous l'ai dit, à bord de la Couronne, vaisseau de 80 rasé.
«Ce ponton était commandé par un certain manchot, nommé Rosa, un malin, un fin matois s'il en fût, beau, jeune et brave garçon d'ailleurs, qui avait perdu un bras à Trafalgar, et exécrait autant les Français que moi les Anglais: c'était de toute justice, je ne pouvais lui en vouloir pour cela, il était de son pays et moi du mien.
«Le premier jour que je vins à bord, il me fit voir son ponton dans tous ses détails, ses grilles, ses serrures, ses pièges, ses trappes, ses verrous, ses barres, les rondes qu'on faisait tous les quarts-d'heure, les visites, les sondages qui ne laissaient pas une minute de repos aux murailles de ce pauvre vieux navire. Puis il finit par m'annoncer qu'en outre de ces précautions, j'aurais encore à mes trousses et à mes ordres un caporal qui ne me quitterait pas plus que mon ombre, afin, disait-il d'un air gouailleur, que mes moindres désirs fussent prévenus.
«Cependant, ajouta-t-il, si vous vouliez me donner votre parole d'honneur de ne pas chercher à vous évader, capitaine, je vous laisserais libre d'aller à terre tous les jours, et, à bord, votre chambre ne serait jamais visitée.
«Vous êtes trop aimable, lui dis-je, mais je ne veux pas vous donner cette parole-là; parce que, voyez-vous, le soir et le matin, la nuit et le jour, je n'ai qu'une pensée, qu'une idée, qu'une volonté, celle de m'évader.—Vous avez bien raison, et j'en ferais tout autant à votre place, me répondit le manchot; seulement je vous préviens d'une chose, c'est que vous me piquez au jeu, et que pour vous retenir tout moyen me sera bon.—Mais c'est trop juste, lui dis-je, puisque tout moyen me sera bon pour me sauver.
«Le fait est que pour se sauver c'était bien le diable. Figurez-vous que tous les sabords ou ouvertures qui donnaient du jour dans les batteries étaient grillés, regrillés et surgrillés de telle sorte, qu'on ne pouvait songer à y passer, d'autant plus que ces barreaux étaient visités cinq à six fois par jour, et autant de fois par nuit; en admettant même que vous eussiez pu passer par un de ces sabords, il régnait au-dessous une espèce de petit parapet qui faisait le tour du navire, et sur cette galerie se promenait continuellement des sentinelles. Or, dans le cas où vous auriez échappé à ces sentinelles, vous n'eussiez pas échappé aux rondes de canots armés qui, la nuit, se croisaient dans tous les sens autour des pontons. Enfin, eussiez-vous même eu ce bonheur, il vous fallait encore gagner à la nage les rives de ce lac, qui étaient environ éloignées d'une lieue et demie de tous les côtés du ponton.
«Ce n'est pas tout, si l'eau de ce lac eût été partout profonde ou guéable, quoique extrêmement hasardeux, un tel trajet eût été possible; mais ce qui le rendait presque impraticable, c'est que pour aller à terre il fallait absolument traverser trois bancs d'une vase épaisse, molle et gluante, dans laquelle on ne pouvait ni nager, ni marcher...
«Aussi, à vrai dire, ces bancs de vase faisaient-ils, en partie, la sûreté des pontons.
«L'espionnage aussi servait assez les Anglais, vu qu'il y a des gredins partout, et plutôt sur les pontons qu'ailleurs, car la misère déprave; et sur dix évasions manquées, il y en avait toujours neuf qui avortaient par la trahison de faux-frères.
«Les prisonniers avaient bien essayé de remédier à ces désagréments en massacrant, avec des circonstances assez bizarres, que je tairai d'ailleurs à cause de ces dames (ajouta fort galamment le capitaine), en massacrant, dis-je, les traîtres qui les vendaient, lorsque les commandants anglais ne les retiraient pas assez vite du bord; mais rien n'y faisait, et la délation allait son train, parce que les Anglais la payaient bien.
«J'étais donc depuis huit jours à bord de la Couronne, lorsqu'un matin on apprend qu'un nommé Dubreuil, un matelot de mon pays, assez mauvais gueux du reste, s'était évadé pendant la nuit, ayant, à ce qu'il paraît, trouvé moyen de se cacher le soir dans une grande chaloupe de ronde. Une fois l'embarcation poussée au large, comme le temps était noir, on le prit pour un matelot de service; puis, quand il vit le moment favorable, il se jeta à l'eau, plongea et disparut sans qu'on ait jamais pu parvenir à le rejoindre.
«Vous concevez si cette nouvelle irrita mon désir de m'échapper à mon tour; mais je ne trouvais personne de sûr à qui me confier, et je ne voulais rien hasarder par les motifs que je vous ai dit, lorsque ma bonne étoile amena, comme prisonnier à bord de la Couronne, un capitaine corsaire de mes amis, gaillard solide, entreprenant....., un homme enfin.
«Dès que nous nous fûmes reconnus, nous comprîmes tout de suite, sans nous le dire, qu'il fallait surtout laisser ignorer cette rencontre au commandant: aussi j'eus toujours l'air d'être plutôt mal que bien avec Tilmont. (C'est comme ça qu'il s'appelait.)
«Tilmont avait avec lui un vieux matelot, nommé Jolivet, dont il était sûr, car ils naviguaient ensemble depuis 20 ans; nous convînmes de nos faits, et huit jours après la fuite de Dubreuil, jour pour jour, les choses étaient en bon train.
«Le matin de ce jour-là, le manchot me fit appeler dans sa chambre, il était radieux, pimpant et se carrait en se frottant le menton plutôt d'un air à se faire casser les reins..... que souhaiter le bonjour:—Capitaine, me dit-il, vous avez voulu jouer gros jeu contre moi, vous avez perdu; c'est malheureux, une autre fois choisissez mieux vos confidents.
«Comment cela? lui dis-je sans me déconcerter.
«Oui, reprit-il en époussetant son collet d'un air dégagé, oui, vous deviez vous sauver demain ou après par un trou fait à la muraille de la coque du navire, à bâbord près du Black Hole; c'est un nommé Jolivet qui faisait le trou, vous lui aviez donné dix louis pour le faire, il m'a demandé quinze guinées pour me le vendre, et je les lui ai donné bien vite; car, en vérité, c'était pour rien.
«Comme bien vous pensez, j'étais exaspéré et j'aurais étranglé Jolivet, si je l'avais tenu. Une fuite si bien ménagée! disais-je au manchot en trépignant, une fuite à son heure! sur le point de réussir!... etc., etc.
«Je conçois que c'est désolant, me répondit le scélérat d'Anglais; mais, pour vous consoler, capitaine, buvons un verre de Madère à votre prochaine évasion.
«Que voulez-vous, lui dis-je, c'est à refaire... heureusement qu'il reste de la muraille à percer. Et comme après tout il n'y a pas de quoi se tuer pour cela, nous bûmes à la prochaine, et nous allâmes nous promener dans la batterie basse.
«J'étais ou plutôt j'avais l'air navré, désespéré, tandis que le manchot n'avait jamais été plus gai; il ricanait, il sifflait, il roucoulait en chantant faux comme un Anglais qu'il était, enfin il ne pouvait cacher sa joie d'avoir fait rater ma fuite, et il était bien certainement dans son droit.
«Comme nous nous promenions depuis une demi-heure dans la batterie basse, lui toujours guilleret, moi toujours triste, un tapage infernal partit au-dessus de notre tête, dans la batterie de 18, et interrompit notre conversation qui n'était pas vive.
«Qu'est-ce que cela? demanda le commandant à un aspirant qui descendait.
«—Commandant, ce sont les prisonniers qui dansent; il y a bal là-haut comme tous les jours.
«Est-ce que ne voilà pas ce gueux de manchot qui s'avisa de dire: Faites cesser, Monsieur; cette joie est inconvenante de la part des prisonniers, le jour où l'un d'eux a vu son projet de fuite avorter... faites cesser aujourd'hui, Monsieur.
«Et avant que j'aie pu l'en empêcher, le chien d'aspirant remonte, et ce bruit qui tonnait à nous étourdir, cesse à l'instant.
«Alors, je l'avoue, malgré moi je pâlis comme un mort, car au moment où la danse cessa, un léger bruit, heureusement imperceptible pour tout autre que pour moi, se fit entendre derrière la cloison qui formait la chambre de Tilmont, chambre sur le plafond de laquelle les danseurs paraissaient sauter le plus volontiers. Ce léger bruit, qui ressemblait au cri d'une scie, dura à peine une seconde après que la danse n'ébranla plus le plancher de la batterie; mais, comme je vous l'ai dit, cette seconde suffit pour me faire un damné mal; on m'eût scié le cœur que ça n'eût pas été pire.
«Heureusement le manchot prit cette pâleur pour celle de la colère, car aussitôt je m'écriai furieux: Et moi, Monsieur, je m'oppose à cela: punir ces pauvres gens parce que j'ai été assez sot pour me laisser surprendre, ce n'est pas juste; vous voulez me faire haïr de mes compatriotes, c'est une lâcheté, Monsieur, entendez-vous, une lâcheté; et si vous êtes homme d'honneur, vous leur permettrez de recommencer leur danse.
«—Calmez-vous, capitaine, me dit obligeamment le manchot; je vais moi-même leur en donner l'autorisation.
«Et la brute, le sot, le triple sot de manchot d'Anglais, y alla lui-même..... concevez-vous, lui-même..... s'écriait le capitaine en bondissant sur sa chaise, et tapant dans ses mains avec une joie frénétique et des éclats de rire qui nous stupéfiaient.
«Je vais vous expliquer pourquoi je ris tant à ce souvenir, ajouta-t-il en se calmant, c'est que vous ne savez pas une chose... Ces hommes qui dansaient, c'était moi qui, depuis huit jours, les payais vingt sols par tête pour danser et faire un train d'enfer au-dessus de la chambre de ce pauvre Tilmont, sous le prétexte de l'embêter, mais dans le fait, afin qu'on n'entendît pas le bruit qu'il faisait, en me creusant, pendant ce temps-là un trou dans la muraille du navire, qui formait un des côtés de sa cabane.
«C'est que la trahison de Jolivet était convenue entre lui, moi et Tilmont, et qu'il n'avait vendu le trou qu'il m'avait fait que pour détourner l'attention, et renforcer nos fonds des quinze guinées que le manchot lui avait données pour sa trahison. C'est qu'enfin, pendant cette nuit même je devais m'évader, car le trou de Tilmont était à peu près fini, et les vents paraissaient devoir souffler vigoureusement du N.-O., ce qui nous annonçait une nuit sombre et orageuse.
«Comme je vous l'ai dit, cela se passait huit jours après l'évasion de Dubreuil; mon faux trou avait été vendu, la danse avait recommencé, et j'avais le désespoir sur le front et la France dans le cœur...; car Tilmont venait de m'avertir par un signe convenu que le trou était tout-à-fait fini.
«J'allais monter sur le pont pour voir encore d'où se faisait la brise, lorsque j'entendis le bruit du sifflet du maître, qui appelait tout le monde en haut.
«Au même instant, un timonier vint me prévenir que le commandant me demande sur la dunette.
«Je n'y comprenais rien, je monte tout de même; mais qu'est-ce que je vois? l'état-major anglais en grand uniforme, les troupes sous les armes, les prisonniers rangés sur les gaillards, et, comme d'habitude, sous le feu de quatre canonnades chargées à mitraille.
«Le commandant Rosa avait un air grave et solennel que je ne lui connaissais pas. Il se tenait debout: à ses pieds était un hamac posé sur le pont et recouvert d'un pavillon noir.
«Le manchot ordonna de battre un ban; et quand les tambours eurent cessé de rouler, il dit en français:
«Il y a huit jours qu'un des prisonniers de ce ponton s'est évadé. ARRIVÉ AUX BANCS DE VASE, il y est resté engagé. Or, voici ce qui lui est arrivé. Puis, se tournant vers moi: Capitaine, me dit-il, voyez donc si par hasard vous ne reconnaîtriez pas ce camarade? Et en disant ces mots, il écarte d'un coup de pied le pavillon qui couvrait le hamac. Alors je vois un cadavre tout nu, très gonflé, et d'une couleur verdâtre; mais ce qu'il y avait d'horrible, c'était sa figure toute déchiquetée, et surtout les orbites sanglants de ses yeux, qui étaient vides; ils avaient été mangés par les corbeaux...
«A voir ce visage en lambeaux, desséché par le soleil, il était clair que ce malheureux, enfoui dans une vase épaisse et visqueuse, n'avait pu s'en tirer; que plein de force de vie il y avait attendu la mort pendant des jours!! et que peut-être à la fin de son agonie, en voyant les oiseaux de proie tourner sur sa tête, il avait pu prévoir ce qui l'attendait!...
«Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il m'est impossible de rendre l'impression que fit la vue de ce cadavre sur l'équipage et sur moi-même. Mon sang ne fit qu'un tour, je l'avoue; car la première pensée qui me vint, fut que, pendant la nuit, j'allais avoir la même vase à traverser, et que le même sort m'attendait peut-être. Mais comme j'ai toujours eu assez d'empire sur moi, je me contins; et quand le maudit manchot, après avoir regardé tout le monde pour juger de l'effet que ça produisait, se retourna de mon côté et me dit de nouveau, Eh bien! capitaine, reconnaissez-vous ce camarade?
«Je croisai mes mains derrière mon dos, et je lui dis d'un air dégagé (qui me coûtait durement à prendre, je vous le jure):
«—Je reconnais parfaitement le camarade, Monsieur... C'est Dubreuil, un matelot de mon pays; mais il n'y a pas grand mal, c'était un mauvais gueux qui battait sa mère.
«Mon sang-froid déconcerta le manchot, qui, presque furieux, s'écria, en poussant du pied une des jambes de ce cadavre à moitié rongées par les reptiles:
«—Vous voyez pourtant qu'un banc de vase est une promenade fatigante, capitaine, car on y use jusqu'à sa peau.
«—Oui, quand on est assez sot pour ne pas emporter de patins, lui dis-je en ricanant malgré moi; car l'imbécile, en me montrant cette jambe mutilée, venait de me donner une idée qui était excellente.
«Il la prit pour une plaisanterie, resta court, et me dit sérieusement:
«—Vous êtes gai, capitaine?
«—Très gai, Monsieur, répondis-je; ainsi croyez-moi, jetez cette charogne à la mer. Ne jouez plus à croquemitaine avec moi, et persuadez-vous bien de ceci: c'est que le ciel du bon Dieu tomberait sur moi, que je gratterais encore pour y faire un trou. Sur ce... bonsoir, Monsieur.
«Et je m'en fus, car je n'y tenais plus. Ce cadavre en pourriture me révoltait; et puis, devant m'évader la nuit-même, j'avais bien d'autres chiens à tondre que de faire le vis-à-vis de M. Dubreuil.»
—Et vous avez osé vous évader cette nuit-là, capitaine? dit une de ces dames, dont la terreur était au comble.
«—Oui, Madame, reprit le capitaine d'un air grave; et par l'enfer, ce fut bien une mauvaise nuit que celle-là.»
Et, probablement au souvenir de tout ce qu'il avait déployé de courage et d'énergie dans cette terrible nuit, la figure du capitaine Tom révéla une magnifique expression de force indomptable et de résolution désespérée. Son regard était fixe et profond, son attitude puissante. Il était sublime ainsi. Un moment j'avais entrevu l'homme que je voulais voir sous son enveloppe naïve et simple.
Et le capitaine continua son récit.
«Ainsi que je vous l'ai dit, continua le capitaine, le trou de Tilmont étant terminé, si la nuit devenait bonne, je devais tenter l'affaire.
«Or, elle devint bonne, la nuit, et si bonne, que, vers les sept heures du soir, il ventait dans notre lac une brise à décorner les bœufs. Le ciel se chargeait de grains dans le nord-ouest; il tombait une pluie fine et glacée, et le temps tournait à l'orage, que c'était une bénédiction.
«A huit heures du soir on battit la retraite. Les matelots gagnèrent leurs hamacs, les officiers leurs chambres: dix minutes après, tous les feux, hormis les feux de garde, étaient éteints, et l'on n'entendit plus que la marche mesurée des factionnaires des batteries et des parapets. Je me glissai alors à pas de loup dans la chambre de Tilmont. Jolivet s'y trouvait. Il faut vous dire que le commandant ayant la conviction que Tilmont ne savait pas nager, et par conséquent ne pouvait songer à s'évader, cet officier était moins gêné que nous autres.
«Je me rappelle cela comme si j'y étais. Jolivet sortit pour faire le guet en dehors; j'entrai. Tilmont était assis sur son lit; devant lui était un pliant, sur ce pliant un pot d'étain, et dedans, quelque chose qui fumait.—Ah çà, ça va-t-il toujours pour cette nuit? me dit Tilmont.
«—Toujours, mon matelot, toujours, la nuit est superbe.
«Là-dessus Tilmont baissa un peu la planche qui cachait le trou, et il vint dans la chambre une rafale d'air qui manqua d'éteindre une petite lampe que nous avions cachée sous le lit; nous vîmes alors un ciel sombre, une nuit noire comme de l'encre, et quelques gouttes de pluie ou d'écume, fouettées par la violence du vent, tombèrent même dans la chambre.—Alors Tilmont replaça la planche, me regarda entre les yeux, et me dit:
—«Mais là, sans rire, sais-tu qu'il ne fait f... pas beau, Tom?—Je le vois, mais je m'en f.... (pardon, mesdames).—Mais tu y laisseras ta peau.—Encore une fois, je m'en... moque. Crever là ou ailleurs, c'est tout un.—Mais entends donc ce vent, Tom, vois donc comme il nous bourlingue, Tom.
«En effet, le damné ponton roulait comme une galiote; c'était une jolie tempête. Pour essayer encore de me dégoûter, Tilmont baissa de nouveau la planche du trou, et malgré l'obscurité, nous vîmes alors toute l'étendue du lac blanchie par l'écume des lames; des lames d'un lac!... vous jugez s'il ventait. Partout le ciel noir et un vent d'enfer. J'avoue que c'était une folie de s'exposer à faire deux lieues et demie à la nage par un temps pareil; mais je m'étais dit: je partirai; je devais partir. Aussi je tins bon; et comme Tilmont regardait encore à son trou:—Quand tu te mettras vingt fois le nez à la fenêtre, lui dis-je, ça n'y changera rien; encore un coup, je pars; foi de Tom, je pars.
«Tilmont savait bien que dès que j'avais dit foi de Tom, c'était fini; aussi me répondit-il d'un air très sérieux, en fermant son trou: adieu, va.—Qu'est-ce que cela, lui dis-je en regardant le fond de ce pot d'étain fumant, qui ne sentait pas absolument mauvais?
—C'est du sucre, du rhum et du café fondus et bouillis ensemble; il y en a une pinte, et tu vas d'abord commencer par me boire ça, Tom.—Non, lui dis-je; que le diable m'étrangle si je fais comme ces chiens d'Anglais, qui ne se trouvent hommes que quand ils sont souls.....—Je te dis que tu vas me boire ça, Tom...—Non.—Ah!....—Et malgré tout, je bus, parce que quand cet enragé de Tilmont avait quelque chose dans sa tête, il fallait que ça fût comme il le voulait; mais quoique j'eusse avalé verre par verre sa diable de mécanique, j'avais le feu dans le ventre. Ah ça maintenant, lui dis-je, et le suif?—Je l'ai, me dit-il; car il en avait eu six ou sept livres, comme nous en étions convenus.
«Je me mis alors nu comme la main (pardon mesdames); et nous deux Tilmont, nous me frottâmes d'une couche de graisse d'au moins six lignes d'épaisseur; ça n'est pas très-propre, mais c'est un procédé bien simple que je vous recommande dans l'occasion, car avec ça, vous nageriez dans l'eau glacée comme dans l'eau tiède, sans seulement vous apercevoir du froid.
«Dès que je fus suifé comme une baleinière, Tilmont m'attacha au cou un collier de guinées, cousues dans une peau d'anguille; je mis dans mon chapeau ciré une petite carte de la Manche, que j'avais prise dans la géographie de l'enfant d'un sergent d'armes. J'y mis encore une boussole, de l'amadou et un briquet; je passai mon poignard dans le cordon de mon chapeau, que j'attachai bien ferme sur ma tête; et je bouclai sur mes épaules le petit sac de cuir qui contenait un vêtement complet pour m'habiller, en sortant de l'eau.
«Comme je finissais d'attacher la dernière courroie de ce sac, je sens mon Tilmont y glisser quelque chose: c'étaient vingt guinées, tout ce qu'il possédait alors.—Tilmont, lui dis-je, c'est mal; tu abuses de ta position.—Allons, allons, me dit-il d'un air extrêmement impatienté, voyons, pas de palabres.... et tes patins pour les bancs de vase, où sont-ils?—Là, derrière mon sac; en faisant la planche, je pourrai les prendre et me les mettre aux pieds.—Ah ça, est-ce bien tout?—C'est bien tout.—Alors, adieu, Tom; bon voyage.—Adieu, Tilmont.—Et il ouvrit le trou en grand. Le vent était si fort qu'il éteignit la lampe. J'embrassai Tilmont sans y voir: je lui dis:—Remercie bien Jolivet pour moi. Et je me glissai par le trou.—Bien des choses chez toi, me dit encore Tilmont....
«Et je n'entendis plus rien, car je m'affalais en double le long d'une corde que le vent faisait balancer. Là, grâce au suif, je ne m'aperçus que j'étais dans l'eau que lorsqu'elle me fouetta la figure.
«En me laissant aller au ressac, je me trouvai près des chaînes du gouvernail; et là, craignant, malgré le bruit infernal du vent et l'agitation des vagues, d'être entendu ou vu par les factionnaires, je plongeai une dizaine de brasses. Quand je revins à flot, j'avais le ponton à ma gauche; je le reconnaissais à ses trois feux, qui brillaient comme trois étoiles au milieu de la nuit.
«Ce qu'il y avait de bon, c'est que le temps était si mauvais, qu'on n'avait pas osé mettre d'embarcations dehors pour faire les rondes de nuit. Du côté des hommes, j'étais déjà tranquille; il n'y avait plus que l'eau, le vent et la vase qui me chiffonnaient.
«Après ça, vanité à part, je nageai comme un poisson. Ce que m'avait fait boire Tilmont me réchauffait au dedans, et le suif m'empêchait de sentir le froid au dehors. La position était tenable, mais il faisait un bien vilain temps tout de même.
«Quand je fus à deux cents brasses du ponton, je ne vis plus rien du tout. Le seul horizon que je pouvais apercevoir tout autour de moi, était un horizon de grosses vagues noirâtres qui devenaient blanches à mesure qu'elles se brisaient sur ma poitrine. Le ciel était couvert d'épais nuages roux qui couraient sous le vent, et la pluie qui tombait à verse me fouettant le visage, m'empêchait de respirer librement, ce qui me gênait le plus.
«Je nageai encore courageusement pendant une demi-heure, et puis j'eus un moment de faiblesse... Je réfléchis que j'aurais peut-être mieux fait d'attendre au lendemain; mais après ça je pensai à ma mère, à mon frère: alors mes forces revinrent; je me sentis comme enlevé sur l'eau, et je ne pus m'empêcher de crier hourra. Je fis à ce moment là, certainement, les vingt meilleures brassées que j'aie jamais faites. J'étais comme exaspéré. Il me semble qu'alors j'aurais nagé dans du feu.
«Il y avait donc près de trois quarts d'heure que j'étais à l'eau, lorsqu'il se fit au N.-O. une petite éclaircie. Je vis un peu de bleu et quelques étoiles entourées de nuages gris. A la faveur de cette éclaircie, je distinguai à l'horizon le faîte d'un moulin qui devait me servir de direction pour passer les bancs de vase. Je m'aperçus alors que j'étais plus près de ces bancs que je ne l'avais cru.
«Et ici je ne sais comment vous avouer une chose qui vous paraîtra bien bête, mais qui ne me parut pas telle à moi, car elle faillit me tuer... C'est qu'à peine j'avais eu pensé à ces bancs de vase, que tout à coup le souvenir de ce Dubreuil, qui avait eu les yeux mangés sur ces mêmes bancs, vint s'emparer de moi et ne me quitta plus.
«Et ce souvenir était presque une réalité, car cette diable de figure avait fait sur moi une telle impression!... je me la rappelais si bien, qu'il me semblait la voir et si bien que je la voyais...
«Oui, oui, je la voyais comme je la vois encore quelques fois dans mes rêves; ce visage bruni et déchiré, ces lèvres noirâtres et retroussées, ces dents blanches, et surtout ces deux trous saignants où il n'y avait plus d'yeux. Encore une fois, je voyais tout cela; et dans ce moment, au milieu de cette nuit d'orage, voir cela, c'était ennuyeux, croyez-moi...
«J'eus beau me raidir, penser que c'était le rhum que j'avais bu, ouvrir les yeux les plus grands que je le pouvais, les fermer; plonger, battre l'eau, me toucher les bras et le corps, la figure me poursuivait. C'était un cauchemar: j'avais la fièvre, le délire, tout ce que vous voudrez, mais je la voyais...
«A ce moment-là, vraiment, j'ai manqué devenir fou; et pour me fuir moi-même, ou plutôt la damnée figure qui s'attachait à moi, je plongeai avec fureur; mais au bout de deux brasses je me trouvai arrêté par une substance épaisse... Le fond diminua sensiblement..... J'étais dans la vase...
«Alors comme si le diable s'en fût mêlé, le vent redoubla de sifflements, la pluie de force; la nuit devint plus épaisse, et il me sembla voir et entendre des nuées de corbeaux au milieu desquels je voyais toujours les deux yeux vides de ce s... Dubreuil qui me regardaient. Ce fut plus fort que moi, je sentais comme une défaillance, et pourtant je me raidissais en criant et râlant du fond de la gorge: Ah! mon Dieu! On aurait dû m'entendre du ponton, quoiqu'il y eût une lieue. A bien dire, ce fut le plus vilain moment de cette nuit-là; car après ça je revins à moi, et je me raisonnai un peu en tirant la brasse pour me sauver de la vase, que je n'avais heureusement qu'effleurée. Enfin, me disais-je... Tom, tu n'es pas une femme.... Si tu réussis, pense que tu vas voir ta mère, ton frère; tu as échappé à ce gredin de manchot. Dubreuil a été rongé dans la vase, c'est vrai; mais Dubreuil était un gueux, et tu es un honnête homme; ou, ce qui est plus clair, tu as des patins, et il n'en avait pas... Ainsi du cœur au ventre, mordieu, et va de l'avant...
«Je m'écoutai, et j'eus raison. Je fis de mon mieux; et, toujours nageant et sondant avec mes mains les bords du banc, je trouvai un endroit où la vase était assez compacte pour me soutenir un instant. Je profitai de cela pour attacher mes patins à mes pieds; et je glissai accroupi sur cette boue liquide comme sur des roulettes. Ces patins étaient faits de deux planches de sapin très-larges et très-minces, qui par la grande surface qu'ils offraient à la vase, m'empêchaient d'y enfoncer. Je traversai ainsi le premier banc: puis je me remis à l'eau et à nager pour gagner les autres.
«Une fois que j'eus goûté de mes patins, je vis que ce n'était qu'un jeu d'enfant: aussi je traversai le second et le troisième banc sans y penser, et je dus arriver au bord du lac environ deux heures et demie après mon départ du ponton.
«C'était bien quelque chose, mais ce n'était pas tout; il fallait songer à sa toilette: j'étais couvert de limon comme un crabe, vu que ce que j'avais traversé en dernier était de la vase. A force de chercher, je trouvai un ruisseau tout près du moulin; je me débarbouillai, et un quart d'heure après j'étais mis fort décemment en bourgeois. Je bus une goutte de rhum à une gourde dont ce pauvre Tilmont avait précautionné mon sac; et, consultant ma boussole à l'aide de mon briquet, je me dirigeai vers l'est, voulant marcher toute la nuit afin de me trouver le matin assez loin de Southampton pour ne pas éveiller les soupçons.
«Ce qu'il fallait à tout prix pour moi c'était gagner la côte, et là, de gré ou de force, trouver un canot pour traverser la Manche.
«Je ne vous dirai pas toutes les transes que j'éprouvai, obligé de me cacher le jour et de ne marcher que la nuit, payant quelquefois le silence à prix d'or, ou l'exigeant un peu brutalement; enfin vous jugerez des assommantes marches et contre-marches que je dus faire, quand vous saurez que j'avais quitté le ponton depuis neuf jours et que je ne me trouvais encore qu'aux environs de Winchelsea, à vingt-cinq ou trente lieues de Portsmouth tout au plus.
«Je commençais à me démoraliser: tant qu'il n'y avait eu que des obstacles à vaincre, ça allait tout seul, parce que les obstacles.... ça monte: mais quand il n'y eut plus qu'à se cacher comme un voleur, qu'à prendre garde, qu'à avoir peur d'un schériff ou d'un watchman, ça ne m'allait plus.
«Enfin un matin, c'était, pardieu, un mercredi matin, j'avais marché toute la nuit, et je me trouvais auprès de Falkstone, petit port pêcheur sur la côte, à une douzaine de lieues de Douvres; j'étais harassé, presque sans argent, abattu, de mauvaise humeur; il faisait chaud et je m'étais assis sous deux grandes arbres qui ombrageaient un banc situé à la porte d'une assez jolie maison, bâtie tout proche des falaises de la côte.
«J'étais donc là, mon bâton entre mes jambes, réfléchissant si je n'aurais pas plus tôt fait d'engager tout bonnement, le poignard sur la gorge, le premier pêcheur que je rencontrerais sur la côte, à me confier son canot pour traverser la Manche, au lieu d'être là à me cacher comme un malfaiteur, lorsque j'entends chantonner derrière le mur de cette maison: c'était une voix de femme. Machinalement, ou par curiosité, je monte sur le banc, et j'aperçois dans ce jardin une belle jeune femme avec un grand chapeau de paille, des cheveux noirs superbes et une robe blanche. Elle arrangeait des fleurs et ne se doutait pas que je fusse là; mais, au moment où elle se tourne, qu'est-ce que je vois? un bijou de l'Inde, assez précieux, mais surtout fort remarquable, que je reconnais tout de suite. Ce bijou, et l'endroit de la côte où je me trouvais, me rappelèrent une chose à laquelle je ne pensais ma foi pas: aussi d'un bond je suis sur le mur, du mur dans le jardin, et assez près de la belle dame pour l'arrêter par le bras au moment où elle se sauvait avec une peur horrible. La pauvre femme tremblait de tous ses membres, et il y avait de quoi; mais je la rassurai bientôt en lui disant, en parfait anglais: Vous êtes la femme du capitaine Dulow. Est-il ici?—Oui, Monsieur.—Vous a-t-il parlé du capitaine Tom S., qui lui a donné ce bijou, lui dis-je, en lui montrant un petit poisson d'or à écailles articulées en pierreries qu'elle portait à son cou, suspendu à une chaîne avec sa montre?—Sans doute, monsieur, c'est au capitaine S. que mon mari doit sa liberté, me répondit cette femme en me regardant avec ses grands beaux yeux étonnés.—Eh bien! madame, le capitaine Thomas S. c'est moi, je suis prisonnier, je me sauve, cachez-moi?—Vous, monsieur!... Ah! quel beau jour pour mon William, monsieur... Suivez-moi.
«Dulow était à la promenade, il revint bientôt, et me reçut bravement, comme j'y comptais; il me tint caché dans sa maison, dont la position était assez commode pour cela. Le jour je ne sortais pas, et le soir, à la brune, nous allions nous promener, sur les falaises, avec sa femme et sa sœur, excellente personne aussi.
«Quand Dulow me quitta dans les temps, je l'avais trouvé si bon garçon, que je l'avais prié d'accepter pour sa femme, dont il me parlait toujours, ce bijou que j'avais rapporté de l'Inde, en lui disant: Dulow, qu'elle le porte en souvenir de son mari. Vous voyez que ça s'est bien trouvé, car c'est à ce diable de poisson d'or que j'ai reconnu madame Dulow. Quant à ce que j'ai fait pour Dulow, ce n'est pas la peine de vous le dire, c'est une misère: dans ce temps-là ç'avait été beaucoup pour lui et rien pour moi, mais il s'en souvint; c'était tout simple, à sa place j'aurais fait tout de même.
«Par exemple, j'avais beau demander à Dulow les moyens de traverser la Manche, il avait toujours de mauvaises raisons à me donner: c'était très difficile de trouver un canot.... Il était impossible d'éviter les gardes-côtes... Les vents étaient contraires... et variables (ce qui n'était pas vrai). Enfin, je l'avoue, je commençais à douter de sa bonne volonté. C'était dur, à trente lieues de France.
«Il y avait déjà dix jours que j'étais chez lui. Un soir, il dit à sa femme et à sa belle-sœur comme d'habitude: Mesdames, prenez vos chapeaux, et allons nous promener sur les dunes. J'y allai avec eux. Nous nous promenâmes assez longtemps sans rien dire; j'étais triste; le temps se passait; j'étais inquiet de ma mère; la guerre continuait, et je n'y étais pas; et puis enfin il me chagrinait de douter du dévouement de Dulow, qui pourtant n'aurait pas dû être ingrat. Le soleil était couché et la nuit commençait à se faire noire, lorsqu'en arrivant près d'une petite anse, Dulow me dit, en levant le nez en l'air: Capitaine, que dites-vous de ce vent-là? (c'était une jolie brise de plein nord). Pardieu, lui répondis-je, il n'en faudrait pas plus à un pauvre prisonnier, qui aurait un canot, pour se trouver, demain matin, couché dans la maison de sa mère.—Eh bien! alors, me dit Dulow, capitaine, embrassez ces dames et partez.—Je ne compris pas tout de suite: c'était trop loin de ma pensée du moment.
«Dulow me prit par la main en haussant les épaules, et me mena derrière un morne, où je vis un assez grand canot gréé avec une grande voile, une misaine et une trinquette amarrée à une roche.—Excusez-moi, me dit alors Dulow, si je vous ai fait attendre si longtemps; mais il fallait que j'attendisse le tour de service du garde-côte qui croisera cette nuit dans ces parages; il m'est dévoué; il sait ce que je vous dois: cette nuit vous pourrez passer sans crainte.
«Je reconnus mon Dulow d'autrefois, et je ne m'étonnai de rien; j'embrassai ces dames bien fort, lui aussi, et je sautai dans ce canot.
«J'y trouvai des vivres, un compas, des armes, de la poudre, une longue-vue de nuit et une mèche. Je fis un dernier signe à ces dames et à Dulow, et je démarrai. J'étais libre...
«Je courus grand large; la mer était superbe; un temps de petite-maîtresse. La longue-vue de nuit me fut bonne; car, au bout d'une heure de marche, je distinguai une corvette, peut-être anglaise, sur laquelle j'avais le cap; je virai de bord et fis quelques bordées. Ce petit accident me retarda un peu; mais le lendemain matin, au point du jour, j'eus le bonheur de voir la terre de France sortir de la brume, et de distinguer la jetée de Calais. Il faisait un soleil magnifique, la mer était comme un miroir, la brise fraîche et toujours du nord. Dans deux heures je devais embrasser ma mère et mon frère.
«Mais ce qu'il y eut de bon, c'est que les pilotes, les marins et les flâneurs du port étaient, comme d'habitude, rassemblés sur la jetée, et qu'en regardant de çà et de là avec leurs longues-vues, voilà qu'ils m'aperçoivent dans mon bateau.—Tiens! un prisonnier qui s'échappe, dit l'un.—Bon... si c'était le capitaine S..., dit l'autre.—Ça se pourrait, dit un troisième.—Et ne voilà-t-il pas qu'un mousse au lieu d'entendre: si c'était, entend: c'est le capitaine S... Il part comme un trait, et tombe chez ma mère et mon frère en criant comme un sourd: Voilà le capitaine qui arrive d'Angleterre, tout seul, dans un canot!
«Heureusement que c'était vrai, car sans cela vous concevez quel horrible coup c'eût été pour ma pauvre mère. Enfin elle accourt avec mon frère sur la jetée d'où l'on m'avait déjà reconnu; je n'étais pas à une portée de canon du port.
«Je n'ose pas vous dire comme je fus accueilli. Tous les bateaux pêcheurs et pilotes de Calais étaient venus à ma rencontre, et me convoyaient: c'étaient des hommes, des femmes, des enfants; c'étaient des hourras, une joie, des cris de vive le capitaine S...! qui me faisaient pleurer comme une bête: et puis au bout de tout ça, sur la jetée, je voyais mon frère soutenant ma pauvre vieille mère qui avait tout au plus la force d'agiter son mouchoir, tant elle était émue.
«Mais, comme je mettais le pied sur l'échelle pour sortir de mon canot, en criant toujours, ma mère...! je me sens arrêté au bas de la jetée par un pékin en noir et en écharpe, flanqué de deux gendarmes, qui me demande mon passeport!
«C'était pourtant le commissaire, qui était assez bête pour me demander mon passeport. Mon passeport! l'animal! comme si j'arrivais dans sa ville par la grand'-route et en vinaigrette. Demander son passeport au capitaine Tom, qui s'échappait pour la troisième fois des pontons d'Angleterre! C'était à en devenir commissaire soi-même! Un chien qui venait me parler de passeport quand je voyais ma mère à vingt pieds au-dessus de moi! Aussi comme il faisait mine de se mettre en travers de l'échelle, je l'envoyai, lui et ses gendarmes se rafraîchir dans le port; d'un saut je fus sur la jetée, et vous jugez si je fus embrassé par ma mère et mon frère. Mais ce qu'il y eût de fameux, c'est que ces diables de marins étaient furieux, et qu'ils ne voulaient plus laisser sortir de l'eau le commissaire et ses deux gendarmes, qui barbottaient d'un canot à l'autre en criant comme trois caniches en détresse,» ajouta le capitaine qui riait encore de souvenir. «Voilà, messieurs, nous dit enfin Tom, de quelle façon je suis revenu cette fois-là d'Angleterre; mais il ne se passe vraiment pas de semaine que je ne pense à ce misérable Dubreuil, et que je ne voie en rêve sa damnée figure avec ses deux trous sans yeux, qui ont manqué me jouer un si bête de tour.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il me serait impossible de dire l'impression que me fit éprouver cette narration, de dépeindre l'âpre énergie des gestes du capitaine, l'inflexion de sa voix brève ou sonore, qui se modifiait, qui se pliait si bien à toutes les exigences de ce récit animé.
Je n'ai rien omis, rien changé: mais quelle différence, que cela maintenant me paraît froid, pâle, décoloré, à moi qui l'ai entendu, à moi qui l'ai vu!
Et puis, ce qu'il y avait encore de merveilleux, c'était ce mélange bizarre de deux hommes: l'un grandiose, énergique, bouillant et intrépide, dur comme l'acier, puisant sa force dans la résistance, ayant vingt fois bravé la mort, les horreurs du carnage et de la tempête; et puis l'homme doux, simple et bon, ayant l'air, pour ainsi dire, d'avoir assisté seulement comme spectateur à cette imposante et terrible partie de sa vie, et de s'en souvenir comme d'un sombre et magnifique drame qu'il aurait vu jouer jadis et qu'il sait par cœur. Ce qui m'avait encore frappé dans ce récit, c'était ce dévouement admirable des marins les uns pour les autres; ces services où il s'agit à chaque pas de vie et de liberté, et qu'ils se rendent avec une insouciance si sublime. Et cela sans se dire merci, frère! car ils ne se disent pas merci entre eux. Mais si un jour le plomb vous atteint au milieu d'une grêle de mitraille, si les vagues écumantes sont sur le point de vous engloutir, vous sentirez une main amie ou reconnaissante vous arracher à son tour à une mort certaine. Et puis, quand vous reviendrez à la vie, peut-être cette main reconnaissante sera-t-elle glacée; mais c'est comme cela qu'elle vous aura dit merci, c'est comme cela qu'une autre fois vous direz merci à d'autres.
Quelle folie de ne savoir pas se borner à n'aimer la créature que comme on doit aimer ce qui est sujet à périr!
Confessions de Saint-Augustin, LIV. IV, ch. VII.
...Je venais de faire une campagne de deux ans dans l'Inde. De retour à Paris depuis six mois, j'avais pour maîtresse la femme d'un de mes amis d'enfance.
C'était une fort jolie femme, un véritable type de race et de distinction; frêle, blanche, délicate, nerveuse, pâle avec de grands yeux bruns qui voyaient à peine; l'air fier et hautain; un pied charmant; une main et une taille divines; de l'esprit; de l'âme! de l'âme... ni peu ni trop, mais juste ce qu'il en fallait pour mettre quelque poésie dans notre liaison, sans tomber dans les exigences et les ennuis de la passion...
Un soir que nous avions dîné seuls, mon ami, sa femme et moi, il demanda sa voiture et dit:
—Je vous quitte, Jenny, car j'ai affaire et c'est votre jour d'Opéra je crois...
—Oui, répondit Jenny; mais j'ai donné ma loge aux Bressac.
—Et que ferez-vous?
—Je ne sais trop... Comme c'est le mercredi de madame d'Arville, j'irai peut-être un moment...
Je me levai, et me disposais à sortir avec mon ami quand sa femme me dit:
—Je ne vous renvoie pas, au moins; je n'ai demandé ma toilette que pour neuf ou dix heures...
—Sans doute, si tu n'as rien à faire, reste avec ma femme, tu lui tiendras compagnie: car j'ai un diable de rendez-vous de notaire que je ne puis remettre.
—Adieu, Jenny, dit-il à sa femme en lui baisant la main; et, se tournant vers moi: «N'oublie pas que j'irai te prendre demain à deux heures, pour aller voir cet hôtel de la rue de Londres.
Et il sortit.
Quand le roulement de la voiture de mon ami m'eut appris son départ définitif, je quittai ma chaise, et j'allai m'asseoir sur la causeuse près de Jenny.
—Voyez pourtant ce que je vous sacrifie, Arthur!... me dit-elle avec un soupir.
Cette réflexion était si étrange après une intimité de trois mois, si peu en harmonie avec ce qui venait de se dire et de se passer, que n'y comprenant en vérité rien du tout, je lui répondis:
—Comment.... Jenny.... quel sacrifice!...
—Elle ne me répondit rien, prit sa cassolette sur une petite table, me tourna le dos, et se mit à jouer avec ce bijou d'un air boudeur et piqué.
—Ah! lui dis-je en baisant ses jolies épaules,—je conçois.—Ecoutez, ma chère;—nous sommes convenus d'être francs..., je veux donc vous dire ce qui vous contrarie.—Vous m'avez parlé de sacrifice parce que vous avez peut-être lu ce matin le roman de quelque passion malheureuse, ou que le cours fantasque de vos idées vous porte à causer ce soir faute et remords. D'honneur, je ne vous aurais pas refusé cette distraction, si j'avais été prévenu, si vous aviez amené ce sujet plus naturellement... Mais, en vérité, cela venait si peu à propos, au moment où ce cher Octave vous quittait pour son notaire, que je n'ai pu réprimer un mouvement de surprise... Or, cette surprise vous empêche d'utiliser la disposition d'esprit dans laquelle vous étiez ce soir, et vous m'en voulez... Est-ce cela?
Jenny sourit presque...
—Allons, j'ai deviné juste, et puisque nous sommes en veine de franchise, laissez-moi donc vous dire que, d'ailleurs c'était un mauvais thême... que le sacrifice.—Entre nous et dans une liaison comme la nôtre, qu'est-ce que vous sacrifiez? Etre adorée et environnée de soins, d'hommages, avoir la conscience de tout ce qu'on fait pour vous plaire, vous appelez cela vous sacrifier! A la bonne heure... c'est une conséquence de l'habitude où nous sommes, nous autres, de vous remercier du bonheur que nous vous donnons...
—A merveille!... Et notre réputation? et nos principes?
—Voilà un double emploi de mots, réputation dit tout. Eh bien! en ne s'écrivant pas, et en ayant pour amant un galant homme qui sache vivre, la réputation demeure intacte.
—J'admets cela... et nos principes?
—Oui..., mais moi je n'admets pas vos principes...
—Arthur..., vous déraisonnez, ou vous êtes d'une fatuité ridicule.
—Mais c'est au contraire parce que je ne suis pas fat, et que je me compte pour fort peu que je ne crois pas aux principes...
Comment voulez-vous sérieusement que je puisse croire à l'influence de ce que vous appelez vos principes,—quand je vois un aussi mince mérite que le mien en triompher? Et encore le mérite n'est rien... Si au moins je vous avais prouvé mon amour par un dévoûment sans bornes, une constance désintéressée, parfaite; mais non; je ne vous avais jamais vue, il y a six mois; je me suis occupé de vous comme on s'occupe de toutes les femmes; vous m'avez accueilli comme on accueille tous les hommes, et j'ai été heureux, parce que le bonheur entrait dans nos arrangements de position, de relation. Vous ne me devrez pas plus que je vous dois, nous avons cherché chacun nos convenances, nous les avons trouvées; jouissons-en, mais ne parlons pas de sacrifice.
—En vérité, ne dirait-on pas que ce mot doit être rayé de notre langue!.....
—Et le remords!... n'est-ce pas un sacrifice que de s'y exposer?
—Mais nous avons traité la question du remords en parlant de la réputation. Le remords.., c'est la peur d'être découvert... Or, avec de la prudence et du mystère... on n'a pas de remords.
—Vous êtes dans un de vos jours de paradoxes: soit! c'est une coquetterie de votre part... parce que vous savez que rien ne me séduit et ne m'amuse autant que les paradoxes... Aussi, à bien prendre, mon amour pour vous n'est-il...
—Qu'un paradoxe.
—Vous l'avez dit... Mais, pour en revenir à notre discussion, vous niez donc qu'une femme puisse faire un sacrifice à son amant?
—Pas du tout... Je nie qu'entre nous jusqu'à présent, nous nous soyons fait le moindre sacrifice; et je dirai plus..., c'est que si quelqu'un en a fait, c'est plutôt moi...
—C'est fort amusant!... et comment cela?
—Ecoutez donc, Jenny, vous êtes mariée, et je ne le suis pas; vous n'avez pas à songer à un avenir, vous; et je me trouve dans la même position qu'une jeune personne à établir qui a un amant...
—Fou que vous êtes!
—Le fait est si vrai que si je mourais demain, j'aurais sur mon cercueil une couronne de roses blanches et de beaux draps blancs; et, mon Dieu! tout autant d'emblêmes de candeur et de pureté qu'un ange de seize ans qui va monter au ciel... ce que c'est que le monde!...
—Et les occasions dans lesquelles une femme peut faire un sacrifice à son amant sont fort rares sans doute, Monsieur? reprit Jenny.
—Heureusement,—fort rares, presqu'impossibles à rencontrer, en France surtout... grâces à nos mœurs et à notre divine corruption, qui, jusque dans le vice, veulent l'aise, le repos, et surtout la liberté.
—Et ailleurs?
—Oh! ailleurs c'est différent... Dans un pays presque sauvage, cela se peut...., cela est..., cela même a été..., je puis le dire...
—Ah! mon Dieu! un fait personnel à vous peut-être?...
—Mais oui..., peut-être...
—Oh! racontez-moi donc cela, je vous en prie!
—Si j'étais fat... je dirais que vous seriez jalouse..., j'aime mieux dire que cela vous ennuierait.
—Vous savez bien que non, que rien ne m'intéresse autant que de vous entendre parler de vos voyages... Mais vous voulez en parler si rarement...—Voyons..., Arthur, je vous en prie... Oh! conte-moi cela..., je le veux!...
—Eh bien! écoute donc, dis-je à Jenny.—
«Il y a de cela environ dix-huit mois, j'étais dans l'Inde. L'amiral *** m'avait chargé d'une mission assez importante pour... (pardonnez-moi cet horrible mot) pour Vizagapatnam. Je partis de Madras, je remplis mes instructions, et je revins... Je n'étais plus qu'à quinze lieues de cette ville, lorsqu'un accident, arrivé à un des hommes qui portaient mon palanquin, m'obligea de m'arrêter dans un village appelé Tschina-Marmelong (encore pardon du nom); mais dans l'Inde, ils sont tous comme ça.
«Je ramenai avec moi un de mes officiers, excellent homme, nommé Duclos, qui n'avait qu'un défaut: c'était d'aimer à savoir le matin ce qu'il devait faire dans la journée, et de se désespérer quand un événement imprévu venait bouleverser ses arrangements.
«Or, à défaut d'événements imprévus, moi je me chargeais toujours de déranger ses plans, parce qu'alors rien ne m'amusait tant que sa colère et ses lamentations. Tu conçois bien qu'en route il faut se distraire.
«Quand M. Duclos eut bien gémi sur le retard qui nous retenait dans la chaudrerie de ce village, il me dit:—Enfin nous voilà tranquilles jusqu'à demain..., que ferons-nous? J'aime à savoir sur quoi compter (c'était son mot).
«—Mais..., lui dis-je, ce que nous pouvons faire de mieux, c'est de souper et de nous coucher ensuite, et de dormir si les moustiques nous le permettent.
«—A la bonne heure, me répondit l'excellent homme, car j'aime à savoir sur quoi compter... Je vais donc aller me promener dans cette rizière en attendant l'heure du repas; cela me donnera de l'appétit, et me préparera à bien dormir.
«Il s'en fut, et je me promis bien qu'il souperait, qu'il se coucherait, et qu'il dormirait le moins qu'il me serait possible.
«La chaudrerie se remplissait de voyageurs; une chaudrerie, Jenny, est un caravansérail, une auberge publique fondée par de bonnes âmes, où l'on trouve pour rien l'eau et le couvert, et dans quelques endroits des aliments pour les pauvres.
«Bientôt notre compagnie fut augmentée d'une troupe de daatcheries ou danseuses ambulantes, accompagnées de leurs musiciens.
«Après que ces bayadères, selon le vœu de leur religion, qui prescrit deux ablutions par jour, eurent été se baigner dans l'étang, la conductrice ou bidda de la troupe vint me saluer en me présentant un bouquet, et me demander, au nom de sa compagnie, la permission de danser devant moi.
«Cette demande fut pour moi un coup du ciel. Je décidai mentalement qu'au lieu de souper, de se coucher et de dormir, le malheureux, ou plutôt l'heureux Duclos ne souperait pas, assisterait au bal, et veillerait toute la nuit.
«Je dis donc à cette femme que j'aurais le plus grand plaisir à voir danser sa troupe, mais qu'il fallait attendre pour cela l'arrivée de mon camarade.
«A peine eus-je fait connaître ma détermination, que tous les assistants témoignèrent leur joie par les exclamations de nela doré! maaradjha! ce qui veut dire grand prince et brave seigneur.
«On mit donc de petites lampes d'argile sur les niches pratiquées à cet usage dans les murs de la chaudrerie; j'ordonnai à mes porteurs d'aller abattre de nombreuses branches de tamarin et de manguiers, dont on joncha la grande salle... Je fis apporter le matelas de mon palanquin dans un coin; mon fidèle Fritz me fit un bowl de punch à l'arrach.... J'allumai mon kouka, et j'attendis Duclos...
Tu aurais ri comme moi, Jenny, en voyant l'air étonné, stupide de ce pauvre homme à l'aspect de tout ce monde, de cet éclat, de cette verdure éclairée par les lampes, de cet air de fête enfin qui semblait présager quelque chose de si fatal pour son souper et son sommeil.
«Il se fit jour à travers la foule, et s'approchant de moi...—Eh bien! me dit-il..., nous ne soupons donc plus à présent? C'est insoutenable, avec vous on ne peut compter sur rien... Encore une fois... nous ne soupons donc plus?
«—Pas du tout, mon cher monsieur Duclos..., puisque nous sommes au bal... Et pour preuve, j'ordonnai à mon principal corelis d'aller prévenir les bayadères.
«—Au bal, au bal..., alors pourquoi me faites-vous compter sur le souper et le sommeil?... Je m'arrange dans cette idée, maintenant c'est le contraire...
«—C'était une surprise, mon cher Duclos.....
«—Mais, mon Dieu, vous savez que justement ce que j'abhorre le plus au monde, c'est une surprise...
«—Madame Duclos ne vous a donc jamais souhaité votre fête avec une couronne et des pétards, monsieur Duclos?...
«—Si Monsieur....., me répondit-il, mais nous tressions la couronne ensemble quinze jours à l'avance, et c'est moi qui allumais les pétards.
«—Allons, un verre de punch à la santé de madame Duclos, qui ne vous faisait pas de surprise...
«—Je vous remercie bien, Monsieur.—Quand je m'attends à boire du punch, je bois du punch; quand je m'attends à souper, je soupe,—ou si je ne soupe pas, au moins je ne bois pas de punch,—me répondit-il d'un air piqué.
«Le fait est qu'il était désespéré; car cet excellent homme poussait si loin cet amour du prévu, que lors de notre combat de Tarifa, en 18..., ce qui le contraria le plus fut, non pas le danger qu'il affronta avec une froide intrépidité, mais ce fut le désordre que cet incident inattendu jeta dans sa journée.
«La danse commença,—elles étaient sept bayadères. La musique résonna, et fit retentir la chaudrerie des sons perçants des cymbales, des caresas, des matatans et autres instruments du pays.
«C'est qu'en vérité, Jenny, elles étaient charmantes: leur costume était si séduisant, leurs cheveux si noirs, si lisses; et puis les petites plaques d'or attachées à un filet de soie pourpre qu'elles se posent sur le sommet de la tête, leurs longues boucles d'oreilles, les anneaux d'or et d'argent qui entourent leurs jambes et leurs bras..., leurs robes d'étoffe de soie rayée, attachées sur les hanches avec une ceinture d'argent battu...; tout cela était si élégant, si oriental..., leurs poses enfin lascives et passionnées, avaient un caractère si particulier, que j'eusse donné et donnerais encore vingt de vos brillants ballets d'Opéra pour cette danse naïve des daatcheries dans une pauvre chaudrerie du Carnate.
«Quand le bal eut duré environ une heure, je leur fis signe de cesser, au grand chagrin de Duclos, dont les yeux s'animaient, et qui avait fini par jouir de la danse, du kouka et du punch, comme s'il s'y fût attendu depuis huit jours...; de Duclos, qui, paraissant oublier les couronnes conjugales et les pétards de madame Duclos, semblait s'abandonner à des pensées malhonnêtes.
«Comme je parlais passablement la langue hindoue, je remerciai ces bonnes filles, en les assurant que Rambhé, la déesse de la danse, ne les surpassait pas; mais je les priai de chanter quelque peu...
«Mes louanges leur plurent, les surprirent beaucoup de la part d'un Européen; et elles me demandèrent ce qu'elles pourraient chanter pour m'être agréable.—Je leur indiquai la Kamie, que j'aimais beaucoup et que j'avais déjà entendue à Surate.
Elles me chantèrent donc les aventures de la princesse Bedd'hia, épopée maratte pleine de grâce et de fraîcheur.
«Il était minuit lorsque leurs chants cessèrent. Elles voulurent commencer un autre giez ou poëme; mais je les remerciai, et après que, selon l'usage, j'eus offert à la première danseuse mon présent sur un plateau couvert de feuilles de bétel et de noix d'arèque,—tous les spectateurs se retirèrent, les uns dans leurs huttes, les autres dans la chaudrerie.
«Duclos voulut se coucher (il ne soupa pas) sous l'appentis; quant à moi je fis porter mon palanquin sous un énorme cocotier, et je m'y étendis, respirant avec délice l'odeur vive et pénétrante de cette végétation si nourrie et si parfumée...
«A peine étais-je endormi qu'un mouvement fait à la couverture de mon palanquin m'éveilla... Qui est là? dis-je assez étonné...
«Une voix de femme me répondit:
«C'est moi, monsieur, la bidda des daatcheries; je viens vers vous avec mille compliments de la jeune fille au corset jaune et à la couronne de mongaries,—Daja.—Son cœur s'est ouvert en votre faveur comme le sourdjoupers s'ouvre aux rayons du soleil!
«Recevez le bétel qu'elle vous a préparé elle-même. Elle est assise au pied de votre palanquin, où elle attend vos ordres.
«Le diable m'emporte, Jenny, si je me rappelais la danseuse au corset jaune! D'ailleurs, j'avais envie de dormir, je voulais repartir le lendemain de bonne heure pour Madras; et puis enfin ces avances m'eussent peut-être convenu la veille, le lendemain,—mais alors elles ne me convenaient pas. Aussi je remerciai la bidda de son honnête intervention, et l'engageai à aller offrir le bétel d'amour à mon ami Duclos, dans l'intention de lui ménager une surprise de plus.
«Tembrane meharsa! Dieu seul est grand! me répondit la bidda; ce qui me parut peu concluant relativement à la surprise que je l'engageais à faire à Duclos. Elle s'en alla.
«Le lendemain, les corelis nous éveillèrent. Duclos était prêt, et nous nous disposions à partir, lorsque les daatcheries vinrent prendre congé de moi.
Je cherchais, par pure curiosité..., la jeune fille au corset jaune..., elle n'y était pas... Je la demandai à la bidda, qui l'appela. Elle vint un moment sur la porte de la chaudrerie, me regarda avec fierté, colère et mépris, porta ensuite la main sur la poitrine pour me saluer, et disparut.
«Nous partîmes. A cent pas de la chaudrerie, je soulevai un des pans de mon palanquin; et comme je regardais dans la direction du village, je vis avec étonnement Daja qui paraissait avoir pleuré; car elle s'essuyait les yeux, et deux de ses compagnes semblaient la consoler...»
—Mais était-elle jolie, cette fille? me demanda Jenny avec impatience.
—Ravissante et faite à peindre! lui répondis-je.
«Je ne sais pourquoi, pendant toute la route, continuai-je en souriant du léger nuage qui avait obscurci le front de Jenny, je ne sais pourquoi le souvenir de Daja me poursuivit. J'avais beau me dire que ce n'était après tout qu'une fille, une de ces bayadères qui se livrent au premier venu; j'avais beau me faire tous les raisonnements du monde, boire du punch, faire courir mes porteurs, mâcher du bétel, ménager des surprises à Duclos, ou fumer de l'opium: rien ne pouvait me distraire de la pensée qui m'obsédait.»
—Et c'était une fille? me demanda Jenny.
—Oh! tout ce qu'il y a de plus fille! «Enfin, n'y pouvant plus tenir, le soir de notre arrivée à Tunipatnam, au moment où nos porteurs allaient se coucher..., j'allai trouver Duclos.
«L'excellent homme se préparait à monter dans son hamac qu'il avait amoureusement suspendu dans un coin bien obscur de la nouvelle chaudrerie où nous venions d'arriver.
«L'infortuné Duclos ne soupçonnait pas le moins du monde le but de ma visite; car me montrant avec complaisance l'installation de son hamac, qui à vrai dire donnait envie de s'y coucher, tant cela était bien arrangé, frais et tranquille:
«—Avouez, me dit le brave homme, que je vais passer une fameuse nuit dans ce bon petit coin-là!»
—En vérité, Jenny, il me fallut un courage surhumain pour sacrifier Duclos à Daja, pour renverser d'un souffle ce bonheur si bien apprêté: j'eus ce courage, cet admirable courage.
«—Je suis désolé, mon cher Duclos, lui dis-je, mais nous repartons à l'instant... nous retournons sur nos pas...
«—Farceur de commandant!—me dit Duclos en sautant d'un bond dans son hamac, et faisant avec calme toutes ses dispositions pour sa nuit, arrangeant son oreiller, poussant son traversin..., tant il était loin de penser à l'affreux imprévu qui le menaçait...
«—Je ne plaisante pas, monsieur Duclos, dis-je très sérieusement, nous partons... Voici mes porteurs qui viennent me prendre... J'ai fait aussi prévenir les vôtres.
«Duclos se croyait sous l'obsession d'un horrible cauchemar...—Retourner sur ses pas! à cette heure!... retourner!... se lever!... disait-il à voix entrecoupée en se tâtant pour voir s'il n'était pas le jouet d'une illusion...
«—Oui, il faut partir... et à l'instant..... Voyons, Duclos, du courage...
«—Allons donc! je ne pars pas..., non je ne partirai fichtre pas! dit tout à coup mon homme se raidissant dans son hamac comme un désespéré, et me regardant d'un air hagard.
«—Monsieur Duclos, lui dis-je, j'ai pu oublier un instant que j'étais votre supérieur, maintenant je vous l'ordonne.
«—Mais monsieur, pourquoi retourner?
«—Monsieur, je n'ai de compte à rendre qu'à l'amiral, et vous devez m'obéir aveuglément...
«M. Duclos, ne répondit pas un mot, s'habilla, fit décrocher son hamac, monta dans son douli et suivit mon palanquin. Duclos était bleu de colère.
«Mon intention était, Jenny, de rencontrer les bayadères, la bidda m'ayant dit qu'elles se rendaient aussi à Madras. Comme il n'y avait pas d'autre chemin que celui où nous voyagions, j'étais sûr de mon fait; aussi marchâmes-nous toute la nuit.»
—Et ce malheureux M. Duclos? me demanda Jenny.
«En arrivant le matin au village où je croyais rencontrer les danseuses, je m'arrêtai, avant que d'entrer à la chaudrerie.
«Je fis appeler M. Duclos, et pour m'en débarrasser, je lui dis:
«—Je veux bien oublier, monsieur, votre scène inconvenante d'hier, et vous donner une nouvelle marque de ma confiance; vous allez monter sur le morne qui est situé vers le nord-ouest. Emportez votre graphomètre et votre niveau,—et relevez un plan exact de toute la partie du pays qui s'étend entre la direction du nord-ouest au sud-ouest du compas.
«—Mais pourquoi n'avoir pas fait cela hier..., et à quoi bon?... C'est le premier plan depuis Vizagapatnam... me répondit Duclos étonné au dernier point.
«Je coupai court à son interrogation avec ma réponse habituelle,—que je ne devais de compte de ma conduite qu'à l'amiral;—et l'excellent Duclos se chargea de ses instruments et descendit dans le nord-ouest, en faisant des suppositions à perte de vue sur la nécessité qui m'obligeait de revenir sur mes pas pour lever le plan de Jaffanapatnam.
«Alors, faisant diriger mon palanquin vers la chaudrerie, j'arrivai par une longue allée de cocotiers qui ombrageait un fort bel étang maçonné dans lequel se baignait beaucoup de monde, et entre autres, tout à l'extrémité, une petite troupe de femmes.
«Tout à coup, j'entends un cri perçant sortir de ce groupe; je regarde avec plus d'attention, et je reconnais Daja, ma danseuse au corset jaune, qui venant de se baigner avec ses compagnes, ne faisait que sortir de l'eau, car elle avait encore son pagne de bain.
«La pauvre fille m'avait reconnu, je lui fis signe d'approcher; elle s'enveloppa d'une grande couverture de coton blanc et accourut toute honteuse.
—«Daja, je viens pour toi, lui dis-je....., pour te chercher... Veux-tu venir avec moi?
«Elle leva ses grands yeux noirs, et n'osait pas comprendre.
«—Veux-tu Daja?
«—Avec vous?...
«—Oui, Daja, venir avec moi à Madras...
«Alors cette pauvre fille, tremblant de tous ses membres et n'ayant pas sans doute la force de me répondre, me regarda comme en extasse, joignit ses deux mains avec force, et me fit signe de la tête qu'elle y consentait.»
—Et vous emmenâtes cette créature? me demanda Jenny.
«Oui, ma chère, dans un douli que je pus me procurer; et je repartis pour Madras avec ce bon Duclos, qui m'apporta son plan, et crut qu'une haute combinaison diplomatique se liait et au mystérieux douli dont il ne soupçonnait pas le contenu, et au plan qu'il avait levé par un soleil ardent.
«Enfin le bon homme oublia sa marche rétrograde. Seulement un soir en me montrant son verre qu'il allait porter à ses lèvres, il me dit:—Voyez-vous, quelqu'un maintenant me dirait: Vous vous attendez à boire un verre d'arack, et à vous coucher après, n'est-ce pas, monsieur Duclos? Eh bien! non, au lieu de cela, vous allez vous en aller mesurer la pagode de Mehemonpa, à douze milles d'ici. Je répondrais à ce quelqu'un-là: Cela ne m'étonnerait pas...
«—Et vous auriez raison, dis-je à Duclos, qui pourtant cette fois huma son verre d'arack, et passa la nuit comme il s'était proposé de le faire: car depuis que j'avais Daja je ne ménageais plus de surprise à mon compagnon.»
—Ah ça? mais le sacrifice? me demanda Jenny; jusqu'ici il me semble que c'est vous.
—Attends donc, lui dis-je en voulant l'embrasser.
Elle me repoussa..... en me disant: Une fille... ah!...
—C'est-à dire, Jenny, une fille, oui, mais qui, par une bizarrerie singulière, était restée pure au milieu de cette troupe ambulante. Elle ne s'y était engagée que depuis environ six mois; jusque-là elle avait vécu chez sa mère. Mais, dans une de ces guerres sans nombre qui ravagent le Carnate, sa mère avait été tuée, son champ dévasté, et pour vivre elle s'était en allée avec les daatcheries. Or, quand elle me vit, son cœur n'avait pas parlé; il parla, et elle me le dit tout naïvement.
—Et vous avez cru à cela? me dit Jenny...
—Mais que vous êtes singulière, Jenny! il faut bien que cela soit vrai, au moins une fois..., et cette enfant n'avait pas seize ans.
«En arrivant à Madras, je rendis compte à l'amiral de ma mission; je rompis quelques relations de société que j'avais dans la ville blanche, et même dans la ville noire, pour donner tout mon temps à Daja.»
—Mais c'était une passion, me dit Jenny d'un air moqueur.
«Mieux que cela, c'était un plaisir, et un plaisir de tous les jours. J'avais loué une assez grande maison avec un jardin épais et touffu qui s'étendait sur un étang dont l'eau était limpide, transparente comme du cristal: c'est dans ce délicieux séjour que j'avais établi Daja.»
—Et vous aviez mis cette fille sur un pied honorable, je suppose? me dit Jenny avec un sourire sarcastique.
«Fort honorable, ma chère: et puis la pauvre fille ne connaissait pas une âme dans Madras, ne sortait jamais; ses vêtements étaient des espèces de grands peignoirs de coton; elle couchait à la mode du pays, sur une natte de jonc, mangeait un peu de riz cuit dans de l'eau poivrée, et mâchait du bétel; vivant en vérité de paresse, de bains, d'amour et de soleil. Oh! si vous saviez, Jenny, quel plaisir c'était pour moi, au lever de l'aurore, quand les blanches fleurs du lotus étaient encore fermées et que les bandes de perroquets et de hérons n'avaient pas encore pris leur volée; et quel plaisir c'était d'aller avec Daja au bord de ce paisible étang, et de nous plonger dans cette onde fraîche et silencieuse, de voir l'adresse et l'agilité de mon Indienne qui l'effleurait à peine en nageant; de voir l'eau rouler en perles sur cette peau brune et veloutée!...»
Jenny fit un mouvement d'impatience.
«Et puis, après le bain, j'allais à mon bord, et je revenais le soir. Alors, couché sur une natte, fumant mon kouka, je regardais Daja danser..., ou bien elle me chantait les chansons de son pays, un khyourou, un giet, en accompagnant sa belle voix sonore du péha, espèce de guitare à trois cordes.
«D'autres fois elle me contait des histoires de son enfance, me parlait de ses dieux, de ses naïves croyances, de ses usages bizarres; conversation pleine d'intérêt, qui irritait ma curiosité sans la satisfaire.
«Tantôt, à la mode du pays, elle me proposait des énigmes et employait enfin, la pauvre fille, tous les moyens qu'elle pouvait imaginer pour me faire passer le temps; et puis, le soir, elle me préparait le riz avec une jatte de mologonier et d'eau aromatique, et nous partagions joyeusement ce frugal repas.»
—Mais en vérité, me dit Jenny, c'est touchant et digne de Bernardin de Saint-Pierre... C'est une pastorale; une idylle, qui eût inspiré Gessner.
—Ma chère amie, lui répondis-je, c'est à dix-huit ans qu'on fait des idylles en action; car alors on aime une femme, non pour soi, mais pour elle, on vit d'abnégation: aussi est-on généralement trompé ou malheureux comme les pierres; à vingt-cinq, on commence à vouloir sa part de bonheur; mais à trente, on devient égoïste et l'on aime tout-à-fait pour soi: au moins, si l'on est trompé, on a joui.
«Or, comme Daja m'amusait infiniment, et comme les cercles de Madras m'assommaient; comme les femmes y ressemblaient à tout et à rien, n'ayant ni naturel, ni charmes, ni originalité, et ne pouvaient me parler que de ce que je savais mieux qu'elles; comme il est toujours malheureusement temps d'en revenir à la civilisation, c'est-à-dire aux corsets et à une fade coquetterie, je m'arrangeai parfaitement de mon existence, et m'en arrangeai pendant trois mois, sans connaître un moment d'ennui, et sans voir âme qui vive.
—Je le conçois parfaitement, me dit Jenny; mais heureusement que la misanthropie a cela de bon, qu'elle débarrasse des misanthropes.
—Que voulez-vous, ma chère! quand on a beaucoup voyagé, on a tant de souvenirs, tant de points de comparaison, qu'on devient comme Louis XIV, difficile à amuser, ainsi que disait madame de Maintenon.
C'est un malheur..., mais c'est comme cela c'est à prendre ou à laisser. Revenons à Daja. «Un jour, que je lui avais promis de la mener à deux lieues de Madras, par mer, voir une pagode assez renommée, par des raisons que vous concevez, ne voulant pas prendre d'embarcation de ma frégate, j'avais loué une chelingue qui devait me transporter moi, Daja et une vieille métisse qu'elle avait prise pour la servir. Nous arrivâmes sur la côte, la chelingue attendait avec son randel ou patron, et six rameurs.
«Nous y entrâmes, et j'ordonnai de gagner au large.
«A peine à vingt brasses du bord, je m'aperçus que la diable de chelingue était horriblement chargée: car il ne restait pas six pouces de ses œuvres mortes hors de l'eau.
—Chien, dis-je au patron en m'avançant sur lui, pourquoi as-tu chargé ainsi cette chelingue, sans m'en prévenir? tu vas retourner à terre ou je te casse la figure avec cette rame.
—«Dieu est grand, me dit cet animal avec son sang-froid—Mais, quoique Dieu fut grand il était trop tard, nous nous trouvions au milieu des brisants. Le premier nous prit la poupe, et nous emplit à moitié. La damnée barque était si lourde que j'eus beau me mettre au gouvernail, il me fut impossible de la manœuvrer. Un second brisant nous emplit tout-à-fait.
—Il n'y avait pas une minute à perdre.—Daja, suis-moi, dis-je à l'Indienne en me précipitant dans la mer, sans inquiétude sur son sort, car elle nageait comme une dorade.
«A peine étais-je à l'eau qu'un autre brisant me passa en grondant sur la tête; je plongeai pour prendre fond et d'un vigoureux coup de pied, je revins à la surface de l'eau; au loin je vis les rames de la chelingue, et près de moi Daja, qui poussa un cri de joie en se précipitant de mon côté, et me disant de m'appuyer sur elle si j'étais fatigué.... Je remerciai Daja..., lui offrant au contraire mon secours, et lui conseillant de me suivre pour éviter les récifs à fleur d'eau; car j'avais sondé cette côte, et je la connaissais comme ma chambre.
«Nous nageâmes ainsi pendant quelques minutes, riant même de notre mésaventure; car nous avions le rivage à trois cents pas devant nous.
«Mais tout à coup je me sens entraîné à fond par un poids énorme; en plongeant je regarde: c'était la vieille métisse qui s'était accrochée à une de mes jambes, se rattrapant où elle avait pu; car elle était venue jusque-là entre deux eaux à moitié morte... C'était son agonie. Il n'y avait rien à en espérer; je tâchai de m'en débarrasser. Impossible. Tout ce que je pus faire, ce fut de m'élever encore une fois au-dessus de l'eau, et de crier;
«Cette bonne créature, effrayée vint aussitôt, et me dit de m'appuyer de mes deux mains sur ses épaules, tandis qu'elle nageait seulement avec ses pieds. Je le fis car la damnée métisse ne me lâchait pas, et j'étais dans l'impossibilité de faire un mouvement. Daja s'agitait avec violence, et avançait quelque peu en criant au secours.—Lorsque tout à coup la s... métisse me mord au genou en expirant, et ce mouvement nous fait couler à fond Daja et moi.»
—Heureusement que vous êtes revenu, me dit Jenny avec sang-froid.—Heureusement, lui dis-je...
«Déjà fort affaibli, je perdis connaissance, et un brisant, m'emportant à ce qu'il paraît, me jeta sur un écueil à fleur d'eau, où je me fis cette blessure à la tête dont vous me demandiez l'origine. Enfin, toujours est-il qu'environ quinze jours après ce fatal événement, je revins complètement à moi: j'étais couché à terre à l'hôpital.
«Auprès de moi était ce bon et excellent Duclos.—Ah! cordieu! me dit-il en me voyant ouvrir les yeux, ce n'est pas sans peine.. Comment êtes-vous?... Vous nous avez joliment inquiétés...
—«Je me sens bien faible, lui dis-je en tâchant de rappeler nos souvenirs... Et Daja?
—«Qui ça, Daja?... un chien.
«Je réprimai un mouvement d'impatience.—Savez-vous où est Fritz, mon valet de chambre, monsieur Duclos?...
—«Il est sorti, et va revenir dans une heure.
—«Dans une heure... c'est bien long. J'attendrai...
—«Je crois bien, que vous attendrez!..... Ah dame! ça ne sera plus comme dans ce diable de voyage où vous me faisiez trotter de çà, de là, et où je n'étais sûr de dormir ma nuit que le lendemain matin en me réveillant... Cette fois du plan de Jaffanapatnam..., vous rappelez-vous?
—«Que dit-on de nouveau, monsieur Duclos? lui dis-je, pour écarter ces souvenirs qui m'étaient cruels, dans l'état d'incertitude où je me trouvais sur le sort de Daja.
—«Oh! une bonne histoire, figurez-vous donc; ça court tous les salons de la ville blanche; figurez-vous qu'à ce qu'il paraît un des officiers de la division entretenait une fille du pays... Très bien.—C'est-à-dire, je dis très bien,—ce n'est pas dire qu'il l'entretenait très bien, ça ne me regarde pas;—c'est une réflexion que je fais... Très bien.—Voilà donc que ça le tenait tant et tant, qu'il n'allait plus dans les sociétés, et que les dames de sociétés se dirent: il faut ravoir ce charmant garçon qui faisait les délices de nos fêtes et pour le ravoir il faut lui faire farce..... Vous ne savez pas la farce qu'on lui a faite? Devinez!
—«Dites... dites donc...—Et j'étais pâle comme la mort, Jenny..., car je ne sais quel effroyable pressentiment me brisait le cœur.—Duclos continua...
«C'est-à-dire, la farce, pas à lui..., mais à l'autre..., à la fille... L'officier, que, sur l'honneur, je ne connaissais pas, était malade..... Qu'est-ce qu'on va faire?—On dit à la fille: Serviteur..., de tout mon cœur... Votre amant est mort, n'y pensez plus et retournez dans votre pays, la belle aux yeux doux...
«—On a fait cela!... Qui a fait cela... Duclos?... m'écriai-je en me jetant à demi hors de mon lit...
«—Ma foi! je n'en sais rien, moi je ne vais pas dans le monde, et c'est du commissaire que je tiens cette histoire... Qui a fait cela? peut-être les dames et les messieurs qui voulaient ravoir l'officier qui était si charmant garçon. Ecoutez donc, dans une fichue ville comme Madras, il est bien naturel de tenir à sa société... Mais ce n'est pas tout.
«—Comment, ce n'est pas tout!...—Et je croyais rêver, Jenny, en parlant à Duclos, j'écoutais machinalement...
«—Mais non... Voilà que ma bête de fille, qui croit ça, mais voyez jusqu'où va le fanatisme et la superstition de ces imbéciles-là..., voilà-t-il pas que ma bête de fille, qui croit ça, n'en fait ni une ni deux. Sachant bien qu'elle ne peut avoir le corps de son amant qu'elle croit mort, parce que dans notre religion nous n'avons pas la folie de nous brûler comme eux après le de profundis qu'est-ce que fait donc mon enragée de fille? Elle ramasse toutes les nippes qu'elle avait de l'officier, en fait un bûcher, et v'lan se brûle dessus, au chant de leurs animaux de prêtre, qui étaient enchantés de la chose, vu que la chose devenait rare.
«Voilà à peu près tout ce que j'entendis, Jenny; car un affreux tremblement me saisit,—une sueur froide m'inonda... Je n'eus que le temps de crier Daja, et je m'évanouis.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pendant cette longue et cruelle narration, j'avais attentivement regardé Jenny, et rien que de l'étonnement, de la surprise, ne s'était peint sur son joli visage.
—Eh bien me dit-elle, était-ce véritablement cette fille qui s'était brûlée, vous croyant mort?
—C'était elle, Jenny...
—J'avoue que c'est un genre de sacrifice que je ne comprends pas... Cette fille était folle...
A ce moment la femme de chambre de Jenny vint lui demander si elle voulait sa toilette.
—Sans doute, lui répondit-elle.
En effet, quelque sèche que fût l'âme de Jenny, cette histoire l'avait un peu remuée: son teint s'était animé, soit de dépit, soit de jalousie; elle se trouvait bien, et voulait profiter des avantages physiques que lui donnait son émotion... C'était si naturel!...
—Seriez-vous assez bon pour passer dans mon parloir, me dit Jenny; car je vais m'habiller, et je vous demanderai votre bras pour aller chez madame d'Arville?
—A vos ordres, Madame, lui dis-je et j'entrai dans le parloir.
Ces souvenirs de l'Inde m'avaient attristé; car cette époque de ma vie est une de celles que je tâche le plus d'oublier. J'étais triste, pensif, rêveur, quand Jenny reparut, éblouissante de beauté, d'élégance et de grâce.
Une idée me vint...
—Comment me trouvez-vous? dit-elle en se mirant à la glace... et finissant d'agrafer un bracelet.
—Ravissante, Jenny! jamais vous n'avez été plus jolie: ces yeux brillants..., ces joues rosées...
—A qui dois-je tout cela? dit-elle en me donnant sa main à baiser... N'est-ce pas à vous, à vos vilaines histoires, qui vous émeuvent malgré vous?...
Mais vraiment, ne suis-je pas trop rouge aussi?...
—Pas du tout, cela vous sied à ravir; mais puisque c'est à moi, Jenny, que vous devez tout cela..., sacrifiez-le moi, Jenny. Vous voilà belle, éblouissante, parée.... ne sortez pas. Ces souvenirs m'ont attristé...; je serais si heureux de passer ma soirée seul près de vous! Jenny....., le veux-tu?... Oh! je t'en prie! lui dis-je...
—Allons donc, dit-elle..... en riant..... Quelle folie! à quoi bon?... Je n'ai jamais été si bien; et vous voulez que je sacrifie cela..., à quoi?... à des rêveries... Si le sacrifice en valait la peine, à la bonne heure...
—Mais moi qui le demande..., j'en suis juge, Jenny...
—Vous êtes un enfant, me dit-elle. Puis sonnant:
—Julie..., ma voiture.
Je ne pus retenir un mouvement d'impatience.
—Holà!..., me dit Jenny de sa douce voix, de l'humeur! prenez garde; on m'entoure d'hommages, et si j'étais coquette...
—Quant à cela, ma chère, je ne suis plus un enfant, et je suis arrivé à ce point d'insouciance qui fait que je me contente d'une seule conviction.
—Et laquelle?...
—C'est qu'il est impossible qu'une femme ait deux amants à la fois. Or, avec de tels principes, on n'est jamais embarrassé sur le choix de ses maîtresses: aussi j'espère bien en trouver en Angleterre... où je vais.
—Ah! du dépit!... un départ!... c'est fort gai, dit Jenny nonchalamment.
—Du dépit! oh! mon Dieu, non; c'est un voyage arrangé depuis longtemps; car voilà un siècle que cette petite Louisa me tourmente pour voir le pays des vrais mylords, comme dit la naïve enfant... Si vous doutez du voyage, on vient justement de me donner une lettre de mon carrossier... Lisez.
Jenny prit brusquement la lettre et lut:
«J'ai l'honneur de prévenir monsieur, que sa dormeuse et son briska seront prêts demain vendredi, ainsi que les caisses à chapeau de femme, etc.»
—Ainsi, Monsieur, vous partiez..., sans me prévenir, sans égards..., sans mesure...
—Oh! voyez-vous, Jenny, je hais à la mort les scènes de départ... Et puis, j'aurais écrit à ce cher Octave.
—A merveille, Monsieur!... vous me quittez le premier, vous partez, vous avez le beau jeu...
—Ecoutez donc, ma chère, on joue, c'est pour cela.
Et lui baisant la main, je sortis. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je fis mon voyage d'Angleterre, et je laissai Louisa à lord Nottington qui me la demanda.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ce monsieur occupait le premier étage d'une fort belle maison toute neuve dans la Chaussée-d'Antin.
C'était une suite de pièces meublées avec un luxe écrasant; c'était une profusion de soieries, de dorures et de glaces, de bronzes d'un modèle fort cher, mais fort commun, de ces gravures magnifiquement encadrées, que tout le monde peut avoir; mais pas un tableau, mais rien d'intime, mais rien qui pût révéler un goût de prédilection, mais pas un portrait, pas un de ces meubles anciens auxquels se rattachent souvent tant de souvenirs d'enfance ou de famille; en un mot, tout dans cette maison était riche, neuf, opulent, et pourtant cette maison paraissait vide, triste et déserte.
Dans l'antichambre il y avait des laquais splendidement habillés, mais de livrées de mauvais goût; dans l'écurie il y avait de beaux chevaux, sous les remises de belles voitures; mais tout cela manquait de cet ensemble, de cette tenue, de ce je ne sais quoi, de ce rien qui est tout, car sans lui tant de belles choses sont souvent bien près d'être extrêmement ridicules.
Ce jour-là, sur le midi, M. de Noirville, enveloppé d'une admirable robe de chambre, bâilla, rumina, se détira, et se mit à une des fenêtres de son salon, qui s'ouvrait sur la rue la plus affreusement bruyante de cet étourdissant quartier.
Or, M. de Noirville ne se logeait jamais que sur la rue; car c'était un plaisir et une occupation pour lui que de regarder passer les passants.
Après deux heures employées avec autant de fruit, il demanda ses chevaux et alla se promener au bois. Maintenant, disons quelque chose de M. de Noirville.
M. de Noirville était un assez bel homme, mais trop obèse, haut en couleur, et atteignant à peine sa trentième année.
Avant que de s'appeler de Noirville, il se nommait simplement Corniquet; mais ses amis, trouvant que ce nom n'avait pas le sens commun et les humiliait au possible quand ils le prononçaient en public, M. Corniquet l'avait changé pour celui d'une de ses terres, Noirville, qu'il choisit parmi cinq ou six propriétés magnifiques que lui avait léguées son père, feu M. Grégoire Corniquet, d'abord chaudronnier, puis démolisseur, puis usurier, puis enfin riche à millions.
Malgré son immense fortune, M. Corniquet avait été loin de donner une brillante éducation à son fils; il l'avait envoyé interne dans un collége de Paris, avec un trousseau complet, un couvert d'argent et dix sous par semaine; puis tranquille sur l'avenir intellectuel de ce fils chéri, il avait continué de prêter son argent à cent pour cent d'intérêt.
De sorte que ce fils chéri, déjà d'une nature fort bornée, devint ce qui s'appelle un cancre en langage d'écolier; sale, déguenillé, sot et lourd, bafoué par ses camarades, il traîna sa paresse et sa bonasserie sur les bancs de toutes les classes jusqu'à l'âge de dix-huit ans; alors M. Corniquet père mourut, et M. Corniquet fils se trouva riche de cinquante mille écus de rente.
Le tuteur du jeune héritier était un ami de son père, un homme qui, s'étant aussi enrichi dans les affaires, voyait une compagnie, sinon fort bonne, au moins fort nombreuse.
Ce digne tuteur prit chez lui son pupille, le nettoya, le siffla, le dégrossit un peu, et le lâcha au milieu de sa société, qui l'accueillit comme elle accueillait tout être ayant une valeur intrinsèque de cinquante mille écus de rente.
Au bout d'un an, M. Corniquet, se trouvant émancipé et maître de sa fortune, se lia avec des jeunes gens à peu près aussi riches et aussi nuls que lui: ce fut alors qu'il changea de nom.
Comme ses amis, il dépensa quelques milliers de louis en plaisirs assez grossiers; puis, par un instinct conservateur que lui avait légué son père, se voyant en avance d'une année de revenu, il s'arrêta tout-à-coup, calcula fort sagement ses recettes et ses dépenses, et, chose fort rare pour un homme de vingt-cinq ans, il prit le parti d'économiser un tiers de son revenu et de vivre fort grandement d'ailleurs avec le reste.
En effet, il eut des chevaux, une fille de théâtre, une maison à lui, un cuisinier et un équipage de chasse, qui lui valut le titre de louvetier de son département.
Malgré cet instinct d'ordre qui le dirigeait dans l'administration de la fortune, M. de Noirville était un sot accompli, sans l'ombre d'esprit naturel, n'ayant rien su, rien appris, rien fait, rien pensé, n'étant pas même doué de cette oisive curiosité qui fait chercher quelque distraction dans les arts; non, il vivait comme l'huître sur son banc, sans passions, sans chagrins, sans idées: ne possédant pas la moindre délicatesse de choix ou de goût, il prenait l'opulence pour l'élégance et la richesse pour le plaisir, car il ne connaissait de bonheurs que ceux qu'on paie avec l'or.
Fort indifférent d'ailleurs pour le souvenir de son père qui l'avait enrichi, il lui en savait à peu près autant de gré qu'on en a pour un banquier qui vous a fait faire une bonne affaire.
Après cela, quoique d'une espèce commune, M. de Noirville n'avait pas de façons par trop mauvaises; son tailleur l'habillait passablement; ses amis disaient qu'il était très bon enfant; sa position de fortune lui donnait assez d'influence dans le monde qu'il voyait. Enfin, il se trouvait fort heureux, et il atteignit sa trentième année en s'amusant de tout ce qui pouvait amuser un homme d'une stupidité désespérante.
Pourtant ce bonheur eut un terme, et quoique nous ayons vu M. de Noirville vêtu de sa belle robe de chambre, et occupé à regarder les passants avec un plaisir si profondément senti, une amère et pénible mélancolie était sur le point de l'accabler.
En effet, les événements les plus cruels semblèrent s'être réunis pour le désoler. Dix de ses meilleurs chiens venaient d'être décousus dans une chasse, une fille d'Opéra, qu'il payait fort cher, avait pris la fuite avec son coiffeur, et il s'était aperçu que son maître-d'hôtel le volait.
En se promenant au bois, M. de Noirville réfléchit mûrement sur la fatalité qui le poursuivait, et il trouva que le seul moyen de remédier désormais à de pareilles mésaventures était de se marier. «Une fois marié, se dit-il, je n'aurai plus besoin de maîtresse (car M. de Noirville avait des principes fort arrêtés); ma femme s'occupera de ma maison, et mon maître-d'hôtel ne me volera plus; et puis d'ailleurs il est probable que je me suis assez amusé, car, depuis deux mois, je m'ennuie à crever. Or, j'aime mieux m'ennuyer avec ma femme que tout seul. C'est dit, demain j'irai trouver mon notaire; car, pardieu, il faut que je me marie le plus tôt possible.»
Et le lendemain son notaire lui disait:—Puisque vous êtes assez galant homme pour ne pas tenir à la fortune, mon cher monsieur, j'ai votre affaire; une demoiselle d'Elmont, d'une très grande famille, jolie et élevée dans la perfection. Ce soir même, j'en parlerai à son oncle, qui sera aux anges; car, pour elle, c'est un quine à la loterie qu'une telle union.
Et, selon l'usage, parce qu'un imbécile avait été trompé par une danseuse, volé par un laquais, et s'ennuyait de sa propre sottise, voilà que l'avenir d'une pauvre jeune fille, qui n'en peut mais, se trouve, dès ce moment à peu près enchaîné au sort de cet homme auquel elle n'a jamais pensé.
Cécile d'Elmont était parfaitement née; son père, le marquis d'Elmont, ayant perdu à la révolution une fortune qu'il avait réalisée presque tout entière en valeurs sur l'État, ne trouva, dans l'indemnité, qu'une fraction bien minime de ce qu'il possédait.
Chargé à cette époque d'une mission diplomatique fort importante, et tenant à représenter dignement son pays, M. d'Elmont dépensa ainsi une portion de ce que la Restauration lui avait rendu; les dettes qu'il avait été forcé de contracter pendant l'émigration absorbèrent le reste, et lorsqu'il mourut, sa femme et sa fille se trouvèrent réduites à une pension fort médiocre.
La marquise d'Elmont ne survécut pas longtemps à la perte de son mari, et Cécile fut confiée aux soins d'un de ses oncles, le comte d'Elmont, excellent homme, colonel en retraite, qui s'était rallié à l'empereur, avait fait toutes ses campagnes, et rongé de blessures et de rhumatismes, vivait modestement de sa solde; car sa part d'indemnités à lui avait en partie passé au jeu, ce dont il se repentit amèrement, lorsqu'il se vit chargé de pourvoir à l'avenir de sa nièce.
Cécile n'était pas rigoureusement belle; mais elle avait une de ces physionomies pleines de charme, de grâce et de distinction, dont l'attrait doit vivement frapper les gens d'un goût épuré, qui cherchent dans la figure d'une femme autre chose qu'une régularité froide et symétrique.
Tout en Cécile révélait une âme noble, grande, et surtout un esprit d'une excessive délicatesse: ayant toujours vécu dans le monde le plus choisi, façonnée par son père et sa mère aux habitudes les plus recherchées, dotée d'un tact exquis, don si précieux et si cruel à la fois, qui lui faisait éprouver des jouissances et des peines inconnues aux autres organisations, on ne pouvait reprocher à mademoiselle d'Elmont qu'une sorte de sauvagerie; et cette sauvagerie, on l'expliquerait peut-être par la crainte que Cécile éprouvait de rencontrer dans le monde des idées dont le prosaïsme l'eût douloureusement arrachée de la sphère de pensées d'élite, au milieu desquelles elle aimait à s'isoler.
Les pertes désolantes qu'elle avait faites augmentèrent son goût pour la rêverie et la solitude; frêle et nerveuse, ses impressions devinrent plus vives, puisqu'on dirait que le chagrin double la faculté de sentir; enfin ce sentiment de répulsion instinctive que Cécile éprouvait pour tout ce qui était vulgaire se prononça de plus en plus; car elle n'avait jamais apprécié la fortune que comme moyen de poétiser, par un luxe plein de goût, tout le matériel de l'existence.
Cécile vivait pourtant aussi heureuse qu'elle pouvait vivre depuis la mort de son père et de sa mère; son esprit étendu, profond et naïf, avait trouvé un charme consolant dans la lecture des livres saints et des chefs-d'œuvre de toutes les littératures.
Cette nature si distinguée s'assimilait ces nobles idées, ce magnifique langage, ces caractères imposants qui seuls pouvaient répondre à l'élévation de sa pensée ou à la pureté de son âme, et elle passait ainsi son existence en contemplant les visions splendides de ce monde intellectuel qu'elle évoquait.
Aimant aussi les arts avec passion, et surtout la musique, qui pour elle était la langue divine qui seule pouvait traduire les tristes et sublimes rêveries que lui inspiraient la religion, le souvenir de sa mère, ou l'amour éthéré qu'elle rêvait parfois. Aux arts aussi Cécile demandait des consolations et l'oubli du présent.
Elle resta donc dans la plus profonde retraite jusqu'au moment où son oncle lui fit part des propositions de M. de Noirville.
Ce jour-là, ne se doutant de rien, la pauvre Cécile était retirée dans le parloir qui précédait sa chambre à coucher.
Ce parloir était pour mademoiselle d'Elmont l'objet d'un culte religieux.
Lorsque le marquis d'Elmont avait quitté son ambassade, se voyant presque sans fortune, il avait dû choisir un appartement modeste; or, par le plus grand hasard, il trouva ce qui lui convenait dans l'ancien hôtel d'Elmont, propriété qu'il avait vendue avant la révolution, voulant réaliser sa fortune pour passer à l'étranger.
Ce fut donc dans le logement de garçon qu'il avait occupé du vivant de son père, que le marquis d'Elmont se retira avec sa femme et sa fille: c'était six petites pièces situées au troisième étage, et donnant sur le vaste et magnifique jardin de l'hôtel bâti dans le centre du faubourg Saint-Germain.
Le reste de l'habitation était loué à je ne sais quelle compagnie d'assurance.
Il fallait bien du courage pour braver ainsi tant de souvenirs amers, et, malgré cela, M. d'Elmont trouvait un charme doux et triste à pouvoir raconter à sa famille son enfance et sa jeunesse dans les mêmes lieux où elles s'étaient écoulées si heureuses et si insouciantes.
Il aimait encore à lui montrer le jardin où il jouait tout petit enfant, et le banc de marbre sur lequel sa grand'mère aimait à s'asseoir pour jouir des derniers rayons du soleil.
Ces vieux arbres, qui avaient vu sous leur ombrage tant de générations de cette ancienne famille, étaient pour M. d'Elmont autant de témoins muets de son opulence passée. Cette idée le consolait, et il éprouvait ainsi moins de chagrin à voir l'antique berceau de sa famille livré à des mains étrangères.
On conçoit avec quel respect Cécile conserva l'appartement qu'elle habitait dans cet hôtel; son oncle vint s'y établir avec elle, et elle se garda de changer rien à ses dispositions.
Ce parloir, qu'elle aimait tant, était la pièce où sa mère se tenait d'habitude; une harpe, un piano, un chevalet et une bibliothèque de Boulle, en faisaient les principaux ornements.
Les murailles étaient cachées par de vieux et nobles portraits de famille, par ceux de sa mère et de son père, puis, sur des étagères, on voyait une foule d'objets rares et précieux que M. d'Elmont avait rapportés de ses voyages, ou que des amis bien chers lui avaient donnés comme des souvenirs; çà et là on admirait encore quelques tableaux de l'école italienne ou hollandaise, un beau morceau de sculpture, ou une magnifique esquisse offerte par un de ces grands artistes de tous les pays, que le père de Cécile admettait avec tant de bonheur dans son intimité.
Enfin des jardinières remplies de fleurs garnissaient les fenêtres ombragées par la cime des hauts tilleuls du jardin et quelques camélias, ou quelque autre arbuste de prédilection, soigneusement placé dans un beau vase de vieux Sèvres bleu, aux armes de sa famille, ornait la table de travail de Cécile, car tout, dans cette retraite élégante et modeste, rappelait un ami, une impression ou un souvenir.
Mais ce qui surtout était d'un prix inestimable pour Cécile, c'était un antique nécessaire à écrire qui avait servi à sa mère pendant l'émigration, et qu'elle ne regardait jamais sans sentir ses yeux se mouiller de larmes.
Ce jour-là, nous l'avons dit, mademoiselle d'Elmont était loin de penser à la demande qui la menaçait.
Assise dans le fauteuil de sa mère, elle lisait..., son beau front appuyé sur sa main blanche et effilée, que les longues boucles de ses cheveux bruns voilaient sans la cacher; elle était vêtue d'une robe blanche, et chaussée avec la plus minutieuse élégance d'un petit soulier de satin noir, quoiqu'il fût encore de très bonne heure.
Une vieille femme de chambre anglaise, que la marquise d'Elmont avait conservée depuis l'émigration, heurta à la porte du parloir, entra et demanda à Cécile si M. le marquis (le colonel avait pris le titre de son frère) pouvait se présenter chez Mademoiselle.
Cécile répondit que oui.
La demande et la réponse furent faites en anglais; car mademoiselle d'Elmont parlait à merveille l'anglais, l'italien et l'allemand.
—Que peut donc me vouloir mon oncle, de si bonne heure? demanda Cécile.
Et je ne sais quel cruel pressentiment vint l'affliger.
Avant que de parler à sa nièce des intentions que lui avait manifestées le notaire de M. de Noirville, l'excellent colonel avait pris les renseignements les plus minutieux sur ce prétendu, et, il faut le dire, partout ils furent des plus satisfaisants.
En effet, sauf son origine, M. de Noirville était un homme fort honorable, qui, par une économie bien entendue, avait presque doublé sa fortune. D'un caractère facile, généreux sans prodigalité, ayant toujours mis la plus grande convenance dans les liaisons qu'il avait eues, obligeant, d'une figure assez avenante, homme de manières sinon distinguées, au moins décentes, monsieur de Noirville pouvait passer, aux yeux des gens les plus scrupuleux, pour ce qu'on appelle un excellent parti.
J'oubliais de dire qu'il était à peu près certain d'être nommé député dans un département où il possédait d'immenses propriétés.
Des avantages aussi positifs avaient frappé le marquis d'Elmont, qui, avouons-le, étant d'une nature assez peu clairvoyante, ne comprenait pas le moins du monde le caractère de Cécile, et qui, voyant un homme jeune, immensément riche, d'une figure agréable, demander la main de sa nièce, éprouvait le plus vif désir de voir cette union se conclure.
Or, le matin que vous savez, il entra chez mademoiselle d'Elmont, et lui dit brusquement:
—«Ma chère enfant, voilà ce qui arrive: un M. de Noirville, énormément riche, jeune, beau et bon garçon, qui sera bientôt député, vous demande en mariage. J'ai pris les renseignements, ils sont parfaits; seulement son origine est assez commune, son père était un parvenu; mais, au temps où nous vivons, on fait peu de cas des noms. Et puis d'ailleurs, ce garçon-là a l'espoir d'être député; une fois député, comme il est grand propriétaire, il peut bien devenir pair de France; quoique la pairie soit une bêtise maintenant, c'est un titre qui est toujours un peu plus décent que celui de député... Quelles sont vos intentions, mon enfant?...»
Cette proposition si inattendue et si étrange stupéfia Cécile, qui, à vrai dire, était bien loin de songer à se marier. S'isolant le plus possible de la réalité, elle s'était fait dans sa retraite un monde de pensées, où elle vivait tout entière; aussi répondit-elle d'abord à son oncle qu'elle ne voulait pas se marier.
«—C'est fort bien, mon enfant, dit le colonel; c'est fort bien quant à présent; mais que demain je meure, à qui vous confier? Voulez-vous que j'emporte avec moi la douloureuse incertitude de ne pas être fixé sur votre avenir que je voudrais voir si prospère et si beau? N'avez-vous pas promis à votre mère de vous fier à moi pour assurer votre sort?...»
A ces raisons, Cécile objecta qu'il fallait au moins qu'elle vît M. de Noirville.
Le surlendemain, il fut présenté chez le marquis.
Au premier abord, M. de Noirville déplut souverainement à Cécile; et après une conversation de cinq minutes, elle eut mesuré l'immense intervalle qui les séparait; aussi, lorsque la première visite fut terminée, elle déclara positivement à son oncle qu'elle aimerait mieux mourir que d'épouser jamais M. de Noirville.
Ce dernier continua nonobstant à se présenter chez le marquis, et Cécile persista plus que jamais dans ses refus.
En voyant la conduite de sa nièce, le colonel commença par se mettre en colère, puis il finit par se chagriner beaucoup, et sa santé s'altéra visiblement.
Aux yeux de cet excellent homme, Cécile passait pour folle et extravagante, et il s'affligeait profondément de la voir, de gaîté de cœur, manquer un aussi beau parti, et perdre ainsi son avenir.
—Mais enfin, qu'a-t-il pour vous déplaire? Trouvez-lui un défaut, un vice, et je me rends,—disait le colonel désespéré.—Est-ce son origine?
—Toutes les origines sont respectables quand elles sont honnêtes, disait Cécile.
—Mais alors, qu'avez-vous à lui reprocher?
—Rien; M. de Noirville est rigoureusement convenable.
—Et vous le refusez pourtant? et pourquoi?...
Cécile était dans une position cruelle. Son père et sa mère ne lui eussent jamais fait cette question, ou plutôt n'eussent jamais songé à M. de Noirville pour leur fille, eût-il été cent fois plus millionnaire qu'il ne l'était.
Comment expliquer au colonel quel était le sentiment de répulsion qui l'éloignait de ce prétendu, cela était au-delà du pouvoir de Cécile et de l'intelligence de son oncle.
Mademoiselle d'Elmont se fût résignée à passer pour folle et fantasque, si elle n'avait pas vu la santé de son oncle s'altérer par la peine qu'il éprouvait. Aussi n'eût-elle pas le courage de résister à cette douleur si profonde: elle se sacrifia.
Ce fut le mot qu'elle employa, et qui fit beaucoup rire le bon colonel, qui s'écriait en se frottant les mains:—«Se sacrifier à deux cent mille livres de rente et à un brave garçon qu'elle mènera comme elle voudra!.... Peste! on n'en fait pas tous les jours des sacrifices comme ceux-là...»
M. de Noirville était encore en robe de chambre, occupé de regarder les passants, lorsque son notaire vint lui annoncer qu'il était agréé.
—C'est fini, elle consent, lui dit l'homme de loi.
—Tant mieux, répondit son client, car je m'étais dit: Si au bout d'un mois, jour pour jour après ma présentation, elle me refuse, je chercherai ailleurs. Au reste je suis fort content, car mamzelle d'Elmont n'est pas une beauté, mais elle a une petite figure chiffonnée qui me revient assez; et puis, elle paraît avoir une très jolie éducation, et être assez bonne enfant: seulement je ne lui crois pas beaucoup d'esprit, car elle est taciturne en diable; mais j'aime mieux cela qu'une femme qui jabotte comme une pie borgne. Il y aurait bien encore quelque chose à redire, car elle a l'air bien maigre?
—Ma foi, je ne trouve pas, moi, dit le notaire, qui pensait au contrat.
—Mais bah! reprit son client,—sa première couche l'engraissera, comme on dit.
Ah çà! je ne vous parle pas de sa naissance, ajouta-t-il, car ça ne prouve rien. La preuve est que moi, qui suis fils d'un chaudronnier, j'épouse la fille d'un marquis.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les noces se firent et furent splendides, mais d'une splendeur horriblement bourgeoise.
La corbeille et les diamants valaient bien cent mille écus.
Aussi pendant huit jours tout Paris parla de la corbeille, et par conséquent du bonheur de mademoiselle d'Elmont, qui avait pourtant les yeux bien rouges en allant à l'autel.
Entre autres choses, elle pensait avec désespoir qu'il lui faudrait quitter son petit appartement du faubourg Saint-Germain, où se rattachaient tant de souvenirs, pour aller habiter le riche hôtel que M. de Noirville avait déjà acheté dans la rue de Londres.
Car une des habitudes de cette race d'hommes est de changer de demeure avec une effroyable facilité. En effet, que leur importe, qu'ont-ils dans la pensée qui puisse les lier au passé, au présent ou à l'avenir?
En revenant de l'église, M. de Noirville fit voir à sa femme tout son gros luxe, qu'elle admira médiocrement. Dans son boudoir, comme il disait, elle trouva un nécessaire à écrire tout en or et surchargé de pierreries.
M. de Noirville, en lui montrant le meuble d'un air étonnamment satisfait, dit à Cécile:
—J'espère que cela vaut un peu mieux que cette antiquaille qui était chez toi.
—Je ne vous comprends pas, Monsieur, dit Cécile, affreusement blessée de ce tutoiement si subit.
—Parbleu! c'est bien clair, je te dis que j'ai remplacé cette vieille machine à écrire que tu avais envoyée ici.
—Mon Dieu! qu'avez-vous fait de cet ancien nécessaire qui m'appartenait, Monsieur? s'écria Cécile, agitée par une crainte indéfinissable.
—Ma foi, je n'en sais rien, moi; c'est mon valet de chambre qui profite de tous ces vieux rogatons.
—Ah! Monsieur c'était l'écritoire de ma mère dit Cécile en pleurant.
—Console-toi, tu n'as pas tout vu, lui dit son mari, et, souriant, il ouvrit le nécessaire.
—Il y a là 20,000 fr., ce sont tes épingles, tu vois que je fais bien les choses, chère amie.
—Au nom du ciel! Monsieur, dit Cécile sans lui répondre, retrouvez-moi à tout prix le nécessaire de ma mère.
M. de Noirville prit ce désir pour un caprice de jeune fille, fit tout au monde pour avoir ce meuble; mais ce fut en vain, son laquais l'avait déjà vendu à un brocanteur qu'on ne rencontra plus.
Si l'imparfaite analyse de ces deux caractères a pu en donner quelque idée, on comprendra s'il est au monde une position plus horrible que le fut celle de mademoiselle d'Elmont lorsqu'elle se vit seule avec son mari, dans son immense hôtel.
Et pourtant, aux yeux du monde raisonnable, que lui manquait-il pour être heureuse?
Noirville, le 13 avril 18...
LETTRE DE M. DE NOIRVILLE A M. DUMONT, AVOCAT.
«Je te remercie bien, mon cher Dumont, des avis que tu me donnes sur l'expropriation que je médite; car, si on laissait faire ces canailles de fermiers, les fermes seraient les tombeaux de notre argent; sans être avare, je tiens à ce que j'ai; car si je n'en avais plus, personne ne m'en donnerait. Je te remercie bien aussi du modèle de four pour la pâtisserie; mon cuisinier en est enchanté, et par conséquent moi aussi; j'ai encore à te remercier de la consultation que tu m'as envoyée pour ma femme; depuis six mois que je me suis lancé dans le conjungo, comme on dit, c'est la septième ou huitième fois que j'ai recours aux médecins, et ce ne sera probablement pas la dernière; la santé de ma femme ne s'améliore pas du tout, au contraire, et personne ne conçoit rien à son état; il faut qu'elle ait une maladie de famille, quelque chose comme d'être poitrinaire, car elle maigrit à vue d'œil, ce qui n'est pas très agréable pour moi; car elle n'était pas déjà trop grasse: aussi je fais tout ce que je peux pour qu'elle mange de la viande et de la pâtisserie, ça lui donnerait du corps; mais il n'y a pas moyen; moi, j'en mange toujours, et cela me profite si bien que j'engraisse pour deux, et que si j'ai quelque chose, c'est trop de santé. Ma femme a perdu ce vieil oncle qu'elle avait; entre nous, je n'en suis pas fâché, car il était sans cesse à me relancer pour savoir pourquoi sa nièce était triste comme un bonnet de nuit: est-ce que j'en savais quelque chose, moi? Et au fait, que lui manque-t-il pour être heureuse? Voitures, hôtel à Paris, diamants, loge aux Bouffons et à l'Opéra, belle terre, bonne table et bon feu, elle a tout, aussi je suis tranquille comme Baptiste. Ma conscience est satisfaite, puisque je fais tout pour son bonheur, et elle le mérite, mon cher Dumont, car elle mène très bien ma maison: je n'ai plus ces peurs que j'avais avant mon mariage, d'être volé par mon maître d'hôtel; c'est elle qui se mêle de tout ça, je ne m'en occupe plus; je dors sur les deux oreilles, comme dit le proverbe; je deviens gourmand comme un dindon et gros comme un tonneau; c'est moi qui ai un ventre maintenant! mais ça m'est égal, car je n'ai, tu le sais bien, jamais tenu à être un céladon, et encore bien moins depuis que je suis marié.
«Et, en vérité, je ne suis pas fâché de l'être...—Ah! tiens, de l'être!... c'est comme dans une pièce des Variétés. Non, d'être marié! entends-tu, farceur de Dumont; pas d'équivoque. Car c'est un ange que ma femme; seulement, tout ce que je craignais, c'est qu'étant noble, elle fût fière. Eh bien! pas du tout, au contraire, car je n'ai jamais pu l'habituer à me tutoyer, tandis que moi, je l'ai tutoyée tout de suite, dès le premier jour de mes noces.
«Nous voyions peu de monde dans les commencements de notre mariage. Elle avait quelques-unes des connaissances de sa famille qui venaient la voir, petit à petit tout ça s'est éloigné, et je n'ai plus vu chez moi ou ailleurs que ma société à moi; mais ma femme n'y va presque jamais: entre nous, je conçois son éloignement; car dans ma société, elle a paru gauche, pas très jolie et un peu bête. Entre nous, Dumont, un mari peut bien juger sa femme. Eh bien! moi, je ne la crois pas très forte, comme on dit; après ça, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir de l'esprit; n'est-ce pas, Dumont?
«Ce qui la rend si triste parfois, ma femme, c'est peut-être aussi qu'elle a été jalouse de l'effet de cette belle mademoiselle Germon, la fille du fournisseur, qui fut mariée en même temps que nous deux ma femme, une créature superbe, qui avait des couleurs magnifiques, une poitrine admirable, enfin une prestance de reine, et de l'esprit! Ah! que d'esprit! Un vrai boute-en-train, une rieuse, qui, à la campagne, était toujours pour qu'on fit des niches dans les chambres, et qui par farce veut faire ses enfants protestants, pour taquiner le curé de sa campagne.
«Tu conçois bien qu'auprès d'une femme aussi amusante, la mienne devait être joliment enfoncée, avec sa figure pâle, sa taille à croire qu'on allait la casser en soufflant dessus, et son air triste et presque bégueule. Après ça, ce que je crois, vois-tu, Dumont, c'est qu'elle est triste parce que c'est son caractère d'être triste; on naît comme ça, et on n'en est pas plus malheureuse; c'est dans le sang, comme on dit. Aussi je ne m'en inquiète guère. Qu'est ce qu'il lui manque à ma femme? N'est-ce pas, Dumont?
«Quant à être bégueule, c'est la mauvaise éducation qui donne ce défaut-là. Et à propos de ça, tu sais bien, Bercourt, cet agent de change qui est si spirituel, qui est ventriloque, imite le basson à s'y méprendre, et lit si drôlement les charges de Monnier; Bercourt, qui vivait maritalement avec la petite Augusta. Eh bien! ma femme l'a relevé si durement une fois qu'il disait, sur les prêtres et les religieuses, des choses pourtant pas trop fortes pour une femme mariée, que ce pauvre Bercourt n'a plus osé revenir chez nous.
«Voilà comme c'est arrivé: pendant que Bercourt continuait de dire ses bêtises, qui me faisaient rire comme un bossu, voilà que ma femme a sonné, et de son air de princesse, que je ne lui ai vu prendre du reste que cette fois, elle a dit au domestique, en lui montrant ce pauvre Bercourt d'un geste très insolent: Monsieur demande si ses gens sont là. Tu conçois bien qu'il s'en est allé tout de suite et tout penaud: ce qui m'a vexé, car il était bien amusant. Enfin, mon cher Dumont, je suis ici à Noirville depuis le mois d'avril; car ma femme a voulu quitter Paris avant l'hiver terminé. Je chasse, je mange et je dors, voilà ma vie qui n'est pas trop mauvaise, comme tu vois; et surtout je ne m'occupe pas de ma maison; comme ma femme ne parle pas beaucoup, j'ai imaginé un moyen pour passer nos soirées plus agréablement; j'ai fait monter un tour dans mon salon, et je tourne pendant que ma femme lit son anglais, ou rêvasse à je ne sais quoi; j'aurais bien aimé qu'elle me fasse de la musique pour m'endormir, mais elle n'a pas voulu, sous le prétexte qu'elle ne peut faire de la musique que toute seule, ce qui m'a fait soupçonner qu'elle joue très mal de la harpe, ce que je saurais si j'étais musicien; mais je n'ai jamais pu apprendre une note; car c'est une fière bêtise que la musique, n'est-ce pas, Dumont?
«Enfin le soir, à dix heures sonnant nous nous couchons. Et à propos de ça, est-ce que ma femme ne s'était pas imaginé d'avoir son appartement séparé; mais pas de ça, Lisette, et comme quand je veux une chose, je suis têtu comme un mulet, nous vivons à la bourgeoise, comme on dit. A propos de cela, tu sais que tu es de droit le parrain de mon premier (si j'ai un premier)!
«En voilà bien long pour ne te dire que des balivernes, mon cher Dumont; viens donc à Noirville aux vacances; tu nous apporteras ta Gazette des Tribunaux, que tu lis d'une manière si farce, en imitant la voix des juges et des accusés; mais, ce qu'il y aura d'ennuyant, c'est qu'il faudra gazer, à cause de ma bigote de femme; car, j'oubliais encore ça, elle est bigote; mais je lui passe ça, on dit que c'est d'un bon effet pour les domestiques.
«Adieu, mon cher Dumont; je t'envoie ci-joint une autorisation pour retirer des fonds de chez ***, tu les emploieras à acheter de la rente de Naples, si elle continue à être en baisse.
«Adolphe DE NOIRVILLE.»
FIN DU DEUXIÈME VOLUME.
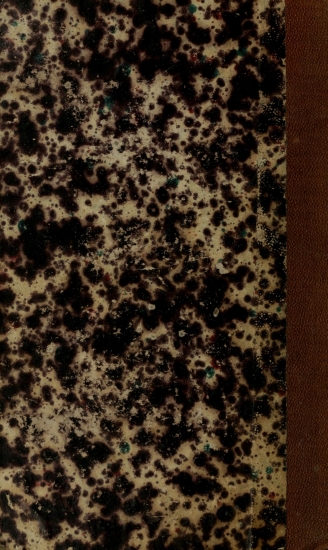
End of the Project Gutenberg EBook of La coucaratcha (II/III), by Eugène Sue
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LA COUCARATCHA (II/III) ***
***** This file should be named 39024-h.htm or 39024-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/3/9/0/2/39024/
Produced by Chuck Greif and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was
produced from images available at The Internet Archive)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.