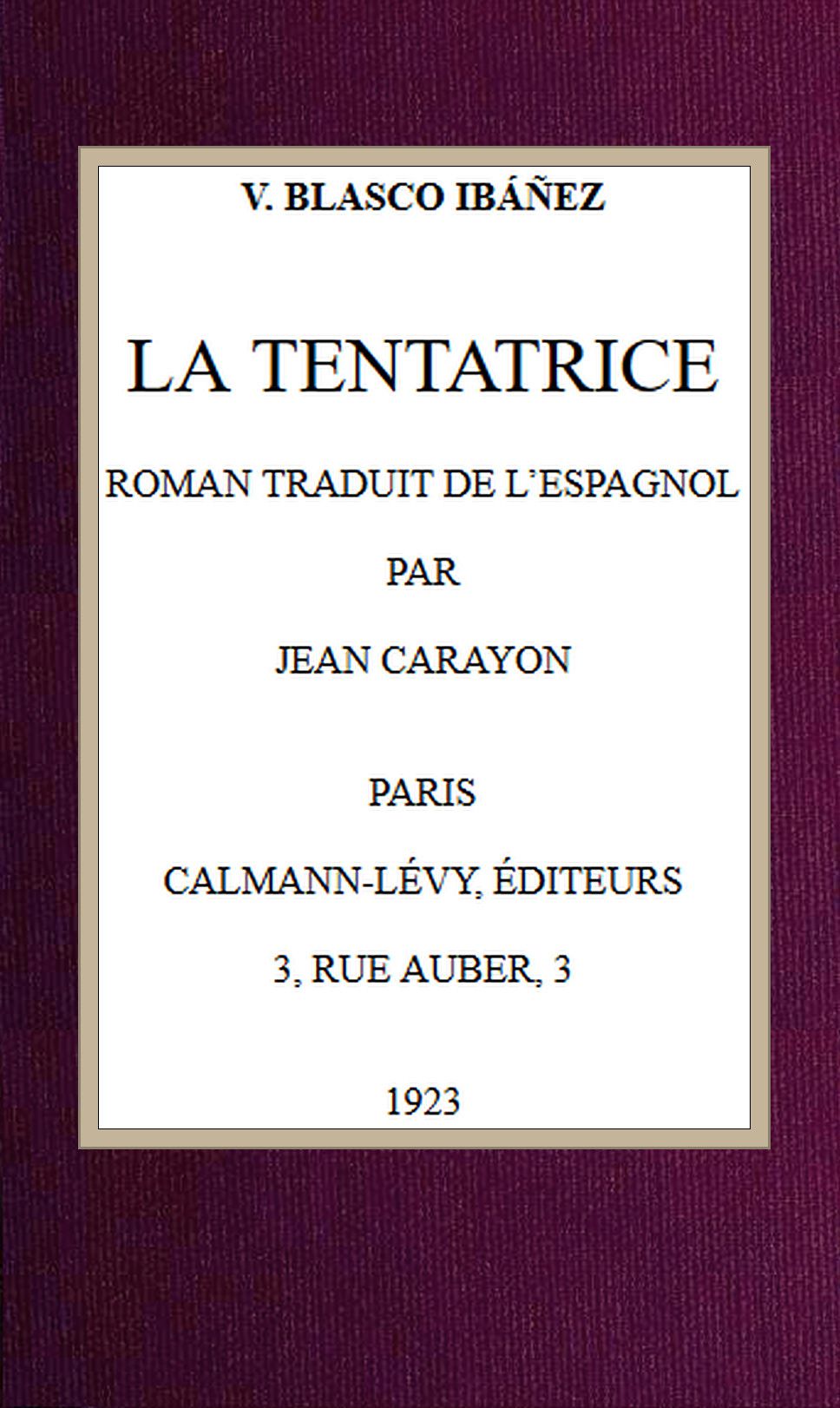
The Project Gutenberg EBook of La tentatrice, by Vicente Blasco Ibáñez This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: La tentatrice Author: Vicente Blasco Ibáñez Translator: Jean Carayon Release Date: September 24, 2020 [EBook #63284] Language: French Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LA TENTATRICE *** Produced by Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images at Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)
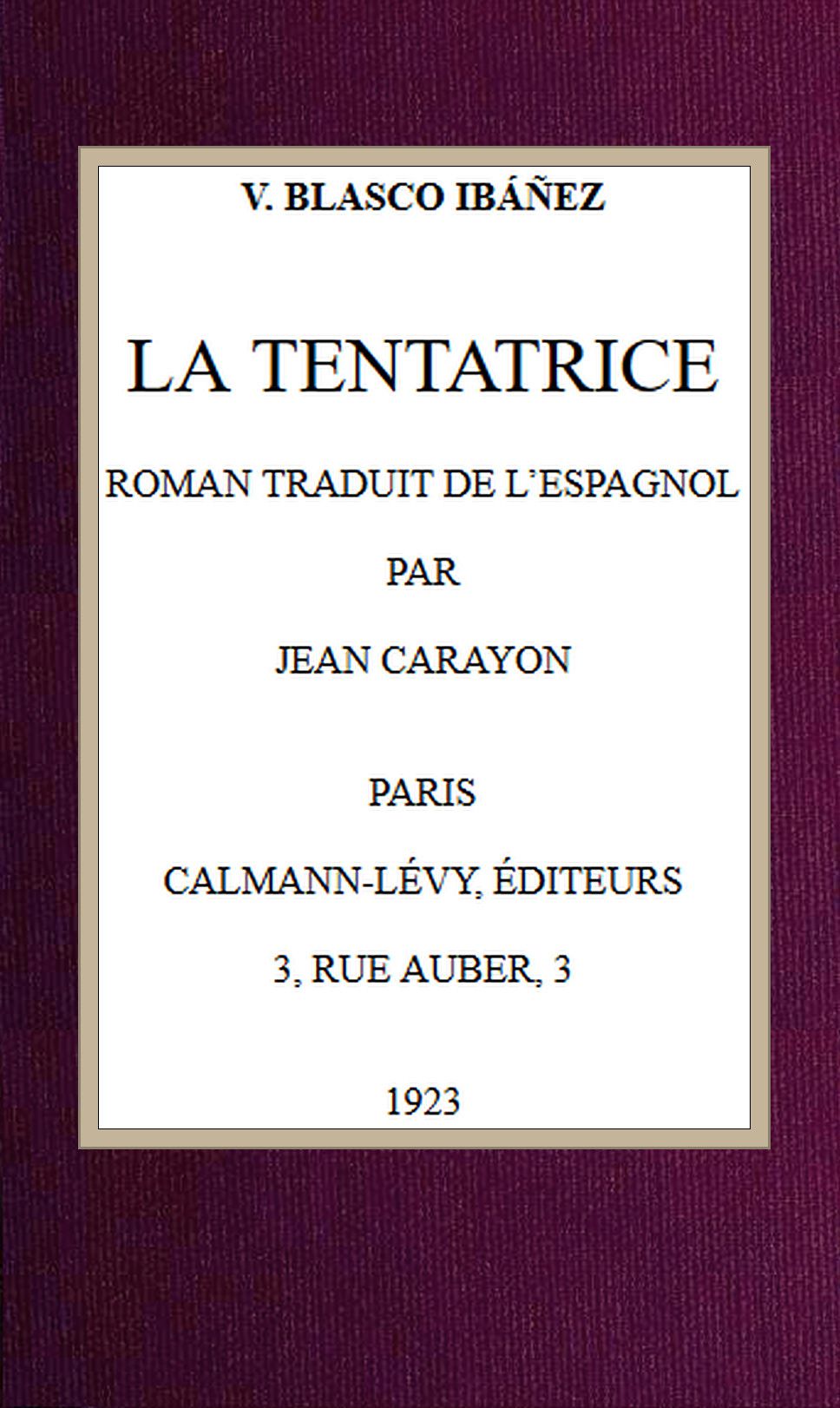
LA TENTATRICE
CALMANN-LÉVY, ÉDITEURS
DU MÊME AUTEUR
Format in-18.
| ARÈNES SANGLANTES | 1 | vol. |
| FLEUR DE MAI | 1 | — |
| DANS L’OMBRE DE LA CATHÉDRALE | 1 | — |
| TERRES MAUDITES | 1 | — |
| LA HORDE | 1 | — |
| LES QUATRE CAVALIERS DE L’APOCALYPSE | 1 | — |
| LES ENNEMIS DE LA FEMME | 1 | — |
| LA FEMME NUE DE GOYA | 1 | — |
Droits de reproduction et de traduction réservés pour tous les pays.
Copyright 1923, by CALMANN-LÉVY.
E. GREVIN—IMPRIMERIE DE LAGNY
V. BLASCO IBÁÑEZ
ROMAN TRADUIT DE L’ESPAGNOL
PAR
JEAN CARAYON
PARIS
CALMANN-LÉVY, ÉDITEURS
3, RUE AUBER, 3
1923
Il a été tiré de cet ouvrage
QUARANTE EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE HOLLANDE,
tous numérotés.
| I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. |
Le titre du roman espagnol est «La tierra de todos» (La terre de tous), mais pour les éditions en langue anglaise, récemment publiées à New-York et à Londres, les traducteurs ont choisi le titre: «The Temptress» (La Tentatrice). Cet exemple a été suivi par d’autres traducteurs étrangers et nous avons cru devoir adopter le même titre pour la version française.
«La Tentatrice», l’avant-dernier roman de Blasco Ibañez, publiée en Espagne en 1922, connaît actuellement, dans les pays de langue anglaise, un prodigieux succès. C’est l’œuvre la plus personnelle de l’illustre écrivain espagnol, car on y trouve un reflet de sa vie aventureuse dans les solitudes sud-américaines. Le lecteur français n’ignore pas que Blasco Ibañez, romancier universellement célèbre, fut aussi un homme d’action, un bâtisseur, de villes, animé de toute la flamme créatrice des anciens conquistadors[1].
C’est après avoir volontairement mené la dure et courageuse existence des défricheurs de terres vierges que le grand romancier écrivit cette œuvre vigoureuse. Scènes et personnages y sont décrits avec un saisissant relief par un des plus puissants conteurs de ce temps.
JEAN CARAYON.
{1}
Comme il faisait tous les matins, le marquis de Torrebianca sortit tard de sa chambre et montra quelque inquiétude à la vue du plateau d’argent chargé de lettres et de journaux que son domestique avait laissé sur la table de la bibliothèque.
Si les timbres des enveloppes étaient étrangers, il se rassérénait comme après un péril esquivé. Si les lettres venaient de l’intérieur de Paris, il fronçait le sourcil et se préparait à mainte amertume, à mainte humiliation. D’ailleurs, l’en-tête de plus d’une lui rappelait le nom de créanciers tenaces et laissait deviner d’avance leur contenu.
Sa femme, la «belle Hélène», comme on l’appelait, pour sa beauté réelle, mais si longtemps maintenue, qu’au dire de ses bonnes amies elle entrait déjà dans l’histoire, recevait de telles lettres sans beaucoup s’émouvoir, et paraissait à l’aise depuis toujours parmi les dettes en retard et les rappels pressants. Pour lui, il se faisait de l’hon{2}neur une idée plus vieillotte et pensait qu’il est bon de ne pas s’endetter ou du moins, si l’on y est forcé, de payer ses dettes.
Ce matin là, il y avait peu de lettres de Paris: une d’elles venait de la maison qui avait vendu à la marquise sa dernière automobile, payable en dix versements, et n’en avait encore reçu que deux; d’autres avaient été écrites par des fournisseurs (toujours de la marquise) établis aux alentours de la place Vendôme, et par divers commerçants plus modestes qui livraient à crédit les articles nécessaires à la vie large et confortable du ménage et de ses domestiques.
Ces derniers auraient été bien fondés d’adresser à leur maître des réclamations identiques, mais ils se fiaient à l’habileté mondaine de madame, qui saurait bien un jour s’établir sur des positions solides; ils affectaient seulement, pour montrer leur mécontentement, plus de raideur et de componction dans leur service.
Bien souvent Torrebianca, après avoir lu son courrier, regardait autour de lui avec étonnement. Sa femme donnait des fêtes et assistait aux plus célèbres réunions de Paris; ils occupaient, avenue Henri-Martin, le second étage d’un élégant hôtel; devant leur porte attendait une belle automobile; ils avaient cinq domestiques... Il n’arrivait pas à comprendre en vertu de quelles lois mystérieuses et par quels invraisemblables miracles d’équilibre ils pouvaient soutenir ce luxe tandis que chaque jour les dettes s’accumulaient et que leur coûteuse existence exigeait des sommes toujours croissantes. L’argent qu’il apportait disparaissait comme un ruisseau dans le sable. Mais la «belle Hélène» trouvait logique et correcte cette manière de vivre, et semblait croire que tous leurs amis agissaient comme eux.{3}
Torrebianca fut tout heureux de trouver parmi les lettres des créanciers et les cartes d’invitation une enveloppe portant le timbre italien.
—C’est de maman, dit-il à voix basse.
Il commença de lire, et un sourire parut éclairer son visage. La lettre pourtant était mélancolique et s’achevait sur des plaintes douces et résignées, de véritables plaintes de mère.
Il revoyait en lisant le vieux palais des Torrebianca, là-bas en Toscane: un édifice énorme et délabré, entouré de jardins. Les salles pavées de marbres multicolores avaient des plafonds ornés de fresques mythologiques, mais sur les murs nus, d’une pâleur poussiéreuse, se voyait seulement la trace des tableaux fameux qui les avaient ornés en d’autres temps, avant d’être vendus aux antiquaires de Florence.
Le père de Torrebianca, quand il ne lui resta plus de tableaux ni de statues à vendre, avait puisé dans les archives de sa maison; il avait mis en vente des autographes de Machiavel, de Michel Ange et d’autres florentins illustres qui avaient jadis échangé des lettres avec les grands personnages de sa famille.
Au dehors, des jardins trois fois séculaires s’étendaient au pied des vastes perrons de marbre dont les balustrades croulaient sous le poids des rosiers noueux. Les degrés avaient pris la teinte de l’os et s’étaient désunis sous la poussée des plantes parasites.
Dans les avenues, des buis ancestraux, taillés en forme d’épaisses murailles et d’arcs de triomphe profonds, évoquaient les ruines noircies par l’incendie d’une métropole détruite. Ces jardins, dont nul ne prenait soin depuis bien des années, revêtaient peu à peu l’aspect d’une forêt en fleurs. Sous le pas des rares visiteurs, ils résonnaient d’échos mélancoliques et on voyait alors s’élancer des{4} oiseaux comme des flèches, s’épandre sur les branches des essaims d’insectes et courir des reptiles parmi les troncs.
La mère du marquis, vêtue comme une paysanne et sans autre compagnie qu’une fillette du pays, passait sa vie parmi ces salles et ces jardins, en songeant au fils absent, pour qui elle cherchait à se procurer de l’argent par des expédients nouveaux.
Seuls lui rendaient visite les antiquaires qui lui achetaient, un à un, les derniers vestiges d’une splendeur que ses prédécesseurs avaient déjà largement mise à profit. Elle avait toujours quelques milliers de lire à envoyer au dernier Torrebianca qui, croyait-elle, occupait dans la société de Londres, de Paris, de toutes les grandes villes de la terre une place digne de son nom. Et, sûre que la fortune si favorable aux premiers Torrebianca finirait par sourire à son fils, elle se contentait d’une nourriture frugale, qu’elle mangeait sur une petite table de bois blanc dressée à même le pavé de marbre d’un salon où il ne restait plus rien à prendre.
Emu à la lecture de la lettre, le marquis murmura plusieurs fois le même mot «Maman... Maman.»
«Je ne sais plus que trouver après le dernier envoi que je t’ai fait. Si tu voyais maintenant, Frédéric, la maison où tu es né! Personne ne veut en donner le vingtième de sa valeur; en attendant qu’un étranger se décide à l’acheter, je suis prête à vendre le dallage et les plafonds qui seuls ont quelque prix pour te venir en aide et pour sauvegarder l’honneur de notre nom. J’ai besoin de peu de choses pour vivre et je m’imposerai s’il le faut de nouvelles privations; mais, ne pourriez-vous, Hélène et toi, restreindre vos dépenses, sans pour cela abandonner le rang auquel a droit celle que{5} tu as épousée? Ta femme, qui est si riche, ne peut-elle supporter une partie de ton train de maison?...»
Le marquis s’arrêta de lire. Les plaintes si simples de la pauvre femme et l’illusion où elle vivait lui faisaient mal; il en souffrait comme d’un remords. Elle croyait Hélène riche! Elle s’imaginait qu’il pouvait imposer à sa femme une vie d’ordre et d’économie comme il avait essayé tant de fois de le faire dans les débuts de leur vie conjugale!
L’entrée d’Hélène coupa court à ses réflexions. Il était plus de onze heures; elle allait faire sa promenade quotidienne, avenue du Bois, pour y saluer les gens de sa connaissance et être saluée à son tour.
Elle arriva, vêtue avec une élégance un peu indiscrète et prétentieuse qui s’harmonisait assez bien avec son genre de beauté. Elle était grande et parvenait à rester mince grâce à une lutte continuelle contre l’envahissement de la graisse, et à des jeûnes fréquents. Elle avait entre trente et quarante ans; mais elle devait aux mille soins préservateurs que comporte l’existence moderne cette troisième jeunesse qui, dans les grandes villes, prolonge la brillante saison de la femme.
Torrebianca ne voyait ses défauts que lorsqu’il vivait loin d’elle. Quand il la revoyait, le sentiment d’admiration qui s’emparait de lui, lui faisait accepter toutes ses exigences. Il reçut sa femme avec un sourire; Hélène sourit elle aussi. Puis elle lui passa les bras autour du cou et l’embrassa: elle parlait avec un zézaiement enfantin qui annonçait toujours à son mari quelque demande nouvelle; pourtant cet accent puéril avait chaque fois le pouvoir de le troubler profondément et d’annuler sa volonté.
—Bonjour, mon coco... Je me suis levée plus tard aujourd’hui; j’ai quelques visites à faire avant d’aller au Bois, mais je n’ai pas voulu partir sans{6} dire bonjour à mon petit mari adoré... Encore un baiser, et je pars.
Le marquis se laissa caresser et sourit avec l’expression reconnaissante d’un bon chien fidèle. Hélène enfin se sépara de son mari; mais avant de sortir de la bibliothèque elle fit mine de se rappeler une chose sans importance et s’arrêta pour dire:
—As-tu de l’argent?
Torrebianca cessa de sourire et son regard eut l’air de demander:
—Quelle somme désires-tu?
—Peu de chose. Huit mille francs à peu près.
Une modiste de la rue de la Paix lui montrait moins de respect pour cette dette qui ne datait guère que de trois ans et l’avait menacée d’une plainte en justice. Voyant son mari accueillir avec une expression consternée cette demande, elle perdit le sourire puéril qui écartait légèrement ses joues; mais elle gardait son accent de fillette pour gémir d’un ton doucereux:
—Frédéric, tu dis que tu m’aimes, et tu me refuses cette petite somme?
Le marquis indiqua du geste qu’il ne pouvait rien lui donner et lui montra les lettres de créanciers qui s’amoncelaient dans le plateau d’argent.
Elle eut un nouveau sourire, cruel cette fois.
—Je pourrais te montrer, dit-elle, bien des papiers pareils à ceux-là... mais tu es un homme, et les hommes doivent apporter beaucoup d’argent au foyer pour que leur petite femme ne soit pas malheureuse. Comment pourrai-je payer mes dettes si tu ne m’aides pas?
Torrebianca la regarda, stupéfait.
—Que d’argent, que d’argent je t’ai donné! mais tout ce qui passe par tes mains s’évanouit en fumée.
Hélène, irritée, répondit d’une voix dure:
—Voudrais-tu qu’une femme chic, et pas trop{7} laide, à ce qu’on dit, menât une vie médiocre? Quand on peut s’enorgueillir d’avoir une femme comme moi, il faut savoir gagner des millions.
Le marquis fut blessé par ces dernières paroles; Hélène s’en rendit compte, et changeant aussitôt d’attitude elle s’approcha et lui mit les mains sur les épaules.
—Pourquoi n’écris-tu pas à la vieille? Elle pourra peut-être nous procurer cet argent en vendant quelque antiquaille de la baraque de tes pères.
Ce ton irrespectueux accrut le mécontentement du mari.
—Cette vieille est ma mère, et tu dois parler d’elle avec tout le respect qu’elle mérite. Quant à l’argent, tu sais bien que la pauvre femme n’en peut plus envoyer.
Hélène regarda son époux avec quelque mépris et dit à voix basse comme en se parlant à elle-même:
—Cela m’apprendra à ne plus m’amouracher de pauvres diables... Je le chercherai, cet argent, puisque tu es incapable de me le donner.
Pendant qu’elle parlait ainsi il passa sur son visage une expression si mauvaise que son mari fronça le sourcil et quitta son fauteuil.
—Prends garde à ce que tu dis... Je veux que tu m’expliques ces paroles.
Mais il dut se taire; elle avait changé complètement son visage, elle éclata d’un rire d’enfant et frappa des mains.
—Voilà mon coco en colère! Il a pensé du mal de sa femme! Mais tu sais bien que je n’aime que toi!
Puis elle le prit dans ses bras et le couvrit de baisers, malgré la résistance qu’il essayait d’opposer à ces caresses. Il se rendit à la fin et reprit son attitude d’amoureux soumis.
Hélène le menaçait gentiment du doigt.{8}
—Allons, souriez un peu; ne soyez plus méchant! Vraiment, tu ne peux pas me donner cet argent?
Torrebianca eut un geste négatif, mais il semblait cette fois honteux de son impuissance.
—Va, je ne t’en aimerai pas moins, continua-t-elle. Mes créanciers attendront. Je me tirerai bien d’affaire comme je l’ai fait tant de fois. Adieu, Frédéric.
Elle recula vers la porte en lui envoyant des baisers tant qu’elle n’eut pas soulevé le rideau.
Mais, dès qu’elle eût passé la portière, sa joie puérile et son sourire disparurent instantanément. Un éclair de férocité traversa ses yeux; ses lèvres eurent une moue méprisante.
Le mari, resté seul, perdait en même temps l’éphémère bonheur que lui avaient donné les caresses d’Hélène. Il regarda les lettres des créanciers, celle de sa mère, puis revint à son fauteuil pour s’accouder sur la table, le front dans sa main. Brusquement toutes les inquiétudes de sa vie présente semblaient être retombées sur lui pour l’accabler.
Torrebianca se tournait toujours, en de pareils moments, vers les souvenirs de sa première jeunesse, dans l’espoir d’y trouver quelque remède à son chagrin. Il avait connu la plus belle époque de sa vie autour de sa vingtième année, alors qu’il étudiait à l’école d’ingénieurs de Liége. Afin de rendre à sa famille par son propre effort une splendeur depuis longtemps perdue il avait choisi une carrière moderne. Il se lancerait à travers le monde et gagnerait de l’argent comme ses lointains ancêtres. Les Torrebianca, avant que le roi leur eut donné la noblesse avec le titre de marquis, avaient été marchands à Florence, comme les Médicis, et avaient conquis leur fortune sur les routes de l’Orient. Lui voulut être ingénieur, avec tous les jeunes gens de sa géné{9}ration, qui souhaitaient de faire une Italie grande par l’industrie comme aux siècles passés elle avait été glorieuse par les arts.
Parmi les souvenirs de sa vie d’étudiant à Liége il retrouvait d’abord l’image de Manuel Robledo, un compagnon d’études qui partageait son logement; c’était un Espagnol de caractère jovial et capable d’affronter avec une calme énergie les problèmes de l’existence quotidienne. Il avait été pour lui pendant plusieurs années un frère aîné. C’est pour cela peut-être que dans les moments difficiles Torrebianca pensait toujours à cet ami.
L’intrépide, le bon Robledo!... Les passions de l’amour ne lui ôtaient jamais sa forte placidité d’homme bien équilibré. Durant sa jeunesse il avait aimé par-dessus tout la bonne table et la guitare.
Torrebianca, facilement épris, avait toujours une liaison avec quelque Liégeoise, et Robledo, pour lui tenir compagnie, consentait à feindre un violent amour pour une amie de la jeune personne. En réalité, pendant les parties de campagne qu’ils offraient aux dames, Robledo s’inquiétait beaucoup plus des préparatifs culinaires que de contenter le cœur plus ou moins tendre de sa compagne de hasard.
Au travers de cette exubérante gaieté matérialiste, Torrebianca avait su discerner un certain fond romantique dont Robledo se cachait comme d’un défaut honteux. Peut-être avait-il laissé dans son lointain pays le souvenir d’un amour malheureux. Souvent, le soir, le Florentin, étendu sur son lit dans la chambre commune, entendait Robledo qui doucement faisait gémir sa guitare et murmurait tout bas quelque chanson d’amour de sa patrie.
Leurs études terminées, ils s’étaient dit adieu avec l’espoir de se retrouver l’année suivante; mais ils ne s’étaient jamais revus. Torrebianca était resté en{10} Europe et Robledo depuis bien des années parcourait l’Amérique du Sud. Il était toujours ingénieur sans doute, mais il se pliait aux plus extraordinaires métamorphoses, comme s’il eût senti revivre dans son âme d’Espagnol l’inquiétude aventureuse des anciens conquistadors.
De loin en loin il envoyait une lettre, où il parlait du passé plus que du présent; mais, malgré cette réserve, Torrebianca avait vaguement l’idée que son ami était devenu général dans une petite république de l’Amérique centrale.
Sa dernière lettre datait de deux ans.
Il travaillait à cette époque en Argentine, lassé de courir l’aventure dans des pays continuellement secoués par les révolutions. Il était tout simplement ingénieur au service de l’Etat ou d’entreprises particulières et il construisait des chemins de fer et des canaux. Dans l’orgueil de diriger la marche de la colonisation à travers le désert, il supportait allégrement les privations que lui imposait sa dure existence.
Torrebianca conservait parmi ses papiers un portrait envoyé par Robledo; on y voyait l’Espagnol à cheval, couvert d’un poncho[2] et coiffé d’un casque blanc. A l’arrière plan, des métis étaient occupés à planter des jalons munis de banderoles dans une plaine d’aspect sauvage qui pour la première fois allait sentir les atteintes de la civilisation matérielle.
A l’époque où il avait reçu ce portrait, Robledo avait à peu près trente-sept ans; le même âge que lui. Il approchait maintenant de la quarantaine, mais à en juger d’après la photographie il avait meilleure mine que Torrebianca. Sa vie aventureuse dans de lointains pays ne l’avait pas vieilli.{11} Il semblait plus gros encore que dans sa jeunesse, mais son visage laissait voir le contentement serein que donne un parfait équilibre physique.
Torrebianca, de taille moyenne, plutôt petit que grand, mince et sec, avait conservé une espèce d’agilité nerveuse grâce à la pratique des sports, en particulier de l’escrime qu’il avait toujours aimée à la passion; mais son visage décelait une vieillesse prématurée. Les rides s’y montraient nombreuses, il avait un pli de fatigue au-dessus des paupières; ses tempes blanchies contrastaient avec le sommet de sa tête, resté noir. Les commissures de la bouche s’abaissaient, désabusées, sous la moustache taillée au ras des lèvres, en une moue qui semblait révéler l’affaiblissement de sa volonté.
Cette différence physique entre lui-même et Robledo le portait à considérer toujours son camarade comme un protecteur, qui saurait le guider aujourd’hui de même que dans sa jeunesse.
Lorsque, ce matin-là, l’image de l’Espagnol surgit dans sa mémoire il pensa, comme chaque fois: «S’il était seulement près de moi; il saurait m’infuser son énergie d’homme vraiment fort.»
Il demeura pensif, puis, quelques minutes après, l’entrée de son valet de chambre dans la pièce lui fit lever la tête.
Il s’efforça de dissimuler l’inquiétude qui le saisit lorsqu’il apprit qu’une personne demandait à le voir et refusait de donner son nom. Peut-être un créancier de sa femme essayait-il de ce moyen pour pénétrer jusqu’à lui.
—Il a l’air étranger, ajouta le domestique, et il affirme qu’il est de la famille de monsieur le marquis.
Torrebianca eut un pressentiment, mais il sourit immédiatement de sa naïveté. Cet inconnu, n’était-ce pas son camarade Robledo qui se présentait avec{12} l’invraisemblable opportunité d’un héros de comédie? Mais il était absurde de penser que Robledo, habitant l’autre côté de la planète, se trouvât là, prêt à surgir, comme un acteur dans la coulisse. Non, de pareilles coïncidences ne se présentent pas dans la vie. On ne voit cela qu’au théâtre ou dans les livres.
D’un geste énergique, il manifesta la ferme volonté de ne pas recevoir l’inconnu; mais au même instant la tenture se soulevait et un homme entrait avec un sans-gêne qui scandalisa le valet de chambre.
L’intrus, fatigué de faire antichambre, avait audacieusement pénétré dans la pièce la plus proche.
Le marquis était d’un caractère facilement irritable; outré de cette irruption, il s’avança d’un air menaçant. Mais l’homme qui riait de sa propre audace leva les bras au ciel en apercevant Torrebianca et s’écria:
—Je parie que tu ne me reconnais pas. Qui suis-je?
Le marquis le regarda fixement et ne put le reconnaître. Puis ses yeux exprimèrent graduellement l’hésitation et une conviction nouvelle. Il avait la peau brunie par les morsures du soleil et du froid, des moustaches courtes et sur toutes ses photographies Robledo portait la barbe... Mais tout à coup il retrouva dans les yeux de l’homme une expression qu’il se souvenait avoir souvent observée dans sa jeunesse. De plus, cette haute taille... ce sourire... ce corps robuste...
—Robledo! dit-il enfin.
Et les deux amis s’embrassèrent.
Le domestique, se sentant de trop, disparut et, un moment après, ils étaient assis et fumaient.
Ils échangeaient d’affectueux regards et s’arrê{13}taient parfois de parler pour se serrer les mains ou se frapper les genoux de claques vigoureuses.
Après tant d’années de séparation, le marquis se montra plus curieux que le nouveau venu.
—Tu es venu pour longtemps à Paris? demanda-t-il à Robledo.
—Pour quelques mois seulement.
Après avoir forcé pendant dix ans le mystère des déserts américains, rompu et pénétré leur virginité aussi vieille que la planète en y lançant des voies ferrées, des routes et des canaux, il avait besoin d’un «bain de civilisation».
—Je suis venu voir, ajouta-t-il, si les restaurants de Paris sont restés dignes de leur vieux renom et si les vins de ce pays ne sont pas moins bons qu’autrefois. Ici seulement on peut manger du brie frais, et depuis des années j’ai envie de ce fromage-là.
Le marquis se mit à rire. Faire une traversée de trois mille lieues pour manger et boire à Paris!... Robledo n’avait pas changé. Puis il lui demanda avec sollicitude:
—Es-tu riche?
—Toujours pauvre, répondit l’ingénieur. Mais je suis seul au monde, je n’ai pas de femme, le plus coûteux des luxes; aussi pourrai-je mener pendant quelques mois la vie d’un grand millionnaire yankee. Je dispose des économies que j’ai pu faire pendant des années de travail, là-bas, dans ce désert où l’on dépense peu.
Robledo regarda autour de lui et il eut des gestes admiratifs en considérant le luxueux mobilier de la pièce.
—Tu es riche, toi, à ce que je vois.
Un sourire énigmatique fut la réponse du marquis. Puis les paroles de son ami parurent éveiller sa tristesse.{14}
—Parle-moi de ta vie, continua Robledo. Tu as reçu de mes nouvelles, mais je n’ai pas eu grand’chose de toi. Beaucoup de tes lettres ont dû se perdre, et ce n’est pas étonnant, car jusqu’à ces dernières années, j’ai erré d’un endroit à l’autre, sans jamais prendre racine. Cependant j’ai eu quelques renseignements sur ta vie. Tu es marié, je crois?
Torrebianca fit un geste affirmatif et dit avec gravité:
—Je me suis marié avec une dame russe, veuve d’un haut fonctionnaire de la cour du tsar... je l’ai connue à Londres. Je l’avais rencontrée souvent dans des réunions aristocratiques ou dans des châteaux où nous avions été invités. Bref je l’ai épousée et nous avons vécu depuis lors une exigence assez brillante mais fort coûteuse.
Il se tut un moment, comme pour discerner l’effet que produisait sur Robledo ce résumé de sa vie. Mais l’Espagnol demeura silencieux; il voulait en savoir davantage.
—Toi, tu mènes une existence d’homme primitif et tu as la chance d’ignorer ce que coûte une vie comme la nôtre... J’ai dû travailler beaucoup pour ne pas couler à pic... et même en travaillant!... Ma pauvre mère me vient en aide avec les maigres ressources qu’elle peut tirer des ruines de notre maison.
Mais Torrebianca parut se repentir du ton douloureux de ses paroles. Un optimisme qu’il eût trouvé absurde une demi-heure auparavant lui rendait le sourire de la confiance.
—En réalité, je n’ai pas à me plaindre, car j’ai un puissant appui. Le banquier Fontenoy est notre ami. Tu as peut-être entendu parler de lui. Il traite des affaires dans les cinq parties du monde.{15}
Robledo secoua la tête. Non, il n’avait jamais entendu prononcer ce nom-là.
—C’est un vieil ami de la famille de ma femme. Grâce à Fontenoy je suis directeur de nombreuses exploitations en cours dans des pays lointains, et cela me rapporte un traitement respectable; avec tant d’argent, je me serais cru riche autrefois.
Robledo éprouvait une curiosité toute professionnelle. «Des exploitations en cours dans les pays lointains?»
L’ingénieur voulait savoir, et il pressa son ami de questions nettes. Mais Torrebianca commença de montrer dans ses réponses une inquiétude. Il balbutiait et son visage, ordinairement d’une pâleur verdâtre, rougissait légèrement.
—Ce sont des affaires en Asie et en Afrique: des mines d’or... des mines d’autres métaux... un chemin de fer en Chine... une compagnie de navigation destinée à transporter le produit des rizières du Tonkin... en réalité je n’ai pas étudié directement toutes ces entreprises; je n’ai jamais eu le temps de faire le voyage. D’ailleurs, je ne peux pas vivre loin de ma femme. Mais Fontenoy qui est un grand cerveau a tout visité et j’ai en lui une confiance absolue. Je ne fais en somme qu’apposer ma signature pour tranquilliser les actionnaires sur les rapports des personnes compétentes qu’il envoie là-bas.
L’Espagnol ne put s’empêcher de laisser paraître dans ses yeux un certain étonnement en entendant ces paroles.
Son ami s’en rendit compte et voulut changer le cours de la conversation. Il parla de sa femme avec une espèce d’orgueil. Il semblait considérer qu’il avait remporté le plus grand triomphe de son existence, le jour où elle avait consenti à accepter sa main.
Il reconnaissait qu’Hélène exerçait un grand pou{16}voir de séduction sur tout ce qui les entourait. Mais comme il n’avait jamais eu le moindre doute au sujet de sa fidélité conjugale, il était fier de marcher humblement derrière elle, presque perdu dans le sillage que traçait sa marche triomphale.
En réalité, si on lui procurait des occupations généreusement rétribuées, si on l’invitait, si on le recevait partout avec plaisir il le devait uniquement à son titre d’époux de «la belle Hélène».
—Tu la verras bientôt... car tu restes à déjeuner avec nous. Ne dis pas non. J’ai des vins excellents et puisque tu es venu des antipodes pour manger du fromage de Brie, tu en auras à en mourir d’indigestion.
Et aussitôt, il abandonna son accent léger pour dire d’une voix émue:
—Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux de te faire connaître ma femme. Je ne te parle pas de sa beauté, on l’appelle «la belle Hélène»; mais elle a mieux que sa beauté. J’aime plus encore son caractère gai, presque enfantin. Elle a parfois des caprices et il lui faut beaucoup d’argent pour vivre; mais quelle femme ne ferait de même!... Je crois qu’elle sera heureuse aussi de te connaître... Je lui ai si souvent parlé de mon ami Robledo.{17}
La marquise de Torrebianca trouva «très intéressant» l’ami de son mari.
Elle était rentrée chez elle de fort bonne humeur et semblait avoir oublié les soucis que lui causait tout à l’heure son manque d’argent; sans doute avait-elle trouvé le moyen de payer son créancier ou de le faire patienter.
Pendant le déjeuner, Robledo dut beaucoup parler pour répondre à ses questions et satisfaire la curiosité véhémente que semblaient lui inspirer tous les épisodes de sa vie.
Elle eut un geste de doute en apprenant que l’ingénieur n’était pas riche. Il était pour elle invraisemblable qu’un habitant de l’Amérique, du Nord ou du Sud, ne possédât pas des millions. Elle jugeait par réflexe comme la plupart des Européens, et elle aurait eu besoin de raisonner pour se convaincre que dans le nouveau monde, comme partout ailleurs, il pouvait se trouver des pauvres.
—Je suis encore pauvre, continua Robledo; mais{18} j’essaierai de mourir dans la peau d’un millionnaire, ne serait-ce que pour ne pas ôter leurs illusions à ceux qui croient encore que quiconque part pour l’Amérique doit y gagner une grosse fortune pour la laisser en héritage à ses neveux d’Europe.
Il en vint à parler des travaux qu’il avait entrepris en Patagonie.
Las de travailler pour les autres, il s’était associé avec un jeune Américain du Nord et avait commencé la colonisation de quelques milliers d’hectares près du Rio Negro. Il avait engagé dans cette affaire ses économies, celles de son compagnon et d’importantes sommes prêtées par des banquiers de Buenos-Ayres; mais il considérait l’opération comme sûre et très rémunératrice.
Il s’agissait d’irriguer par un système de canaux des terres désertes et incultes qu’il avait acquises à vil prix. Depuis quelques années le gouvernement argentin avait commencé de grands travaux pour capter une partie des eaux du Rio Negro. Comme ingénieur, il avait pris part à cette difficile opération; ensuite, il avait donné sa démission pour s’établir colon, et acheter des terres comprises dans la future zone d’irrigation.
—C’est l’affaire de quelques années, de quelques mois peut-être, ajouta-t-il. Il suffit que le fleuve veuille bien être assez aimable pour se laisser jeter une digue en travers du ventre et n’aille pas se permettre une crue extraordinaire, une de ces convulsions si fréquentes là-bas, qui détruisent en quelques heures le travail de plusieurs années. En attendant, nous construisons le plus économiquement possible, mon associé et moi, les canaux secondaires et toutes les artères qui doivent féconder nos terrains stériles. Le jour où la digue sera terminée, où l’eau pénétrera jusqu’à nos terres...{19}
Robledo s’arrêta et sourit avec modestie.
—Ce jour-là, continua-t-il, je serai millionnaire à l’américaine; qui peut prévoir le chiffre de ma fortune? Une lieue de terre irriguée vaut des millions... et je suis propriétaire de plusieurs lieues.
La belle Hélène l’écoutait avec un ardent intérêt. Robledo fut troublé par la lueur d’admiration qui passait à ce moment dans ses pupilles vertes aux reflets d’or, et il se hâta d’ajouter:
—Mais cette fortune peut aussi se faire longtemps attendre! Peut-être ne viendra-t-elle à moi que lorsque ma mort sera proche; et ce sont les enfants d’une sœur que j’ai en Espagne qui recueilleront le fruit de mon travail et de ma dure vie.
Hélène lui fit décrire son existence dans le désert Patagon, immense plaine balayée l’hiver par des ouragans glacés qui soulèvent des colonnes de poussière, où les seuls habitants naturels sont les autruches en troupeau et le puma vagabond que la faim pousse parfois à attaquer l’homme isolé.
A l’origine, la population humaine était constituée par des bandes d’indiens qui bivouaquaient au bord des fleuves, ou par des fugitifs chiliens et argentins qui s’étaient lancés à travers les terres sauvages pour échapper au châtiment de leurs crimes. Maintenant les anciens fortins, occupés par les détachements que le gouvernement de Buenos-Ayres avait poussés en avant, à la conquête du désert, se transformaient en villages que des centaines de kilomètres séparaient les uns des autres.
Robledo vivait entre deux de ces agglomérations éloignées; son campement d’ouvriers devenait un village qui peut-être avant un demi-siècle aurait formé une ville déjà importante. Les prodiges de ce genre n’étaient pas rares en Amérique. Hélène l’écoutait avec ravissement, comme lorsqu’au théâ{20}tre ou au cinématographe une intrigue intéressante éveillait sa curiosité.
—C’est vivre cela! disait-elle. Voilà ce que j’appelle une existence digne d’un homme.
Et ses yeux dorés cessaient de regarder Robledo pour se porter avec commisération sur son époux, comme si elle voyait en lui l’image de toutes les mollesses de cette vie douillette et civilisée à l’excès qu’elle détestait pour un moment.
—C’est ainsi d’ailleurs qu’on gagne une grande fortune. Pour moi, il n’y a pas d’autres hommes que les gagneurs de batailles ou les rois de l’argent qui conquièrent des millions... Je ne suis qu’une femme, mais je voudrais vivre cette existence d’énergie et de périls.
Un peu d’aigreur se mêlait à son enthousiasme; aussi, Robledo, pour épargner à son ami des récriminations, se mit à parler des souffrances qu’on endure loin des pays civilisés. La marquise parut alors éprouver moins d’admiration pour la vie d’aventures et finit par avouer qu’elle aimait mieux son existence à Paris.
—Mais il m’aurait plu, ajouta-t-elle d’une voix mélancolique, que mon époux vécût ainsi pour conquérir d’immenses richesses. Il viendrait me voir tous les ans, je penserais à lui sans cesse, j’irais même parfois partager pendant quelques mois sa vie sauvage; oui, cette existence serait plus intéressante que celle que nous menons à Paris; et puis, pour finir, ce serait la richesse, une vraie richesse, énorme, fabuleuse, comme on en rencontre rarement dans l’ancien monde.
Elle se tut un instant, puis ajouta avec gravité en regardant Robledo:
—Vous paraissez attacher peu d’importance à la richesse; vous la cherchez pour satisfaire votre désir d’action, pour dépenser votre énergie. Mais vous ne{21} savez pas ce qu’elle vaut ni ce qu’elle représente. Un homme de votre trempe a peu de besoins. Pour savoir ce qu’est l’argent et ce qu’il peut nous donner il faut vivre aux côtés d’une femme.
Elle eut un nouveau regard vers Torrebianca et conclut:
—Par malheur, ceux qui ont une femme auprès d’eux n’ont presque jamais cette force qui permet aux hommes isolés de réaliser de grandes entreprises.
Après ce déjeuner où il ne fut question que de la puissance de l’argent et d’aventures dans le nouveau monde, le colonisateur se mit à fréquenter la maison comme s’il eût fait partie de la famille.
—Hélène t’a trouvé très sympathique, disait Torrebianca, oui, tout à fait sympathique.
Il en était heureux comme d’un triomphe, et ne cachait pas qu’il eût été navré d’avoir à choisir, en cas d’antipathie mutuelle, entre sa femme et son compagnon de jeunesse.
De son côté, Robledo, en pensant à Hélène, demeurait indécis et comme désorienté. Quand il était devant elle, il ne pouvait résister au pouvoir de séduction qui semblait émaner de sa personne. Elle le traitait avec une familiarité de parente, comme elle eût fait pour un frère de son mari. Elle voulait l’initier à la vie de Paris et le guider de ses conseils pour qu’on ne pût abuser de sa crédulité de nouveau venu. Elle l’accompagnait dans les endroits les plus élégants, à l’heure du thé ou le soir, après le dîner.
L’expression maligne et puérile à la fois de ses yeux imperturbables et le zézaiement enfantin qu’elle affectait parfois agissaient fortement sur l’esprit du colonisateur.
—C’est une enfant, se dit-il bien des fois, son{22} mari ne se trompe pas. Elle a tous les raffinements de ces poupées que forme la vie moderne et elle doit coûter terriblement cher... mais sous ce vernis extérieur, elle ne cache peut-être qu’une mentalité très ordinaire.
Quand il échappait à l’influence de ses yeux il était moins optimiste et souriait avec un étonnement ironique de la crédulité de son ami. Quelle était donc cette femme? Où Torrebianca avait-il été la chercher?
Tout ce qu’il savait de son histoire, il le tenait du mari. Elle était veuve d’un haut fonctionnaire de la cour des tsars, mais la figure de ce premier époux était aussi imprécise que brillante; tantôt, il avait été grand maréchal de la cour, tantôt simple général et c’était alors le père d’Hélène qui pouvait se vanter d’une longue lignée d’ancêtres héroïques.
Quand Torrebianca répétait les affirmations de cette femme qu’il aimait tant et dont il était si fier, il citait une infinité de personnages de la cour de Russie ou de grandes dames que les empereurs avaient aimées; tous se rattachaient à la famille d’Hélène, mais lui-même ne les avait jamais vus; ils étaient morts depuis longtemps ou bien ils vivaient dans leurs terres lointaines, vastes comme des Etats.
Parfois aussi les paroles d’Hélène inquiétaient Robledo. Elle n’avait jamais été en Amérique et cependant, un soir, au thé du Ritz, elle lui avait parlé de son passage à San Francisco alors qu’elle était encore une fillette. D’autres fois elle lançait étourdiment dans la conversation des noms de villes lointaines ou de personnages universellement réputés qu’elle semblait avoir connus de près. Il ne put jamais savoir avec certitude combien de langues elle connaissait.
—Je les parle toutes, lui répondit-elle en espa{23}gnol, un jour qu’il venait de lui poser la question.
Elle contait des anecdotes un peu risquées qu’elle avait, disait-elle, entendu rapporter par d’autres personnes; mais elle les contait de telle façon que le colonisateur se demanda plus d’une fois si elle n’en était pas la véritable protagoniste.
—Où cette femme n’a-t-elle pas été? pensait-il. Elle semble avoir vécu mille existences en quelques années. Il est impossible que tout cela lui soit arrivé du vivant de son mari, le grand personnage russe.
Si parfois il essayait de sonder son ami pour obtenir quelques précisions, la confiance du marquis à l’égard du passé de sa femme opposait à ses recherches comme une muraille d’inébranlable crédulité. Cependant il acquit la certitude que son ami ne connaissait l’histoire d’Hélène que depuis le jour où il l’avait rencontrée à Londres. De son existence antérieure, il savait seulement ce qu’elle-même avait bien voulu lui raconter.
Du moins pensa-t-il que Frédéric, au moment de son mariage, avait pu contrôler les dires de sa femme par les documents déposés en vue de la cérémonie nuptiale. Mais il dut abandonner cette supposition. La cérémonie de Londres avait été un de ces rapides mariages de cinéma qui demandent seulement un prêtre qui lit les textes sacrés, deux témoins et quelques papiers examinés à la légère.
L’Espagnol finit par avoir honte de ses soupçons. Frédéric était heureux, il avait l’orgueil de sa femme; il n’avait pas le droit, lui, d’intervenir dans la vie privée d’un autre.
D’ailleurs, s’il concevait des doutes, c’était peut-être défaut d’adaptation au milieu, chose fort naturelle chez un sauvage brusquement lancé en pleine vie parisienne. Hélène était une dame du grand monde, une femme élégante comme il n’en avait jamais fréquenté. Le mariage de son ami avait pu{24} seul lui procurer cette amitié toute nouvelle, qui n’allait pas sans heurt avec ses habitudes antérieures. N’avait-il pas fini plus d’une fois par trouver logiques des choses qui au premier abord l’avaient profondément étonné? Soupçons et mauvaises pensées, il les devait à son ignorance, à son manque d’éducation. D’ailleurs, quand il voyait le sourire d’Hélène, quand il sentait la caresse de ses yeux verts aux reflets d’or il était, tout comme Torrebianca, pris de confiance et d’admiration.
Il logeait près du boulevard des Italiens, dans un vieil hôtel, qu’autrefois, pauvre étudiant de passage à Paris, il avait considéré comme un lieu de délices paradisiaques. Mais il prenait la plupart de ses repas avec le marquis et sa femme. Tantôt ceux-ci l’invitaient à leur table, tantôt il les emmenait lui-même dans les restaurants les plus réputés.
Hélène le pria en outre d’assister chez elle à quelques thés et le présenta à ses amies. Elle prenait un plaisir enfantin à contrarier les goûts de «l’ours patagon»; c’est ainsi qu’elle avait surnommé Robledo encore que ce dernier eût protesté qu’il n’avait jamais vu d’ours dans le sud de l’Argentine.
Il détestait ces réunions; mais Hélène trouvait mille ruses pour l’obliger à y assister.
Il fit la connaissance des principaux amis de la maison au cours des dîners d’apparat que donnaient les Torrebianca. La marquise présentait l’Espagnol, non comme un ingénieur encore aux prises avec les risques et les difficultés de travaux à peine commencés, mais comme un triomphateur revenu avec force millions d’une Amérique fabuleuse.
Elle disait cela sans qu’il pût l’entendre, et lui ne comprenait pas pourquoi les autres invités lui témoignaient tant de respect et prêtaient une attention sympathique à ses moindres paroles. Il connut ainsi des députés et des journalistes, amis du ban{25}quier Fontenoy, qui tenaient la première place parmi les invités. Il connut aussi le banquier lui-même; c’était un homme entre deux âges, complètement rasé, aux cheveux blanchis, qui imitait l’extérieur et les gestes des hommes d’affaires américains.
Robledo en le contemplant se revoyait lui-même lorsque, dans ses années de Buenos-Ayres, il se trouvait à court d’argent la veille d’une échéance.
Fontenoy représentait l’homme d’argent, le directeur de grandes entreprises mondiales tel que le vulgaire le conçoit; toute sa personne semblait respirer l’assurance, la conviction de sa propre force; mais, parfois, il fronçait pensivement le sourcil et il semblait alors étranger à tout ce qui l’entourait.
—Il imagine quelque merveilleuse combinaison nouvelle, disait Torrebianca à son ami. L’intelligence de cet homme est admirable.
Mais Robledo, sans savoir pourquoi, se rappelait encore ses propres anxiétés, celles aussi de beaucoup d’autres lorsqu’il fallait là-bas à Buenos-Ayres rendre le soir même une somme à terme de quatre-vingt-dix jours, avancée par les banques.
Un soir, en sortant de chez les Torrebianca, Robledo voulut s’en aller à pied en suivant l’avenue Henri-Martin jusqu’au Trocadéro où il comptait prendre le «Métro».
Il était parti avec un des convives, personnage équivoque qu’on avait fait asseoir au bout de la table et qui paraissait enchanté de marcher à côté d’un millionnaire américain.
C’était un protégé de Fontenoy; il publiait un journal financier inspiré par le banquier. Sa méchanceté demandait à s’exercer et il critiquait tous ses protecteurs dès qu’il était loin d’eux. A peine eut-il fait quelques pas qu’il sentit le besoin de payer son dîner en disant du mal de ses hôtes.{26} Il n’ignorait pas que Robledo avait fait ses études avec le marquis.
—Et sa femme? La connaissez-vous aussi depuis longtemps?
Le vilain personnage eut un sourire en apprenant que Robledo la connaissait depuis quelques semaines à peine.
—Russe? Vous la croyez vraiment russe? C’est elle qui raconte toutes les histoires sur son premier mari le grand maréchal de la cour et sur toute sa noble parenté. Beaucoup de gens n’ont jamais cru à l’existence de ce mari-là. Je ne saurais dire si tout cela est vrai ou faux, mais je puis affirmer que dans la maison de cette grande dame russe il n’est jamais entré un seul Russe de marque.
Il s’arrêta comme pour prendre des forces et ajouta avec violence:
—Des gens de là-bas, certainement bien informés, m’ont dit qu’elle n’était pas russe. Personne n’y croit plus. Certains la croient roumaine et affirment l’avoir vue, jeune, à Bucarest; d’autres assurent qu’elle est née en Italie de parents polonais. Allez-vous en savoir! S’il nous fallait rechercher l’origine et l’histoire de tous les gens que nous connaissons à Paris et qui nous invitent à dîner!
Il regarda obliquement Robledo pour tâcher de voir s’il se montrait curieux et si l’on pouvait se fier à sa discrétion.
—Le marquis est un excellent homme. Vous devez le connaître très bien. Fontenoy rend justice à ses mérites et lui a procuré un emploi important pour...
Robledo eut le pressentiment qu’il allait entendre quelque chose qu’il ne pourrait accepter sans protestation; un taxi passait à vide, il se hâta d’appeler le chauffeur. Puis, prétextant une occupation urgente, il prit congé du venimeux parasite.{27}
Chaque fois qu’il causait seul à seul avec Torrebianca, le marquis faisait dévier la conversation vers la question qui lui tenait surtout à cœur: la quantité d’argent que l’on doit dépenser pour maintenir un rang social élevé.
—Tu ne peux pas savoir ce que coûte une femme; les robes, les bijoux... Puis l’hiver sur la côte d’azur, l’été sur les plages célèbres, l’automne dans les villes d’eaux à la mode.
Robledo écoutait ces lamentations avec une commisération ironique qui finissait par irriter son ami.
—Comme toi tu ne sais pas ce que c’est que l’amour, tu peux faire abstraction de la femme et te permettre cette tranquillité moqueuse.
L’Espagnol pâlit et cessa brusquement de sourire. «Il n’avait pas connu l’amour»? Dans sa mémoire surgissaient les souvenirs d’une jeunesse que Torrebianca n’avait fait qu’entrevoir confusément. Peut-être une fiancée l’avait-elle abandonné, là-bas dans son pays, pour en épouser un autre. Mais l’Italien se souvint bientôt. La fiancée était morte et Robledo avait juré, comme dans les romans, de ne pas se marier... Ce gros homme gourmand et moqueur cachait en lui-même un drame d’amour.
Mais Robledo avait horreur qu’on le prît pour un personnage romantique; il se hâta de dire, avec scepticisme:
—Je recherche la femme quand elle me devient nécessaire, puis je continue ma route seul. Pourquoi compliquer mon existence en subissant une compagnie dont je n’ai que faire?
Un soir, tous trois sortaient du théâtre; Hélène exprima le désir de connaître certain restaurant de Montmartre tout récemment inauguré.
D’après ses amies c’était un lieu magique; il était décoré à la persane, style des Mille et une nuits vues de Montmartre; son éclairage par tubes de mer{28}cure donnait aux salons un ton verdâtre de paysage sous-marin et aux assistants la pâleur livide des noyés.
Deux orchestres qui se remplaçaient sans cesse avaient pour tâche de répandre dans l’air de folles élucubrations rythmiques. Les violons collaboraient avec des cuivres discordants; au milieu de ce charivari sautillant éclatait la voix d’un claxon d’automobile ou de quelque appareil musical nouveau destiné à imiter le bruit de deux planches qui se heurtent, d’un paquet qu’on traîne sur le sol, d’une pierre de taille qui tombe.
Dans l’ovale ménagé au milieu des tables des couples de danseurs se succédaient. Les vêtements et les chapeaux des femmes, comme des flocons multicolores saupoudrés d’argent et d’or, les masses blanches et noires des costumes masculins évoluaient entre les carrés clairs des nappes. Un fracas de fête publique s’unissait à la stridence des orchestres.
Ceux qui ne dansaient pas lançaient des serpentins et des boules de coton, ou bien ils faisaient crier avec une joie puérile de petites cornemuses ou d’autres instruments enfantins. Dans l’air chargé de fumée flottaient des ballons en baudruche de couleurs diverses, que les assistants y avaient lâchés. La plupart des convives s’étaient coiffés de bonnets de bébés, de crêtes d’oiseaux ou de perruques de paillasses.
Dans cette atmosphère de joie stupide et forcée on sentait comme un désir de retourner aux balbutiements de l’enfance pour restituer un attrait aux monotones péchés de l’âge mur. L’aspect du restaurant parut enthousiasmer Hélène.
—Oh! Paris! Il n’y a qu’un Paris au monde! Qu’en pensez-vous, Robledo?
Robledo, qui était un sauvage, sourit avec une indifférence vraiment impertinente. Ils mangèrent{29} sans appétit et burent le contenu d’une bouteille de champagne qui baignait dans un seau d’argent. On retrouvait cette bouteille sur toutes les tables; elle semblait être l’idole de cet endroit, la reine de la fête.
Quand un flacon était presque vide, un autre prenait sa place et paraissait surgir du fond du seau.
La marquise regardait de côté et d’autre avec une certaine impatience; soudain elle sourit et fit des signes à un monsieur qui venait d’entrer.
C’était Fontenoy qui, feignant d’être étonné de cette rencontre, vint s’asseoir à leur table.
Robledo se souvint qu’Hélène au théâtre avait parlé à plusieurs reprises du banquier et cela lui fit supposer qu’ils s’étaient vus le soir même. Il soupçonna même que cette rencontre à Montmartre était convenue entre elle et lui. Cependant, Fontenoy, évitant le regard d’Hélène, disait à Torrebianca:
—Quel heureux hasard! Je viens de dîner avec des hommes d’affaires; j’avais besoin de me distraire; je viens ici comme j’aurais pu aller ailleurs et vous y voici.
Robledo crut un moment que les yeux pouvaient sourire tant il lut de joyeuse malice dans ceux d’Hélène.
Quand la bouteille de Champagne eut ressuscité pour la troisième fois dans le seau d’argent, la marquise, qui regardait avec un air d’envie les danseurs tournoyant au milieu de la salle, dit de sa voix de fillette boudeuse:
—Je voudrais bien danser, et personne ne m’invite.
Son mari se leva, comme s’il venait de recevoir un ordre, et tous deux s’éloignèrent, évoluant parmi les autres couples.{30}
Quand elle revint à sa chaise, elle protesta avec une indignation comique:
—Venir à Montmartre pour danser avec son mari!
Ses yeux caressants se posèrent sur Fontenoy.
—Je ne vous demande pas à vous de m’inviter, dit-elle; vous ne savez pas danser et vous dédaignez ces frivolités... Peut-être même craignez-vous que vos actionnaires vous retirent leur confiance en vous voyant en de pareils endroits.
Puis elle se tourna vers Robledo.
—Et vous, dansez-vous?
L’ingénieur prit un air scandalisé. Où aurait-il pu apprendre les danses inventées pendant ces dernières années? Il connaissait seulement la cueca chilienne que ses ouvriers dansaient les jours de paie, le pericon et le gato que les vieux gauchos[3] mimaient en s’accompagnant du cliquetis de leurs éperons.
—Il va donc falloir que je reste assise à m’ennuyer... et j’ai trois hommes avec moi. Voilà bien ma chance!
Mais quelqu’un intervint qui semblait avoir entendu ses plaintes. Torrebianca eut un geste de contrariété. C’était un jeune danseur qu’il avait souvent aperçu dans les restaurants de nuit. Il éprouvait pour lui une franche antipathie, par le seul fait que sa femme et ses amies en parlaient avec une certaine admiration.
Il jouissait du reste des honneurs de la célébrité. Quelqu’un, pour exalter ironiquement sa gloire, l’avait surnommé «l’aigle du tango». Robledo devina qu’il était sud-américain, à l’aisance gracieuse de ses mouvements et à l’élégance trop recherchée de ses vêtements. Les femmes admiraient{31} ses petits pieds montés sur de hauts talons et l’éclat de son épaisse chevelure rejetée en arrière, aussi lisse qu’un bloc de laque.
La femme de Torrebianca accepta l’invitation de cet «aigle de la danse» qui, à en croire les envieux, se faisait entretenir par ses partenaires, et tous deux se mirent à danser. Plusieurs fois Hélène dut revenir à la table pour s’asseoir et se reposer; mais presque aussitôt elle appelait des yeux le jeune homme, qui savait accourir fort à propos.
Torrebianca ne cachait pas sa contrariété en la voyant rejoindre cet éphèbe antipathique. Fontenoy demeurait impassible ou souriait distraitement pendant les brefs instants où Hélène se reposait.
Robledo regarda plus attentivement Fontenoy et se rendit compte que le banquier ne pensait pas à des choses éloignées. En voyant qu’Hélène s’obstinait à danser avec le même adolescent, il avait fini, comme Torrebianca, par laisser voir quelque ennui sur son visage.
Chaque fois qu’elle passait dans les bras de son danseur, Hélène adressait à Fontenoy un sourire malicieux comme si elle eut pris plaisir à son air maussade.
L’Espagnol regarda d’un côté de la table, puis de l’autre, et il pensa:
—Ne dirait-on pas que je suis entre deux maris jaloux?{32}
Robledo fit, à l’un des thés de la marquise de Torrebianca, la connaissance de la comtesse Titonius, une dame russe épouse d’un noble scandinave qui paraissait à ce point éclipsé par sa femme que nul ne lui prêtait la moindre attention.
C’était une femme de quarante à cinquante ans, qui gardait encore de vagues vestiges d’une beauté depuis longtemps enfuie. Une petite tête de poupée sentimentale couronnait son obésité débordante, flasque et blanchâtre; comme elle aimait écrire des vers d’amour, qu’elle s’empressait de réciter au cours de la conversation, ses ennemis l’avaient surnommée «Cent kilos de poésie».
Elle se présentait en plein après-midi avec un décolleté audacieux qui étalait orgueilleusement ses énormes appas gélatineux et pâles. Elle portait des bijoux énormes et barbares, en harmonie avec une perruque blonde où de nouvelles boucles s’ajoutaient chaque mois.
Parmi tant de bijoux scandaleusement faux, le{33} seul digne d’attention était un collier de perles, qui, lorsque la dame s’asseyait, venait reposer sur son ventre en ballon. Ces perles, irrégulières, anguleuses et munies de racines, ressemblaient aux dents d’animaux dont certaines peuplades sauvages fabriquent des ornements. Les médisants assuraient que c’étaient des souvenirs des amants de sa jeunesse, à qui la comtesse ne pouvant plus rien tirer d’eux, avait arraché les dents. Son sentimentalisme ardent et la liberté de ses propos lorsqu’elle parlait de l’amour venaient à l’appui de ces bruits.
Elle regardait Robledo, que son amie Hélène lui avait présenté comme un millionnaire américain, avec un intérêt passionné. Ils causèrent, une tasse de thé à la main, ou plutôt elle parla tandis que Robledo cherchait dans son esprit un prétexte pour s’enfuir.
—Vous qui avez tant voyagé, vous qui êtes un héros, éclairez-moi de votre expérience... que pensez-vous de l’amour?
Mais la poétesse vit alors que malgré ses œillades tendres de myope, Robledo reculait en murmurant des excuses, effarouché sans doute par une conversation engagée sur une telle demande.
Quelques semaines après, Hélène le pria d’assister à une fête que donnait la comtesse.
—Ce sont des réunions très agréables. La maîtresse de maison invite toute une bohème inquiétante qui doit applaudir ses vers, en même temps que des gens distingués qu’elle a connus dans les salons. Quelques étrangers s’y rendent, croyant de bonne foi rencontrer des auteurs célèbres; ils n’y trouvent que des ratés vieillis et venimeux. Elle est aussi la protectrice d’un certain nombre de petits jeunes gens; ils font une entrée solennelle, convaincus de leur propre gloire, que seuls proclament leurs propres camarades et que célèbrent seules quelques{34} petites revues sans lecteurs... Il faut aller voir ça. Vous ne trouverez pas mieux en ce genre à Paris. D’ailleurs j’ai promis à la pauvre comtesse que vous assisteriez à sa fête, et je me fâcherai si vous ne m’obéissez pas.
Pour ne pas lui déplaire, Robledo, après avoir dîné avec des compatriotes dans un restaurant du boulevard, se rendit à dix heures du soir au domicile de la comtesse, avenue Kléber.
Deux serviteurs, engagés pour la durée de la fête, recevaient les manteaux des invités. A peine entré dans l’antichambre, l’ingénieur put se rendre compte du singulier mélange social que lui avait décrit Hélène. Il entrait des couples d’allures distinguées, accoutumés à la vie des salons, fort élégamment vêtus, puis, en même temps, des jeunes gens à la chevelure opulente qui portaient l’habit comme les autres invités, mais sous des paletots râpés aux doublures déchirées. Il vit les domestiques sourire ironiquement en suspendant certains pardessus et certains manteaux de fourrure aux larges plaques de pelade, que des dames étrangement coiffées venaient de déposer.
Un vieillard, en tous points conforme au type populaire du poète—longues mèches d’un blanc sale, feutre à larges bords—se dépouilla d’un mince paletot d’été, puis de deux cache-nez qu’il avait enroulés autour de son corps pour remplacer le manteau absent. Il retira sa pipe de sa bouche, la frappa contre une de ses semelles, puis la glissa dans la poche de son paletot en recommandant aux valets d’en prendre soin, comme d’un objet de grande valeur.
La pelisse que portait Robledo lui valut le respect des deux serviteurs. L’un d’eux l’aida à la quitter et la garda sur son bras.
—Vous pouvez l’admirer, je vous y autorise, dit{35} l’ingénieur; je viens de l’acheter. C’est un bel article, hein!
Mais le domestique lui répondit, sans faire cas de son accent moqueur.
—Je la mettrai à part. J’aurais trop peur que quelqu’un ne se trompe à la sortie et ne l’emporte en laissant son manteau à monsieur.
Et, clignant de l’œil, il montrait les lamentables vêtements qui s’accumulaient dans l’antichambre. La noble poétesse fit éclater en l’apercevant dans ses salons un enthousiasme bruyant. Elle écarta les autres invités, vint à sa rencontre et lui serra les deux mains à la fois. Puis, appuyée sur son bras elle fit le tour des groupes pour le présenter. Elle le couvait des yeux comme si son entrée eut été l’événement principal de la fête; elle paraissait être fière de le montrer à ses amies. Hélène avait eu raison la veille de le prévenir ironiquement: «Prenez garde, Robledo, la comtesse est folle de vous et je la crois capable de vous enlever.»
L’enthousiasme de la comtesse s’exprimait par une avalanche de paroles à chaque nouvelle présentation.
—C’est un héros, un surhomme du désert, qui là-bas, dans les pampas de l’Argentine, a tué des lions, des tigres et des éléphants.
Robledo s’épouvantait d’entendre de pareilles hérésies, mais la comtesse était exempte de scrupules géographiques.
—Quand vous m’aurez conté tous vos exploits continua-t-elle, j’écrirai un poème épique dans une note moderne, où je rapporterai les aventures de votre vie. Les hommes ne m’intéressent que lorsqu’ils sont des héros.
Et Robledo de nouveau fut pris de terreur. La comtesse ne trouvant plus à sa portée d’invités à qui présenter son héros, le conduisit dans un cabinet{36} resté vide sans doute à cause des odeurs qui y parvenaient, à travers un rideau, de la cuisine toute proche. Elle occupa un fauteuil vaste comme un trône et pria Robledo de s’asseoir. Il chercha une chaise mais elle lui montra un tabouret à ses pieds.
—Notre intimité sera plus grande ainsi. Vous serez comme un page d’autrefois prosterné devant sa dame.
Robledo ne pouvait cacher la stupéfaction que lui causaient ces paroles, mais il finit par se placer comme elle voulait, bien que sa corpulence lui rendît ce siège fort désagréable.
La Titonius copiait les gestes puérils et le zézaiement de son amie; mais ces imitations de l’enfance n’étaient plus chez elle que grotesques.
—Maintenant que nous sommes seuls—dit-elle—j’espère que vous parlerez en toute liberté; je vous répète ma question de l’autre jour:
—Que pensez-vous de l’amour?
Robledo, surpris, finit par balbutier:
—Oh, l’amour!... c’est une maladie... oui, c’est bien cela, une maladie, que les gens subissent depuis des milliers d’années sans trop savoir en quoi elle consiste.
La comtesse, à cause de sa myopie, s’était rapprochée beaucoup de lui; elle dédaignait de faire usage du face à main d’écaille qu’elle tenait entre ses doigts.
Se penchant au-dessus de l’hémisphère comprimé de son ventre elle toucha presque le visage de l’homme assis à ses pieds.
—Mais pensez-vous qu’une âme supérieure, incomprise, comme la mienne, pourra trouver un jour le complément d’une âme sœur?
Robledo qui avait repris tout son sang-froid lui dit gravement:{37}
—J’en suis sûr... Vous êtes jeune encore, vous avez tout le temps de l’attendre.
Elle fut si ravie de cette réponse qu’elle caressa le visage de son interlocuteur avec son face à main.
—Oh! la galanterie espagnole!... Mais, quittons-nous; ne livrons pas notre secret à ce monde qui ne peut nous comprendre. Je lis dans vos yeux le désir ardent... de grâce contenez-vous! Je ferai en sorte que nos âmes puissent se joindre avec plus d’intimité. En ce moment, c’est impossible... mes devoirs sociaux... mes obligations de maîtresse de maison...
Elle se détacha avec peine de son fauteuil-trône et s’éloigna en imitant la démarche légère d’une petite fille, non sans avoir envoyé, du bout de son face à main, un baiser muet à Robledo.
Cette passion agressive déconcerta et ennuya fort l’ingénieur qui, se jugeant dans une situation ridicule, sortit de son côté du cabinet solitaire.
En rentrant dans le salon, encore tout abasourdi, il faillit renverser un monsieur de petite taille qui lui répondit par une révérence et un murmure d’excuses. Il le vit ensuite errer de côté et d’autre, humble et timide, surveiller les domestiques avec des yeux suppliants, s’occuper de remettre en place les meubles bousculés par les invités. Si quelqu’un lui adressait la parole, il se hâtait de répondre avec de grandes démonstrations de respect, puis disparaissait immédiatement.
La Titonius avait autour d’elle un cercle d’hommes où dominaient les jeunes gens d’allure «artiste» que Robledo avait remarqués dans l’antichambre.
Beaucoup de dames se moquaient ouvertement de la comtesse et lui lançaient des regards chargés d’ironie. Le vieux qui avait laissé au vestiaire sa pipe et ses cache-nez frappa dans ses mains, lança quelques{38} «chut!» pour obtenir le silence et dit avec solennité:
—L’assistance demande que notre belle muse récite quelques-uns de ses vers incomparables.
Des applaudissements éclatèrent, et des cris d’enthousiasme appuyèrent cette exigence. Mais la muse n’était pas disposée; elle commença de s’agiter sur sa chaise avec des gestes de refus. En même temps elle dit d’une voix plaintive, comme prise d’une faiblesse subite:
—Je ne puis, mes amis... ce soir, c’est impossible... un autre jour, peut-être...
Le groupe de ses admirateurs revint à la charge, et la comtesse renouvela son refus avec un découragement douloureux d’agonisante.
Les invités n’insistèrent plus et retournèrent à des occupations plus agréables. Les groupes tournèrent le dos à la poétesse et l’oublièrent. Un musicien, jeune, rasé, et chevelu, qui s’efforçait de copier la laideur géniale de certains compositeurs célèbres, s’assit au piano et laissa courir ses doigts sur les touches. Deux jeunes filles accoururent, l’air suppliant, et posèrent leurs mains sur celles du pianiste. Elles seraient heureuses d’entendre tout à l’heure ses œuvres sublimes, mais pour l’instant on le priait de descendre, par bonté d’âme, au niveau du vulgaire et de jouer un air de danse. On se contenterait d’une valse, si ses convictions musicales lui interdisaient de s’abaisser jusqu’à jouer des danses américaines.
Des couples de plus en plus nombreux se mirent à tournoyer au centre du salon; nul ne pensait plus à la comtesse quand celle-ci, regardant avec étonnement de côté et d’autre, se leva:
—Puisque vous me demandez des vers avec tant d’insistance, je cède à ce désir unanime. Je vais dire un court poème.{39}
A ces mots la consternation fut générale. Le pianiste qui n’avait rien entendu continua de jouer; mais il dut s’arrêter car l’humble et anonyme monsieur qui courait de-ci de-là, comme un domestique, s’approcha de lui pour lui saisir les mains. Quand la musique eut cessé, les couples restèrent immobiles et finirent par regagner leurs sièges avec ennui. La comtesse se mit à déclamer. Quelques invités l’écoutaient avec une attention douloureuse ou une immobilité stupide; leur pensée était certainement bien loin. D’autres, les paupières clignotantes, s’efforçaient de vaincre le sommeil qui leur livrait bataille, au martellement monotone des rimes.
Deux dames déjà mûres et d’aspect méchant semblaient s’intéresser vivement au poème et portaient même de temps en temps une main à leur oreille, comme pour mieux entendre. Mais en même temps elles continuaient de causer derrière leurs éventails, que parfois elles laissaient retomber sur leurs genoux pour applaudir en criant «Bravo»! Bientôt après, elles les déployaient à nouveau, et à l’abri de ce rempart d’étoffe, elles se moquaient de la maîtresse de maison.
Derrière elles, Robledo, à demi caché par un rideau, s’appuyait contre le seuil d’une porte. Comme la comtesse déclamait avec véhémence, les deux dames étaient forcées d’élever le ton de leur voix et l’ingénieur, qui avait l’ouïe fine, put entendre ce qu’elles disaient.
—Elle ferait mieux, murmurait l’une d’elles, au lieu de nous offrir des vers, de préparer pour ses invités un buffet mieux garni.
L’autre protesta. La table de la Titonius était plus dangereuse lorsque les mets y abondaient; il fallait un courage héroïque pour accepter de partager ces repas qu’elle-même préparait.{40}
—Au dessert il faut mander un médecin par téléphone, et peut-être faudra-t-il un jour aviser l’agence des pompes funèbres.
Avec des rires étouffés, elles rappelaient l’histoire de la maîtresse de maison. Elle avait été riche en d’autres temps, grâce à ses parents disaient les uns, à ses amants disaient les autres. Pour être comtesse, elle avait épousé le comte Titonius, un noble ruiné et sans lustre qui aima mieux accepter cette humiliation que se faire sauter la cervelle. Sa situation dans la maison n’était même pas celle des domestiques. Lorsque les nerfs de la comtesse étaient mis à l’épreuve par l’infidélité de quelque jeune admirateur, elle lançait dans l’escalier les chemises et les caleçons du comte et lui ordonnait comme une reine offensée de disparaître à jamais.
Une semaine après, la poétesse organisait une nouvelle fête, l’exilé apparaissait, humble et mélancolique, et se repliait sur lui-même de peur de tenir trop de place dans les salons de sa femme.
—Pourquoi d’ailleurs, ajouta une des médisantes, continue-t-elle à donner des fêtes alors qu’elle est complètement ruinée. Regardez la table, et ce qu’on va nous offrir tout à l’heure. Les gros gâteaux, les beaux fruits sont loués pour la soirée, aussi bien que les domestiques. Tout le monde le sait et pas un ne touchera à ces choses appétissantes, ou gare à sa colère! On fait semblant de n’avoir pas faim, on se contente de thé et de biscuits.
Elles cessèrent de murmurer pour applaudir la poétesse qui, enflammée par le succès, se mit à déclamer de nouveaux vers.
Si la conversation méchante des deux dames intéressait peu Robledo, il s’intéressait moins encore au talent poétique de la maîtresse de maison; il profita d’un moment où celle-ci lui tournait le dos{41} en saluant ses admirateurs pour passer dans le cabinet qu’il avait quitté un moment auparavant.
Le même monsieur humble et obséquieux qu’il avait plusieurs fois heurté y fumait, à demi étendu sur un divan, comme un travailleur qui peut trouver enfin quelques minutes de repos. Il s’amusait à suivre des yeux les spirales de fumée qui montaient de sa cigarette; voyant un invité s’asseoir près de lui, il crut nécessaire de lui sourire, après quoi il lui demanda:
—Vous ennuyez-vous beaucoup?
L’Espagnol le regarda fixement avant de répondre:
—Et vous?...
L’autre inclina la tête affirmativement, et Robledo eut un geste qui voulait dire: «Voulez-vous que nous partions?» Mais les yeux mélancoliques de l’inconnu semblèrent répondre: «Quel bonheur si je pouvais m’en aller!»
—Vous êtes de la maison? demanda enfin Robledo.
Et l’autre ouvrant les bras avec découragement dit:
—J’en suis le maître; je suis le mari de la comtesse Titonius.
Sur cette révélation, Robledo crut devoir abandonner son siège et remettre dans sa poche le cigare qu’il allait allumer.
En regagnant les salons il vit tous les invités applaudir bruyamment la poétesse, satisfaits de penser que pour le moment elle avait renoncé à dire d’autres vers. Elle serrait avec effusion les mains qui se tendaient vers elle et séchait la sueur qui perlait à son front, en disant d’une voix langoureuse:
—Je vais mourir. L’émotion! la fièvre de l’art! Vos pressantes prières m’ont tuée en me forçant à réciter mes vers.{42}
Elle regarda de tous côtés comme pour chercher Robledo, et l’ayant aperçu, elle marcha vers lui.
—Votre bras, mon héros, et passons au buffet.
La plus grande partie du public ne put cacher sa joie en voyant s’ouvrir la porte de la salle où l’on avait dressé la table. Beaucoup se mirent à courir, bousculant leurs voisins pour entrer les premiers. La Titonius s’appuyait au bras de l’ingénieur en approchant de son visage ses yeux enflammés.
—Avez-vous pris garde à mon poème «La rougissante aurore de l’amour»... Ne devinez-vous pas à qui je pensais en récitant ces vers?
Il détourna la tête pour échapper à ses regards ardents et aussi parce qu’il craignait de ne pouvoir maîtriser l’envie de rire qui lui chatouillait la gorge.
—Je n’ai rien deviné comtesse. On devient si barbare en vivant sans cesse au désert!
Les invités se pressaient autour de la table; ils admiraient comme un idéal inaccessible les grands plats qui en occupaient le centre. Il y avait là des gâteaux magnifiques, des pyramides de fruits énormes qui se détachaient majestueusement parmi d’autres mets de moindre importance.
Les deux domestiques qui avaient reçu les invités dans l’antichambre et un maître d’hôtel à chaîne d’argent et aux favoris de vieux diplomate semblaient défendre les trésors accumulés au centre de la table; ils ne daignaient offrir que ce qui était placé sur les bords. Ils servaient des tasses de thé et de chocolat ou des verres de liqueur, mais ils ne donnaient à manger que des biscuits et des sandwiches.
Trop hardi, le vieux aux deux cache-nez, que la comtesse appelait «Cher maître», s’épuisait en demandes vaines; les domestiques refusaient de l’entendre tandis qu’il avançait une assiette vide vers les gâteaux et les fruits, en montrant du doigt{43} avec anxiété l’objet de son désir. Même le valet le regardait avec étonnement, comme si sa demande était inconvenante, et il finit par tourner le dos après avoir déposé dans l’assiette un biscuit et un sandwich.
Robledo, devant la table, s’arrêta en présence de ces objets précieux en location que les serviteurs défendaient. La comtesse avait lâché son bras pour répondre à ceux qui la félicitaient. Heureux d’être débarrassé de la poétesse, pour quelques instants, il examina la table, une assiette et un couteau entre les mains. Le maître d’hôtel et ses acolytes s’occupaient de servir la foule; il put avancer entre la table et le mur et coupa tranquillement une tranche du gâteau le plus majestueux. Il eut le temps de prendre aussi un superbe fruit, de le couper en deux et de l’éplucher. Il allait le manger quand la maîtresse de maison, délivrée momentanément de ses admirateurs, tourna vers lui son visage amoureux. Au premier regard elle vit l’énorme gâteau entamé et le fruit divisé sur l’assiette que le héros tenait à la main.
On eût pu suivre sur sa physionomie les phases successives d’une révolution intérieure. On y lut d’abord l’étonnement qu’elle éprouvait devant ce fait inouï bouleversant toutes les règles établies; puis l’indignation; enfin la rancune. Il lui faudrait payer le lendemain ces dégâts stupides... Et elle s’était imaginée avoir trouvé une âme de héros, digne de la sienne!
Elle abandonna Robledo et s’en fut à la rencontre du pianiste qui faisait le tour de la table en demandant successivement à tous les domestiques des sandwiches et des verres de liqueur.
—Votre bras... Beethoven.
Et s’insinuant parmi les groupes elle dit, suivant le musicien:{44}
—J’écrirai un jour un livret d’opéra pour lui; on sera bien forcé alors de parler moins de Wagner.
Elle l’emmena dans le grand salon maintenant désert, le fit asseoir au piano et se mit à déclamer à pleine voix tandis qu’il l’accompagnait en arpèges. Mais les invités ne pouvaient se libérer de l’attraction de la table, et demeuraient sourds aux vers que leur servait la maîtresse de maison, même agrémentés de musique.
Les gens les plus distingués formaient un groupe à part dans la salle où on avait installé le buffet et se tenaient loin des autres personnes qu’avait recrutées la noble poétesse. Dans ce groupe Robledo aperçut le marquis de Torrebianca et sa femme, qui, venant d’une autre soirée, s’étaient présentés fort tard. Hélène semblait distraite et, la pensée au loin, ne prononçait que des formules vides. L’ingénieur comprit qu’il la gênait en lui parlant; il chercha Frédéric, mais le marquis ne lui prêta pas non plus grande attention car il était très occupé à fournir à un monsieur des explications sur les importantes affaires que son ami Fontenoy traitait dans toutes les parties du monde.
Il s’ennuyait et ne comprenait pas encore pourquoi la maîtresse de maison l’avait abandonné; il s’installa dans un fauteuil, et aussitôt il entendit qu’on parlait derrière lui! Ce n’étaient plus les deux dames de tout à l’heure, mais un homme et une femme assis sur un divan qui tenaient eux aussi de méchants propos, comme si dans cette fête les gens ne pouvaient avoir d’autres occupations dès qu’ils formaient un groupe à part.
Il entendit la femme citer le nom de la marquise et dire ensuite à son compagnon:
—Voyez ces magnifiques bijoux. On voit bien que ni le mari ni la femme n’ont eu de peine à les gagner. Chacun sait que le banquier les a payés.{45}
L’homme se croyait mieux informé.
—On m’a dit que ces bijoux étaient faux, aussi faux que ceux de notre poétique comtesse. Les Torrebianca ont gardé l’argent que Fontenoy avait donné pour payer les vrais; peut-être aussi ont-ils vendu les vrais qu’ils ont remplacés par des imitations.
La femme eut un soupir on entendant le nom de Fontenoy.
—Cet homme est bien près de sa ruine. Tout le monde le dit. On parle même de tribunaux et de prisons... Elle est vorace, la Russe!
L’homme eut un sourire incrédule.
—La Russe?... On l’a connue enfant à Vienne où elle chantait ses premières romances dans un music-hall. Un ancien diplomate affirme de son côté qu’elle est espagnole, mais née d’un père anglais... Nul ne connaît sa véritable nationalité, peut-être l’ignore-t-elle elle-même.
Robledo se leva de son siège. Il était indigne de lui de rester là et d’écouter sans rien dire ces propos offensants pour ses amis. Mais avant qu’il eût pu s’éloigner il entendit derrière lui une double exclamation d’étonnement.
—Voici Fontenoy, dit la femme, le grand protecteur des Torrebianca! Il est bien étonnant de le voir dans cette maison; il n’y vient jamais, car il a peur que la comtesse lui emprunte aussitôt de l’argent!... Quelque chose d’extraordinaire est arrivé!
Dans le groupe élégant, l’ingénieur reconnut Fontenoy qui saluait les Torrebianca. Il souriait aimablement, et Robledo ne remarqua dans sa personne rien d’extraordinaire. Même il n’avait plus cette expression préoccupée que donne l’approche menaçante des échéances. Il semblait plus sûr de lui et plus calme que d’autres fois. Seule semblait anor{46}male l’amabilité exagérée qu’il affectait en parlant aux gens.
L’Espagnol, qui l’observait de loin, le vit faire des yeux un léger signe à Hélène. Puis, avec indifférence, il s’éloigna du groupe pour se rapprocher lentement du cabinet solitaire que Robledo au début de la soirée avait occupé avec la comtesse.
Au passage, il serrait distraitement les mains que des invités tendaient, désireux de lui parler. «Enchanté de vous voir...» Et il s’échappait. Il aperçut Robledo et lui fit un salut de la tête; il souriait de l’air indulgent et protecteur qui lui était habituel; leurs regards se croisèrent et ce que Fontenoy put lire dans les yeux de l’autre fit tomber brusquement son masque souriant. Il semblait avoir trouvé dans les pupilles de l’Espagnol comme un reflet de sa propre pensée.
Robledo eut le pressentiment que jamais il n’oublierait ce regard rapide. Ils se connaissaient à peine, et pourtant cet homme, une expression d’abandon fraternel dans les yeux, lui livra toute son âme pendant une seconde.
Bientôt, il vit Hélène à son tour se diriger en cachette vers le cabinet et il sentit une curiosité honteuse le saisir. Il n’avait pas le droit sans doute de se mêler des affaires de ces deux personnes, et cependant il ne pouvait se désintéresser de l’événement extraordinaire qui se préparait en cet instant et que son instinct lui faisait pressentir. Il fallait que cet homme eût un besoin urgent de parler à Hélène pour être venu la chercher jusque chez la comtesse Titonius. Que se disaient-ils en ce moment?
Il se risqua, l’air distrait, jusque devant la porte du cabinet. Hélène et Fontenoy parlaient debout, très droits, le visage impassible. Leurs lèvres{47} remuaient à peine pour qu’on ne pût y lire les mots étouffés qu’elles prononçaient.
Robledo regretta sa curiosité en voyant Fontenoy lui lancer un regard rapide tout en continuant à parler à Hélène qui tournait le dos à la porte. Ce regard le troubla comme le premier. L’homme qui le lui adressait en était peut-être à la minute la plus critique de son existence. Il crut même apercevoir un reproche dans ses yeux: «Pourquoi es-tu curieux de moi, si tu ne peux rien pour me sauver?»
Il n’osa pas repasser devant le cabinet. Mais retenu par une force obscure il prit encore un air indifférent et resta près de la porte, écoutant de toutes ses oreilles. Il savait bien que sa conduite était incorrecte. Il agissait comme le dernier des médisants qu’il avait entendus par hasard. Sans doute, l’ambiance de cette maison exerçait sur lui son influence.
Il était difficile de distinguer les paroles que prononçaient les deux personnes de l’autre côté de la porte ouverte. D’ailleurs les invités recommençaient à danser dans les salons et le pianiste frappait vigoureusement le clavier.
Des mots confus lui parvinrent. Dans le cabinet, les deux interlocuteurs élevaient la voix à cause du bruit. Peut-être aussi leur émotion leur faisait-elle oublier toute réserve.
Il reconnut la voix de Fontenoy.
—Pourquoi faire des phrases? Tu n’es pas capable de faire cela. C’est moi qui partirai... Dans certaines circonstances, il n’y a pas autre chose à faire.
La musique et le bruit du bal l’empêchèrent à nouveau d’entendre; mais le pianiste adoucit pour un instant son jeu impétueux, et il perçut une autre voix. C’était celle d’Hélène qui parlait main{48}tenant, d’un ton lointain, avec un accent d’immense découragement.
—Peut-être as-tu raison. Ah! l’argent!... Quand nous savons tout ce qu’il peut nous donner, la vie est trop horrible sans lui.
Il ne voulut pas en entendre davantage. La honte que lui inspirait son espionnage eut enfin raison de la curiosité malsaine qui s’était emparée de lui pendant quelques moments. Il devait respecter le secret qui rapprochait ces deux personnes. Il pressentait que le mystère serait court. Peut-être, la nuit terminée, serait-il éclairci.
Lorsqu’il revint dans la pièce où le buffet était dressé il aperçut son ami Frédéric qui causait avec la même personne, un monsieur déjà vieux, la rosette de la Légion d’honneur à la boutonnière, l’aspect d’un haut fonctionnaire en retraite.
C’était lui qui parlait, car Torrebianca avait terminé ses explications sur les grandes affaires de Fontenoy.
—Je ne doute pas de l’honorabilité de votre ami, mais je m’abstiendrai de placer de l’argent dans ses affaires. Il me paraît être un homme bien audacieux, et ses entreprises sont trop lointaines. Tout ira bien tant que les actionnaires auront foi en lui. Mais ils commencent à la perdre, semble-t-il; si un jour ils exigent non des espérances mais des réalités, si un jour Fontenoy se trouve obligé de faire connaître en pleine lumière le véritable état de ses affaires... alors...{49}
Robledo se leva très tard; il put cependant admirer la suave splendeur d’un jour de printemps en plein hiver. Un léger brouillard, saturé de soleil, étendait son dais d’or sur Paris.
—Il fait bon vivre, pensa-t-il en quittant l’hôtel où il avait rapidement déjeuné dans une salle à manger où ne restaient que les serviteurs.
Toute l’après-midi, il se promena dans le bois de Boulogne, puis, vers le soir, il regagna les boulevards. Il se proposait de dîner dans un restaurant puis d’aller chercher les Torrebianca pour passer avec eux une partie de la soirée dans un quelconque lieu de distraction.
A la terrasse d’un café il acheta un journal et, avant même de l’ouvrir, il eut le pressentiment que la feuille fraîchement imprimée lui réservait une surprise. Un instinct confus l’avertit qu’il allait trouver la clef d’un mystère jusqu’alors impénétrable!... Au même instant ses yeux tombèrent sur un titre de la première page: «Suicide d’un banquier».{50}
Avant d’avoir lu le nom du désespéré il eut la certitude de le connaître. Ce ne pouvait être que Fontenoy. Aussi n’éprouva-t-il aucune surprise en lisant la suite. Les détails du suicide lui semblèrent des faits naturels et banals, comme si quelqu’un lui eût déjà conté toute l’histoire.
On avait trouvé Fontenoy dans son luxueux appartement, étendu sur le lit, la main droite serrant encore le revolver avec lequel il s’était donné la mort.
Depuis la veille la nouvelle de sa faillite circulait dans les milieux financiers. Cette banqueroute se présentait de telle sorte que l’intervention de la justice était inévitable. Ses actionnaires l’accusaient d’escroquerie; le juge se proposait de vérifier le lendemain sa comptabilité; beaucoup de gens s’attendaient donc à l’arrestation immédiate du banquier.
Le colonisateur relut deux fois la fin de l’article:
«La mort de cet homme découvre le piège où se sont laissés prendre ceux qui lui ont confié leur argent. Ses entreprises minières et industrielles d’Asie et d’Afrique sont presque illusoires. Leur possible développement est à peine commencé, alors qu’il les avait présentées au public comme des affaires en pleine prospérité. Cet homme, affirment certains, a commis plus d’erreurs que de crimes, mais il a tout de même ruiné bien des gens. Il semble en outre qu’une grande partie de l’argent des actionnaires lui ait servi à couvrir des dépenses personnelles. La terrible responsabilité qui lui incombe s’étendra sans aucun doute à ceux qui collaborèrent avec lui à la direction de ces malhonnêtes entreprises.»
En dernière heure on considérait comme probable l’arrestation de quelques personnalités connues qui travaillaient aux ordres du banquier.
Oubliant le mort, Robledo ne pensa plus qu’à son{51} ami: «Pauvre Frédéric, que va-t-il devenir?...» Il prit immédiatement un taxi et se fit conduire avenue Henri-Martin.
Le valet de chambre de Torrebianca le reçut avec un visage funèbre, comme si la mort eût frappé la maison. Le marquis était sorti à midi, aussitôt après avoir appris par téléphone la nouvelle du suicide, et il n’était pas rentré.
—Madame la marquise est malade, ajouta le domestique, et ne veut recevoir personne.
Robledo en l’écoutant put se rendre compte de l’impression que le suicide du banquier avait produite dans la maison.
La discipline glaciale et solennelle des valets avait disparu. Ils avaient l’air effaré d’un équipage qui pressent une tempête capable d’engloutir le navire. Robledo entendit des pas discrets, des murmures derrière les rideaux qui s’entr’ouvraient pour découvrir des yeux curieux.
On avait sans doute parlé aux environs de la cuisine de certaines visites possibles, et lorsque quelqu’un entrait dans la maison on se demandait si ce n’était pas la police. Le chauffeur s’adressait à ses camarades avec une colère contenue:
—Le capitaine est tué, la barque va couler. Qui nous paiera maintenant notre dû?
L’ingénieur revint au centre de la ville pour dîner dans un restaurant et trois fois il demanda au téléphone le logement de Torrebianca. Il était près de minuit lorsqu’on lui répondit que monsieur venait de rentrer; Robledo revint en toute hâte avenue Henri-Martin.
Il trouva Frédéric dans sa bibliothèque; les heures qui venaient de s’écouler semblaient avoir vieilli le marquis plus que des années entières. En voyant entrer Robledo il l’embrassa; il cherchait instincti{52}vement un appui sur quoi reposer son corps sans courage.
Il s’étonnait de pouvoir supporter tant de douleurs accumulées en si peu de temps. Le matin, il avait comme Robledo éprouvé devant la beauté de ce jour une impression de confiance et de bonheur. Il faisait bon vivre!... Et soudain, l’appel du téléphone, la terrible nouvelle, le départ précipité pour la maison de Fontenoy, et puis, étendu sur le lit, le cadavre du banquier, accaparé bientôt par les médecins chargés de l’autopsie; il avait ressenti une émotion plus douloureuse encore à l’aspect des bureaux de Fontenoy. Le juge y était seul maître; il examinait des papiers, apposait des sceaux, scrutait sans pitié, examinait toutes choses d’un regard froid, méfiant, implacable. Le secrétaire du banquier qui par téléphone avait appelé Torrebianca s’efforçait de cacher son trouble et le reçut avec un visage sombre.
—Je crois que cette aventure va mal tourner pour nous. Le patron aurait dû nous prévenir.
Pendant tout le reste du jour, Torrebianca voulut voir tous les autres collaborateurs de Fontenoy, qui touchaient des émoluments considérables pour figurer comme des automates dans les conseils d’administration de ses entreprises. Tous se montraient également pessimistes, tous, possédés d’une terreur féroce, étaient capables des pires mensonges et des pires bassesses pour assurer leur propre salut aux dépens de celui des autres.
Ils accusaient Fontenoy, qu’ils flattaient quelques heures auparavant pour lui arracher de nouvelles gratifications. Certains l’appelaient déjà «bandit»; d’autres, qui pour se justifier sentaient la nécessité de s’attaquer à quelqu’un, eurent des insinuations agressives à l’égard de Torrebianca.
—Vous avez dit dans vos comptes rendus d’en{53}quête que les affaires étaient magnifiques. Sans doute vous avez vu de vos propres yeux ce qui existe réellement dans ces pays lointains; vous n’auriez pas sans cela apposé votre signature au bas des documents techniques qui nous ont inspiré confiance dans les entreprises de cet homme.
Et Torrebianca commença de comprendre que tous avaient besoin d’une victime vivante pour la charger de toutes les terribles responsabilités que le banquier avait éludées en se réfugiant chez les morts.
—J’ai peur, Manuel, dit-il à son camarade. Je ne comprends plus moi-même comment j’ai signé ces papiers sans me rendre compte de leur importance... Qui a bien pu me communiquer cette confiance aveugle dans les entreprises de Fontenoy?
Robledo eut un triste sourire. Il lui était facile de nommer la personne qui l’avait ainsi conseillé; mais pourquoi augmenter encore par une dure révélation le chagrin de son ami?
Au milieu de ces soucis angoissants, Torrebianca pensait toujours à sa femme.
—Pauvre Hélène! Je lui ai parlé tout à l’heure... J’ai cru qu’elle allait s’évanouir quand je lui ai appris que je venais de voir le cadavre de Fontenoy. Cet événement a si violemment éprouvé son système nerveux, que sa santé m’inspire des inquiétudes.
Ces lamentations agacèrent à tel point Robledo qu’il dit brutalement:
—Pense à ta situation et ne t’occupe pas de ta femme. Ce qui te menace est beaucoup plus grave qu’une crise de nerfs.
Les deux hommes, après avoir longuement parlé de la catastrophe, finirent, comme tous ceux qui se familiarisent avec le malheur, par retrouver un certain optimisme. Nul ne pourrait connaître l’exacte vérité tant que le juge n’aurait pas éclairci les affaires du banquier... Fontenoy avait commis plus{54} d’erreurs que de crimes, ses ennemis les plus acharnés le reconnaissaient eux-mêmes. Parmi les entreprises qu’il avait imaginées, plusieurs pouvaient encore devenir excellentes; il avait eu le tort de les lancer trop à la hâte en trompant le public sur leur véritable degré d’avancement? Peut-être des administrateurs prudents sauraient-ils les rendre productives; ils reconnaîtraient que les rapports de Fontenoy étaient exacts et déclareraient que Torrebianca n’avait, en les approuvant, commis aucun délit.
—C’est bien possible, dit Robledo qui avait besoin lui aussi de se montrer optimiste.
Le découragement de son ami l’avait beaucoup inquiété tout d’abord et il préférait l’aider à reprendre confiance en l’avenir; il passerait ainsi une meilleure nuit.
—Tu verras, Frédéric, tout s’arrangera. N’attache pas trop d’importance à ce que disent les anciens parasites de Fontenoy. C’est la peur qui les fait parler.
En se levant, le jour suivant, l’Espagnol demanda avant tout les journaux. Tous se montraient pessimistes et menaçants dans leurs commentaires sur ce suicide qui prenait l’importance d’un grand scandale parisien, et ils auguraient que la justice allait faire incarcérer dans les quarante-huit heures plusieurs personnalités bien connues. Robledo crut même deviner dans un de ces journaux des allusions vagues aux rapports de certain ingénieur protégé de Fontenoy.
Lorsqu’il revit Frédéric dans sa bibliothèque il le trouva plus vieilli et plus découragé encore que la veille. Sur une table il aperçut les journaux que lui-même avait déjà lus.
—On veut me mettre en prison, dit Torrebianca d’une voix plaintive, moi, qui n’ai jamais fait de{55} mal à personne. Je ne puis comprendre pourquoi on s’acharne ainsi contre moi.
Robledo tenta en vain de le consoler.
—Quelle honte! continua-t-il. Jamais personne ne m’a fait peur et pourtant je ne peux soutenir le regard de ceux qui m’entourent. Quand mon valet de chambre me parle, je baisse les yeux pour ne pas rencontrer les siens. Que doit-on dire de moi dans ma propre maison?
Humble et abattu comme s’il fût revenu aux années de son enfance, il ajouta:
—J’ai peur de sortir. Je tremble à la pensée que je rencontrerai peut-être les mêmes personnes que j’ai si souvent vues dans les salons et qu’il me faudra leur expliquer ma conduite, supporter leurs regards ironiques et leurs paroles de fausse commisération.
Il se tut un instant puis reprit, avec un accent admiratif:
—Hélène est plus courageuse. Ce matin, après avoir lu les journaux, elle a fait avancer l’automobile et s’en est allée je ne sais où. Elle doit faire des visites. Elle m’a dit qu’il fallait se défendre... Mais, comment me défendre? Il faut bien reconnaître que j’ai approuvé et signé ces rapports sur des affaires qui m’étaient inconnues!... Je ne sais pas mentir.
Robledo essaya en vain de lui rendre confiance comme la veille; son optimisme fragile n’avait plus la force de renaître.
—Comme toi, ma femme croit que tout peut s’arranger. Elle est si assurée de son influence qu’elle ne désespère jamais. Elle a beaucoup d’amis à Paris, elle y entretient encore des relations de famille. Elle est partie ce matin en jurant qu’elle déjouerait les complots de mes ennemis... car elle suppose que nous avons beaucoup d’ennemis et qu’ils cherchent dans cette faillite de Fontenoy un{56} prétexte à me perdre... Hélène est beaucoup plus avisée que moi; je ne serais pas étonné qu’elle fît changer d’avis les journaux et le juge lui-même et disparaître ces menaces voilées de procès et de prison.
Il frissonna en prononçant ce dernier mot.
—La prison!... Manuel, vois-tu un Torrebianca en prison?... Plutôt que de subir une pareille honte j’aurai recours au plus sûr moyen d’éviter le déshonneur.
Et, comme si dans son âme tous ses ancêtres se fussent dressés sous l’insulte de cette menace, son énergie vibrante et nerveuse d’autrefois semblait ressusciter.
Robledo eut peur en voyant la flamme bleuâtre qui, semblable à l’éclair fugace d’une épée, passait dans les pupilles de son ami.
—Tu ne commettras pas cette sottise, dit-il; avant tout il faut vivre. Tant qu’on est vivant tout s’arrange, bien ou mal. La mort au contraire n’arrange rien... D’ailleurs, qui sait?... Peut-être as-tu raison de penser que ta femme est capable d’aider au rétablissement de ta situation. On a vu réussir des choses plus difficiles.
En sortant de la bibliothèque, Robledo trouva dans l’antichambre plusieurs personnes assises qui attendaient patiemment. Le valet de chambre lui dit avec une familiarité inopportune et désagréable:
—Ils attendent madame la marquise... Je leur ai dit que monsieur était sorti.
Le domestique n’en dit pas davantage; mais il comprit à l’expression malicieuse de ses yeux que les gens qui attendaient étaient des créanciers.
Le suicide du banquier avait mis fin au crédit relatif dont les Torrebianca jouissaient encore. Toutes ces personnes savaient sans doute que Fontenoy était l’amant de la marquise. D’autre part, la{57} faillite de sa banque privait le mari de l’emploi qui en apparence lui permettait de mener une existence luxueuse.
Il comprit alors que son ami éprouvât de la honte et de la répugnance à rencontrer les gens de sa propre maison et s’isolât dans sa bibliothèque.
Au milieu de l’après-midi il l’appela au téléphone. Hélène venait de rentrer après cent courses à travers Paris et semblait satisfaite de ses nombreuses visites.
—Elle m’affirme que pour le moment elle a paré le coup, et que tout finira par s’arranger, dit Torrebianca, qui ne voulait pas donner d’autres détails par téléphone.
Quand la nuit fut tombée, Robledo revint avenue Henri-Martin. Il avait demandé dans un café les journaux du soir et n’y avait rien lu qui pût justifier la tranquillité relative de son ami. Les nouvelles étaient toujours alarmantes et on parlait toujours de l’arrestation probable des personnes compromises dans cette scandaleuse faillite.
Il revit encore, sur une table de la bibliothèque, les journaux que lui-même venait de lire, et il s’expliqua le découragement de son ami, sans ressort devant l’incertitude des événements, et qui passait en quelques heures de la confiance à l’abattement. Sa voix calme et froide contrastait violemment avec son visage douloureusement crispé. Sans aucun doute il avait pris sa résolution et il s’y tenait sans autre raison d’attendre que l’espoir vague d’un miracle. Si le miracle ne se produisait pas...
Robledo regarda de tous côtés, examina la table et les autres meubles de la bibliothèque. Oh! ne pouvoir deviner où son ami avait placé son dernier remède, le revolver!{58}
—Y a-t-il des gens là dehors? demanda Torrebianca.
Comme il semblait ne pas ignorer que des visiteurs désagréables avaient défilé tout le jour dans l’antichambre, Robledo ne lui fit pas préciser sa question et répondit d’un simple signe négatif. Le marquis se mit alors à parler de cette invasion de créanciers qui accouraient de tous les coins de Paris.
—Ils flairent déjà la mort, dit-il, et ils s’abattent sur cette maison comme une bande de corbeaux... Quand Hélène est rentrée cet après-midi l’antichambre était pleine... mais elle possède un charme auquel ne résiste homme ni femme, et il lui a suffi de parler pour convaincre tout le monde. Je crois qu’ils lui auraient consenti de nouvelles avances si elle les leur avait demandées.
Il était fier de faire ressortir le pouvoir séducteur de sa femme; mais la réalité lui laissait peu de loisir d’admirer.
—Ils reviendront, dit-il tristement. Ils sont partis, mais ils reviendront demain... Hélène a vu aussi quelques amis assez puissants pour dicter l’opinion des journaux et influencer les juges. Tous ont juré de l’aider; mais hélas, quand elle est partie, quand ils ne la voient plus, son pouvoir n’est plus le même. On lui a promis d’arranger les choses, et peut-être cela durera-t-il quelques temps; mais que peut une femme contre tant d’ennemis? D’ailleurs je ne dois plus permettre à Hélène de courir de tous côtés pour me défendre tandis que je reste ici enfermé. Je sais à quoi s’expose une femme qui va chercher du secours auprès des hommes. Non... Cela serait pire que la prison.
Et dans les yeux de Torrebianca, qui après s’être montré craintif comme un enfant faisait preuve parfois d’une grande énergie, il passa comme un éclair de colère, à la pensée des périls où pourrait être{59} exposée la fidélité d’Hélène pendant les démarches qu’elle faisait pour le sauver.
—Je lui ai défendu de continuer ses visites, même auprès des amis les plus anciens de sa famille. Un homme d’honneur ne permet pas que sa femme fasse certaines démarches... Fions-nous au sort et à la grâce de Dieu! Les lâches seuls ne trouvent pas de solution quand le moment décisif arrive.
Robledo, qui avait écouté sans donner aucun signe d’impatience, dit d’une voix grave:
—J’ai trouvé une solution meilleure que la tienne puisqu’elle te permettra de vivre... Viens avec moi.
Et posément, avec un sang-froid méthodique, comme il aurait exposé une affaire commerciale ou un projet industriel, il lui expliqua son plan.
Il était absurde d’espérer un règlement favorable des affaires bouleversées par le suicide de Fontenoy, et il devenait dangereux de rester à Paris.
—Je devine ce que tu comptes faire demain ou peut-être ce soir si tu juges ta situation désespérée. Tu sortiras ton revolver de sa cachette, tu prendras une plume et tu rédigeras deux lettres; sur une enveloppe tu écriras: «Pour ma femme», sur l’autre: «Pour ma mère», ta pauvre mère qui t’aime tant, qui s’est toujours sacrifiée pour toi, et que tu récompenseras de ses sacrifices en quittant la terre avant qu’elle-même en soit partie!
Le ton accusateur de ces paroles troubla Torrebianca. Ses yeux se mouillèrent et il courba le front comme écrasé par le remords d’une action basse. Ses lèvres tremblèrent et Robledo crut apercevoir qu’elles murmuraient: «Maman! ma pauvre maman!»
Maîtrisant son émotion, Frédéric releva la tête.
—Crois-tu, dit-il, qu’elle sera plus heureuse de me voir en prison?{60}
L’Espagnol haussa les épaules.
—Tu n’as pas besoin d’aller en prison pour continuer à vivre. Je te demande seulement de te laisser conduire par moi et de m’obéir sans me faire perdre de temps.
Après un coup d’œil sur les journaux qui se trouvaient sur la table, il ajouta:
—Comme je crois ton salut à peu près impossible, demain nous partirons pour l’Amérique du Sud. Tu es ingénieur; là-bas en Patagonie tu pourras travailler à mon côté... Acceptes-tu?
Torrebianca demeura impassible comme s’il n’eût pas compris cette proposition ou l’eût jugée absurde et indigne d’une réponse. Robledo parut s’irriter du silence de son ami.
—Pense donc aux documents que tu as signés pour servir Fontenoy et qui affirment l’excellence d’affaires que tu n’avais même pas étudiées.
—Je ne pense qu’à cela, répondit Frédéric; c’est pourquoi je trouve que ma mort est nécessaire.
L’Espagnol ne put retenir son indignation et se levant de sa chaise, il se mit à crier:
—Mais je ne veux pas que tu meures, triple sot. Je t’ordonne de vivre et tu dois m’obéir... Imagine-toi que je suis ton père... non pas ton père, puisqu’il est mort quand tu étais tout enfant... figure-toi que je suis ta mère, ta vieille maman qui t’aime tant, et qu’elle te dise: «Obéir à ton ami c’est m’obéir à moi.»
Il parlait avec véhémence et Torrebianca fut si troublé qu’il dut porter la main à ses yeux. Robledo profita de ce moment d’émotion pour lancer ce qu’il avait de plus important et de plus difficile à dire.
—Je t’emmènerai d’ici. Tu viendras en Amérique où tu pourras trouver une existence nouvelle. Tu travailleras durement, mais le travail est là-bas{61} plus noble et plus profitable que dans le vieux monde; tu subiras bien des souffrances et peut-être à la fin deviendras-tu riche; mais pour cela il faut venir... seul avec moi.
Le marquis se dressa et découvrit son visage. Puis il regarda son ami avec un étonnement douloureux. Seul! Comment osait-il lui proposer d’abandonner Hélène? Il aimait mieux mourir et ne plus subir le tourment de penser anxieusement à toute heure au sort de sa femme.
La colère s’emparait de Robledo et comme il se montrait vif lorsqu’on tentait de s’opposer à sa volonté, il s’écria d’un ton ironique:
—Ton Hélène!... Ton Hélène!... est...
Il se repentit en voyant le visage de Frédéric et pour essayer de justifier son accent agressif il continua:
—Ton Hélène est en grande partie responsable de la situation où tu te trouves aujourd’hui. C’est pour elle que tu as signé ces documents qui te déshonorent dans ta profession.
Frédéric courba la tête, mais l’autre continua d’attaquer.
—Comment ta femme a-t-elle connu Fontenoy? Tu m’as dit qu’il était un vieil ami de sa famille... et c’est là tout ce que tu sais.
Il se contint un instant, mais la colère l’emporta sur la prudence qui lui conseillait de se taire.
—Les femmes connaissent toujours notre histoire mais nous ne savons d’elles que ce qu’elles veulent bien nous raconter.
Le marquis parut s’efforcer de comprendre le sens de ces paroles.
—J’ignore ce que tu veux dire, dit-il d’une voix sombre; mais songe que tu parles de ma femme. N’oublie pas qu’elle porte mon nom. Et je l’aime tant!{62}
Tous deux demeurèrent silencieux. Les minutes qui s’écoulaient semblaient les éloigner de plus en plus l’un de l’autre. Robledo crut devoir prendre la parole pour renouer leur ancienne amitié.
—La vie est bien dure là-bas, et c’est quand on est bien loin qu’on apprécie les commodités de la civilisation. Mais dans le désert on prend comme un bain d’énergie qui purifie et transfigure les fugitifs du vieux monde et les prépare à une existence nouvelle. Tu rencontreras dans ce pays des survivants de toutes les catastrophes; ils y sont arrivés comme ces naufragés qui se sauvent à la nage et prennent pied sur une île fortunée. Toutes les distinctions de nationalité, de caste et de naissance disparaissent; il n’y a plus là-bas que des hommes. La terre où je demeure est... la terre de tous.
Comme Torrebianca demeurait impassible, il jugea bon de lui rappeler à nouveau sa situation.
—Ici t’attendent la prison et le déshonneur ou, ce qui est pire, la solution que tu as trouvée, la mort. Là-bas tu retrouveras l’espérance, le bien le plus précieux dans la vie... Viens-tu?
Le marquis sortit de son abattement et esquissa enfin un mouvement affirmatif; mais Robledo, du geste, lui ordonna d’attendre et il ajouta avec énergie:
—Tu connais mes conditions. Il faut partir là-bas comme pour la guerre, avec peu de bagages; et la femme est une lourde gêne dans les expéditions de ce genre... Ta femme ne mourra pas de chagrin si tu la laisses en Europe; vous vous écrirez comme des fiancés; une longue absence stimule l’amour. En outre, tu pourras lui envoyer de l’argent pour lui permettre de vivre à l’aise. De toutes façons tu feras beaucoup plus pour elle que si tu meurs ou si tu te laisses mettre en prison... Veux-tu venir?
Torrebianca demeura longtemps pensif. Il se leva{63} enfin, puis faisant signe à Robledo d’attendre, il sortit de la bibliothèque.
L’Espagnol ne resta pas longtemps seul. Il crut entendre très loin des voix, presque des cris que les tentures et les cloisons étouffaient. Des pas plus rapprochés résonnèrent, un rideau se souleva violemment et Hélène, suivie de son mari, entra dans la bibliothèque.
C’était une Hélène transformée par les événements. Robledo pensa que pour elle aussi les heures avaient été longues comme des années. Elle paraissait plus vieille sans pour cela cesser d’être belle. Sa beauté fanée était plus sincère que celle des jours riants. Elle avait cet attrait mélancolique des bouquets de fleurs qui commencent à se flétrir. Vingt-quatre heures avaient passé sans qu’elle eût pu prendre soin de son corps et de plus elle était sans cesse sous l’empire d’émotions nouvelles, les unes douloureuses, les autres blessantes pour son amour-propre.
Bien plus qu’au sort de son mari elle pensait à ce que pouvaient dire en ce moment ses nombreuses amies de Paris.
Elle rejeta violemment la tenture derrière elle et s’avança à travers la bibliothèque comme un flot invincible. Ses yeux semblèrent défier Robledo.
—Que vient de me dire Frédéric? dit-elle d’une voix âpre. Vous voulez l’emmener, vous voulez qu’il abandonne sa femme au milieu de tant d’ennemis?
Torrebianca qui, entré derrière elle, se sentait à nouveau dominé, crut devoir protester pour l’assurer de sa fidélité.
—Je ne t’abandonnerai jamais... Je l’ai déjà dit à Manuel.
Mais Hélène, qui ne l’écoutait pas, avança jusqu’auprès de Robledo.
—Et moi qui vous prenais pour un ami sûr!{64} Misérable! Vous voulez priver une femme de son seul soutien, lui dérober son mari?
Tout en parlant elle regardait fixement les yeux de l’Espagnol, comme si elle eût voulu y retrouver sa propre image. Mais elle lut de telles choses dans ces pupilles que sa voix devint plus douce et qu’elle finit par menacer l’Espagnol du doigt avec une moue d’enfant prêt à pleurer. Le colonisateur demeura impassible; il jugeait sans doute inopportunes ces grâces puériles et Hélène dut reprendre un ton grave.
—Voyons, expliquez-vous. Dites-moi quel plan vous avez formé pour emmener mon mari jusqu’à ces terres lointaines où vous vivez en seigneur féodal.
Insensible à la voix et aux yeux d’Hélène, Robledo répondit froidement, du même ton qu’il eût pris pour exposer les devis d’une entreprise industrielle.
Il avait imaginé, tout en causant avec Frédéric le moyen de quitter Paris. Il retiendrait pour lui le jour suivant une automobile comme s’il avait brusquement décidé de partir pour l’Espagne. Il fallait prendre des précautions. Torrebianca était toujours libre mais la police le surveillait peut-être pendant que le juge cherchait à établir sa culpabilité. La frontière espagnole était loin, mais ils la passeraient avant que la justice ait pu lancer un mandat d’arrêt.
D’ailleurs il avait à la frontière même des amis qui les aideraient en cas de danger et leur permettraient d’atteindre tous deux Barcelone. Une fois rendus à ce port ils trouveraient facilement le moyen de gagner l’Amérique du Sud.
Hélène l’écoutait en hochant la tête, le sourcil froncé.
—Tout cela est fort bien imaginé, dit-elle, mais pourquoi ce plan ne prévoit-il que le départ de mon{65} mari, pourquoi ne partirais-je pas avec vous moi aussi?
Cette proposition étonna Torrebianca. Quelques heures auparavant, Hélène en rentrant à la maison avait exprimé une grande confiance en l’avenir pour encourager son mari et peut-être pour se faire illusion à elle-même.
Elle venait de rendre visite à des hommes qu’elle connaissait de longue date; ils lui avaient fait de grandes promesses avec cette galanterie protectrice et mélancolique qu’impose le souvenir de lointaines amours.
Il fallait bien croire à ces phrases qui peut-être contenaient leur seule chance de salut; mais maintenant, après avoir entendu Robledo exposer son plan, elle sentait s’écrouler son optimisme.
Les promesses de ses amis n’étaient que de doux mensonges; personne ne ferait rien pour eux en les voyant dans le malheur; la justice suivrait son cours. Son mari irait en prison et elle devrait recommencer sa vie... Recommencer! et cela dans un monde trop vieux, où elle aurait peine à trouver un endroit qu’elle n’eût pas déjà connu... et contre tant d’amies avides de vengeance!
Robledo vit passer dans ses yeux une expression toute nouvelle. Elle avait peur; peur, comme une bête traquée. Pour la première fois il surprit dans la voix d’Hélène un accent de sincérité.
—Vous êtes le seul, Manuel, à voir clairement notre situation; vous seul pouvez nous sauver... mais emmenez-moi aussi. Je n’ai pas la force de rester... J’aimerais mieux mendier dans un monde qui ne sera pas celui-ci.
Il y avait dans cette prière tant de tristesse et de douceur que l’Espagnol eut pitié et qu’il oublia ses pensées hostiles.
Torrebianca dut se rendre compte de la faiblesse{66} subite de son ami; il en profita pour affirmer avec énergie:
—Je te suis avec elle ou je reste avec elle, quoi qu’il arrive.
Robledo eut encore un mouvement d’hésitation; puis il accepta d’un geste de la tête. Immédiatement il eut un regret; il lui sembla qu’il venait d’approuver une chose absurde.
Hélène, qui oubliait avec une étonnante facilité les angoisses de l’heure, se mit à rire:
—J’ai toujours adoré les voyages, dit-elle avec enthousiasme; je monterai à cheval, je chasserai les bêtes féroces, j’affronterai de grands dangers. Je vivrai une existence plus savoureuse que celle d’ici, une vie d’héroïne de roman.
L’Espagnol la regardait, étonné de cette inconscience. Elle ne pensait plus à Fontenoy. Elle semblait même avoir oublié qu’elle était encore à Paris et que la police pouvait d’un moment à l’autre entrer dans la maison pour emmener son mari.
Il était inquiet, car il y avait loin de la vie réelle des colons du désert américain aux fictions romanesques que cette femme accueillait.
Torrebianca les interrompit avec découragement; le plan de son ami lui semblait d’exécution difficile.
—Avant de partir il faut payer nos dettes. Où prendrons-nous de l’argent?
Sa femme se mit à rire d’un air étonné.
—Payer! qui parle de payer? Les créanciers attendront. Je trouve toujours le mot qu’il faut leur dire... Nous leur enverrons de l’argent d’Amérique, quand tu seras riche.
Mais le marquis ne pouvait se débarrasser aussi promptement de ses scrupules.
—Je ne partirai pas d’ici avant d’avoir payé tous les domestiques. Et d’ailleurs il nous faut de l’argent pour le voyage.{67}
Il y eut un long silence; puis le mari s’écria comme s’il venait de trouver une solution:
—Heureusement, nous avons tes bijoux. Nous pouvons les vendre avant de nous embarquer.
Hélène regarda avec ironie le collier et les bagues qu’elle portait à ce moment.
—On ne nous donnera pas deux mille francs de ceux-là ni de tous les autres, tous sont faux, complètement faux.
—Mais, et les vrais? demanda Torrebianca stupéfait. Et ceux que tu as achetés avec l’argent qu’on t’envoyait de tes propriétés de Russie?
Robledo crut devoir intervenir pour couper court à ce dialogue dangereux.
—Ne cherche pas à savoir tant de choses; parlons du présent... Je paierai les domestiques; et je me charge des frais de votre voyage.
Hélène lui prit les deux mains et murmura des mots de remerciements. Torrebianca, touché de cette générosité, se refusait cependant à l’accepter, mais l’Espagnol mit fin à ses protestations.
—Je suis venu à Paris avec de l’argent pour six mois; je m’en irai au bout de quatre semaines, voilà tout.
Puis il ajouta d’un air de désespoir comique:
—Je m’en irai sans connaître plusieurs restaurants nouveaux, et sans avoir goûté deux ou trois vins de marque... Tu vois si mon sacrifice est extraordinaire.
Frédéric lui serra les mains silencieusement cependant qu’Hélène le prenait dans ses bras et l’embrassait avec l’impudeur de l’enthousiasme.
Elle ne parlait plus que de ce pays inconnu auquel elle ne pensait guère un instant auparavant et qu’elle admirait déjà à l’égard d’un paradis.
—Il me tarde de me voir dans ce pays neuf, qui, comme vous le dites, est la terre de tous!{68}
Et pendant que les deux époux se concertaient sur les préparatifs de leur voyage, ou bien plutôt de leur fuite, Robledo, les yeux fixés sur Hélène, se disait:
«Quelle sottise je viens de commettre! Quel terrible cadeau j’apporte à ceux qui vivent là-bas d’une vie rude... mais en paix.»{69}
Des travailleurs aragonais, émigrés en Argentine en emportant précieusement dans leurs bagages une guitare pour accompagner leurs couplets improvisés, la virent passer et consacrèrent une chanson à la «Fleur du Rio Negro».
Ce surnom printanier eut un sort dans le pays, et tout le monde appela ainsi la fille du propriétaire de l’estancia[4] de Rojas; son véritable nom était Celinda.
Elle avait dix-sept ans; d’une taille au-dessous de son âge, elle étonnait cependant par l’agilité de ses membres et l’énergie de ses gestes.
Dans le pays, beaucoup d’hommes qui admiraient comme les Orientaux les femmes grasses et considéraient que sans des chairs opulentes il n’est point de beauté, avaient une moue d’indifférence lorsqu’on chantait en leur présence les louanges de la fille de Rojas. Certes elle avait un visage aimable et fripon,{70} un nez retroussé, une bouche d’un rouge sanglant, des dents aiguës et très blanches, des yeux énormes, à peine un peu trop arrondis. Mais, sa mignonne figure mise à part... rien d’une femme!
—Elle est aussi plate par devant que par derrière, disaient-ils, on dirait un garçon.
Effectivement, de loin on la prenait pour un petit homme car elle portait toujours un costume masculin et montait à califourchon des chevaux fougueux. Parfois, elle faisait tournoyer un lasso au-dessus de sa tête, comme faisaient les péons[5], et elle poursuivait quelque cavale ou quelque jeune taureau de l’estancia de don Carlos Rojas, son père.
Ce dernier, disait-on dans le pays, appartenait à une vieille famille de Buenos-Ayres. Il avait mené dans sa jeunesse une vie fort joyeuse dans les principales villes d’Europe. Il s’était ensuite marié; mais la vie de son ménage dans la capitale de l’Argentine avait été aussi coûteuse que ses voyages de célibataire dans l’ancien continent; peu à peu il gaspillait en dépenses somptuaires et en mauvaises affaires la fortune qu’il tenait de ses parents.
Sa femme était morte au moment où il venait de se rendre compte qu’il était ruiné.
C’était une dame maladive et mélancolique qui publiait des vers sentimentaux, sous un pseudonyme, dans les journaux de modes et qui légua à sa fille le nom de Celinda, poétique souvenir.
Le señor Rojas dut abandonner l’estancia de ses parents située près de Buenos-Ayres et qui valait plusieurs millions. Trois hypothèques pesaient sur elle, et quand les créanciers eurent partagé le produit de sa vente il ne resta à don Carlos d’autre ressource que de quitter la partie la plus civilisée de l’Argentine pour s’installer à Rio Negro; il y{71} possédait quatre lieues de terres qu’il avait acquises au temps de sa richesse, par caprice, et sans savoir au juste ce qu’il achetait.
Beaucoup de gens ruinés croient trouver dans l’agriculture un moyen de refaire leur fortune, alors même qu’ils ignorent les principes élémentaires du travail de la terre. Ce criollo[6], habitué à mener à Paris et à Buenos-Ayres une existence dissipée, crut pouvoir lui aussi réaliser un tel miracle. Il n’avait jamais voulu s’occuper de l’administration d’une estancia toute proche de la capitale où d’inépuisables prairies naturelles nourrissaient des milliers de jeunes taureaux, et il dut se résoudre à la vie dure et sobre du fruste cavalier qui paît son troupeau sur des terres incultes.
La tâche que ses prédécesseurs avaient entreprise dans la campagne riche voisine de Buenos-Ayres, Rojas dut la reprendre sous le ciel de bronze de la Patagonie qui laisse à peine tomber chaque année quelques gouttes d’eau sur le sol poussiéreux.
L’ancien millionnaire portait son malheur avec dignité. C’était un homme de cinquante ans, plutôt petit que grand, au nez aquilin, à la barbe blanchissante. Malgré la vie sauvage qu’il menait il avait conservé sa politesse primitive. Ses manières décelaient l’homme sorti d’un milieu social plus élevé que celui où il devait vivre maintenant. Comme on disait à la Presa, le village le plus proche, cet homme-là, bien ou mal vêtu, avait l’air d’un monsieur. Il portait presque toujours des bottes entières, un large feutre et un poncho. A sa main droite se balançait le court fouet de cuir appelé là-bas rebenque.
Les bâtiments de son estancia avaient peu d’appa{72}rence. Il les avait construits hâtivement avec l’espoir de les améliorer quand sa fortune aurait augmenté. Mais, comme il arrive toujours quand on construit à la campagne, cette installation provisoire allait durer plus longtemps peut-être que les bâtiments considérés ailleurs comme définitifs.
Sur les murs de briques cuites, sans revêtement extérieur, ou de simple argile séchée, s’élevait une toiture faite de plaques de zinc ondulé. A l’intérieur de la maison de maître les cloisons s’arrêtaient à une certaine hauteur et laissaient l’air circuler librement dans la partie supérieure du bâtiment. Les meubles étaient rares dans les pièces. La salle où don Carlos recevait ses visites servait de salon, de bureau et de salle à manger; elle était ornée de quelques fusils et de peaux de pumas abattus dans les environs. L’estanciero[7] passait hors de la maison une grande partie du jour à inspecter les parcs à bestiaux les plus voisins.
Il mettait brusquement au galop sa monture, un cheval de piètre mine mais infatigable pour surprendre les péons qui travaillaient à l’autre extrémité de sa propriété.
Un matin, il s’impatientait de voir l’heure du repas se passer sans que Celinda regagnât l’estancia. Il n’était pas inquiet. Depuis qu’âgée de huit ans, elle était arrivée à Rio Negro, elle avait vécu à cheval et considéré la plaine déserte comme sa demeure.
—Et il ne ferait pas bon la fâcher, disait le père avec orgueil. Elle manie le revolver mieux que moi, et lorsqu’elle a un lasso entre les mains il n’y a pas d’homme ou d’animal capable de lui échapper. Ma fille, c’est un homme à poigne.
Soudain il la vit galoper sur la ligne où la plaine{73} rejoignait le ciel. Elle semblait un petit cavalier de plomb échappé d’une boîte de jouets. En avant de son petit cheval courait un taureau en miniature. Le groupe lancé au galop grossit avec une étonnante rapidité. Dans cette immense étendue les objets mouvants changeaient de dimensions sans suivre une progression régulière, et les yeux mal habitués aux caprices optiques du désert étaient sans cesse surpris et désorientés.
La jeune fille s’approchait en criant et en agitant son lasso pour presser la marche de la bête qu’elle poursuivait et la forcer à se réfugier dans un enclos de madriers.
Puis elle mit pied à terre et vint au-devant de son père; don Carlos, après avoir reçu son baiser, la repoussa à bout de bras et regarda sévèrement le costume d’homme qu’elle portait.
—Je t’ai dit bien souvent que je ne voulais pas te voir ainsi. Les pantalons sont faits pour les hommes, je crois, et les jupons pour les femmes. Je ne supporterai pas que ma fille s’en aille attifée comme ces actrices qu’on voit sur la toile du cinématographe.
Celinda reçut la réprimande les yeux baissés hypocritement. Elle promit gentiment d’obéir à son père, mais en même temps elle se retenait de rire. Justement elle rêvait toujours de ces amazones en culottes qui passent dans les films nord-américains et souvent elle avait fait de longues galopades pour arriver jusqu’à Fort Sarmiento, l’endroit le plus voisin où des opérateurs errants projetaient sur un drap, dans le café de l’unique hôtel, des histoires intéressantes qui lui permettaient d’étudier les modes nouvelles.
Pendant le repas don Carlos lui demanda si elle avait été dans le voisinage de la Presa et si les travaux du fleuve étaient en bonne voie.{74}
L’espoir, chaque jour plus justifié, de devenir riche à nouveau rendait depuis quelques mois son sourire à Rojas, autrefois si mélancolique et si découragé. Si les ingénieurs de l’Etat parvenaient à lancer une digue en travers du Rio Negro, les canaux qu’un Espagnol nommé Robledo et son associé étaient en train d’ouvrir féconderaient les terres qu’ils avaient achetées tout près de son estancia, et lui-même profiterait de cette irrigation qui allait augmenter dans des proportions inouïes la valeur de ses champs.
Celinda l’écouta avec l’indifférence que la jeunesse manifeste à l’égard des questions d’argent. Don Carlos dut d’ailleurs se priver du plaisir de contempler en espérance sa richesse future, à l’entrée d’une métisse joufflue aux formes débordantes, aux yeux bridés, et dont les cheveux noirs et rigides descendaient en une tresse épaisse le long de son dos énorme et proéminent.
En entrant dans la salle à manger elle abandonna près de la porte un sac plein de hardes. Puis elle se précipita sur Celinda, l’embrassa et lui inonda le visage d’un flot de larmes.
—Ma jolie petite patronne! Ma petite, que j’ai toujours aimée comme ma fille!
Elle connaissait Celinda depuis le jour où elle était arrivée dans le pays et où elle-même était entrée comme domestique à l’estancia. Il lui était pénible de quitter mademoiselle mais elle ne pouvait plus supporter le caractère de son père.
Don Carlos commandait un peu brutalement et il n’admettait aucune objection de la part des femmes, surtout lorsque celles-ci n’étaient plus très jeunes.
—Le patron est vert encore, disait Sébastienne à ses amies, et dès qu’on se fait vieille les sourires et les jolies paroles vont aux plus fraîches; pour{75} moi on me houspille et on me menace du rebenque.
Après avoir embrassé la jeune fille, Sébastienne regarda don Carlos avec une indignation un peu comique et ajouta:
—Puisque nous ne pouvons plus nous entendre, le patron et moi, je m’en vais à la Presa servir chez l’entrepreneur italien.
Rojas haussa les épaules pour indiquer qu’elle pouvait très bien s’en aller où bon lui semblait, et Celinda accompagna sa vieille servante jusqu’à la porte du bâtiment.
Au milieu de l’après-midi, ayant fait la sieste dans un hamac de toile et lu quelques journaux de Buenos-Ayres que le chemin de fer apportait trois fois par semaine dans ce désert, don Carlos sortit de la maison.
Un cheval sellé était attaché à un des poteaux qui supportaient l’auvent de la porte. L’estanciero eut un sourire satisfait en voyant que la selle était d’amazone. Celinda parut à ce moment en jupe à l’écuyère. Du bout de son rebenque elle envoya un baiser à son père et sans prendre appui sur l’étrier ni demander l’aide de personne elle se mit en selle d’un bond et lança son cheval au galop dans la direction du fleuve.
Elle n’alla pas bien loin. Derrière un bouquet de saules elle trouva, à l’attache, un autre cheval portant une selle d’homme; celui qu’elle avait monté le matin. Celinda mit pied à terre, se dépouilla de son costume féminin et apparut en culotte et en bottes avec une chemise et une cravate d’homme. Elle souriait de désobéir au «vieux», car suivant l’usage du pays, c’était ainsi qu’elle appelait son père.
Elle tenait à ne pas surprendre malencontreusement celui qui l’avait toujours connue vêtue comme un garçon et qui la traitait de ce fait avec{76} une confiante camaraderie. Qui sait si, en la voyant en jupes, comme une demoiselle, il ne se sentirait pas intimidé, s’il ne deviendrait pas plus cérémonieux et n’éviterait pas désormais de la rencontrer?
Elle abandonna sa robe sur le dos du cheval qui l’avait amenée et monta joyeusement sur l’autre. Elle lui serra les flancs dans ses jambes nerveuses et, lançant en l’air le lasso qu’elle portait attaché à sa selle, elle fit monter la corde en spirale au-dessus de sa tête.
Elle galopa le long de la berge, au ras des vieux saules qui penchaient leur chevelure sur la course rapide du fleuve. Ce chemin liquide, toujours désert, qui descendait des glaciers des Andes, tout proches du Pacifique, pour aller se jeter dans l’Atlantique, devait son nom, affirmaient certains, aux plantes sombres qui tapissent son lit et donnent aux eaux, filles des neiges, une teinte vert foncé.
L’effort de son cours millénaire avait peu à peu taillé dans le plateau une profonde vallée, large d’une lieue ou deux. Le fleuve courait dans cette gorge entre deux talus constitués par des alluvions qu’il avait déposées pendant les grandes inondations. Ces deux rives inégales étaient formées de terre fertile et molle, cultivable aussi loin que les pénétrait l’humidité des eaux voisines.
Plus loin, le sol s’élevait et, face à face, deux murailles escarpées, sinueuses et jaunâtres, se regardaient. Celle de gauche limitait la Pampa. Sur la rive opposée commençait le plateau patagon, région de froids glacials, de chaleurs suffocantes, d’ouragans terribles; la flore pauvre ne permettait aux troupeaux d’y trouver leur pâture que s’ils avaient devant eux d’énormes étendues.
Toute la vie du pays se trouvait concentrée dans la large coupure que les eaux avaient ouverte et qui formait frontière entre la Pampa et la Patagonie.{77} Les deux bandes de terre qui longeaient les rives offraient plusieurs milliers de kilomètres de sol fertile, apport du fleuve au cours de son voyage des Andes à la mer.
C’était dans une section de ce ravin immense que des hommes travaillaient à élever de quelques mètres le niveau des eaux pour fertiliser les champs d’alentour. Celinda excitait à grands cris son cheval comme pour lui communiquer sa joie. Elle courait à ce qui l’intéressait le plus dans le pays. Elle suivit un des méandres du fleuve et soudain les eaux s’étalèrent devant elle comme un lac tranquille et désert. Plus loin, à l’endroit où les rives se resserraient et emprisonnaient un courant tumultueux, elle aperçut les silhouettes de fer de plusieurs machines élévatrices et les toits de zinc ou de chaume d’un village. C’était l’ancien campement de la Presa qui devenait rapidement une agglomération.
Tous les bâtiments semblaient écrasés contre le sol; aucune tourelle, aucun étage élevé n’en rompait la plate monotonie.
Comme la jeune fille n’avait pas besoin d’aller jusqu’au village pour trouver ce qu’elle cherchait, elle modéra l’allure de son cheval et se dirigea au pas vers des groupes d’hommes qui travaillaient en un point assez éloigné du fleuve, presque à l’endroit où la plaine commençait à se relever pour former la pente du plateau où s’étendait la Pampa.
Ces ouvriers, européens ou métis, retournaient et amoncelaient la terre pour ouvrir de petits canaux destinés à l’irrigation. Deux machines, dont les moteurs mugissants accompagnaient le travail, creusaient aussi le sol pour alléger le labeur de l’homme.
Celinda regarda autour d’elle avec des yeux scrutateurs et tournant le dos au groupe d’ouvriers elle se dirigea vers un homme qui se tenait seul sur une hauteur. Cet homme était assis sur un siège de{78} toile devant une table pliante. Il portait un costume de travail et des bottes. Un grand chapeau reposait sur le sol à ses pieds, et, le front dans ses mains, il étudiait les papiers étalés sur la table.
C’était un jeune homme, blond, aux yeux clairs. Sa tête faisait penser à celle des athlètes que la sculpture grecque a éternisée; type que l’on retrouve fréquemment, sans qu’on sache pourquoi, chez les races de l’Europe du Nord: un nez droit, des cheveux courts et bouclés qui envahissaient le front bas et large, un cou vigoureux. Il était à ce point absorbé par l’étude de ses papiers qu’il ne vit pas arriver la «fleur du Rio Negro».
Elle avait mis pied à terre sans abandonner son lasso. Avec la souplesse et la ruse d’un Indien, elle avança à quatre pattes sur la pente douce sans que le moindre bruit dénonçât son approche. A quelques mètres de l’homme, elle se redressa, et riant à part soi de son espièglerie, elle imprima à son lasso une rotation énergique, puis le lâcha dans l’espace. La boucle s’abattit sur le jeune homme, se resserra, lui immobilisa les bras par le milieu, et une légère traction le fit chanceler sur son siège. Furieux, il regarda autour de lui et fit mine de se mettre en défense; mais sa colère fit place à un joyeux étonnement. Un éclat de rire insolent et frais parvint à ses oreilles, et il aperçut Celinda qui, heureuse du succès de sa ruse, tira plus fort sur le lasso. Pour ne pas être renversé il dut marcher dans la direction de l’amazone. Quand il fut près d’elle, elle dit comme pour s’excuser:
—Il y a si longtemps que nous ne nous sommes vus! Je suis venue vous capturer; ainsi vous ne m’échapperez plus.
Le jeune homme prit un air surpris et répondit d’une voix lente et maladroite, en écorchant les mots avec sa prononciation étrangère:{79}
—Si longtemps? Ne nous sommes-nous pas vus ce matin?
Elle imita son accent pour répéter:
—Si longtemps?... Et quand cela serait, «gringo[8]» plein d’ingratitude. C’est donc peu de chose que de ne s’être pas vus depuis ce matin!
Tous deux se mirent à rire avec une gaieté d’enfants. Ils étaient revenus à l’endroit où le cheval attendait, et Celinda se hâta de se mettre en selle comme si elle eût craint en restant à pied de se trouver humiliée et désarmée.
Maintenant le «gringo», malgré sa haute taille, atteignait à peine de la tête sa ceinture et la «fleur du Rio Negro» acquérait en le regardant de haut en bas une hautaine supériorité. Comme l’étranger avait encore autour du buste la boucle de la corde, Celinda voulut l’en débarrasser.
—Dites donc, don Ricardo, j’en ai assez d’avoir un esclave. Je vais vous rendre la liberté et vous laisser travailler un peu.
Elle fit glisser le lasso par-dessus les épaules du jeune homme; mais voyant qu’il restait immobile comme si sa présence lui eût enlevé toute initiative, elle lui présenta sa main droite avec une majesté comique.
—Baisez ma main, mister Watson; soyez poli. Vous êtes en train de perdre dans ce désert les belles manières que vous avez apprises à l’Université de Californie.
Le ton solennel de la jeune fille fit rire l’ingénieur qui se décida à lui baiser la main. Mais il la regardait avec l’indulgence protectrice des grandes personnes qui s’amusent des espiègleries d’une enfant malicieuse, et la fille de Rojas en parut contrariée.{80}
—Nous finirons par nous fâcher. Vous vous obstinez à me traiter comme une gamine alors que je suis la plus grande dame du pays, la princesse «doña Flor du Rio Negro».
Watson continuait à rire et Celinda renonça à sa gravité affectée. Elle joignit ses éclats de rire à ceux de Watson; mais aussitôt mademoiselle Rojas, avec un intérêt maternel, s’informa minutieusement de la vie que menait son ami.
—Vous travaillez trop; je ne veux plus que vous vous fatiguiez, vous savez, gringuito[9]?... C’est bien du souci pour un homme seul. Quand revient votre ami Robledo? Il est certainement en train de s’amuser à Paris.
Watson redevint sérieux en entendant prononcer le nom de son associé. Il était déjà de retour et arriverait d’un moment à l’autre. Mais son travail n’était pas bien épuisant en somme. Il avait fait des choses plus difficiles et plus dures dans d’autres pays. Les ingénieurs du gouvernement n’avaient pas encore achevé la digue et ils n’étaient à l’œuvre, Robledo et lui, que pour gagner du temps.
Sans l’eau du fleuve les canaux seraient inutiles. Ils s’étaient mis en marche et insensiblement ils prirent le chemin du campement. Richard allait à pied, une main appuyée sur le cou du cheval, les yeux levés sur Celinda qui lui parlait. Les ouvriers, leur travail terminé, rassemblaient leurs outils. Tous deux voulaient éviter de rencontrer les groupes qui revenaient au village; ils avancèrent donc, en s’écartant du fleuve, vers la région où le terrain commençait à s’élever pour former le penchant du plateau des pampas.
Ils gravirent un des contreforts de cette muraille qui s’étendait à perte de vue et contemplèrent à{81} leurs pieds l’ensemble de l’ancien campement devenu village et le vaste lac que formait le fleuve devant l’étranglement où la digue allait être lancée.
Le campement était une agglomération d’habitations construites sans ordre aucun: cabanes d’argile recouvertes de chaume, maisons de briques aux toits faits de branchages et de zinc, tentes de toile. Les constructions les plus confortables étaient des baraques démontables en bois où logeaient les ingénieurs, les contremaîtres, les employés.
Au-dessus de tous les bâtiments s’élevait une maison de bois montée sur pilotis et entourée sur ses quatre côtés d’une galerie extérieure: c’était le bungalow que l’Italien Pirovani, entrepreneur des travaux de la digue, avait commandé et s’était fait livrer au port de Bahia-Blanca quelques semaines auparavant.
Dès que tombait la nuit, les rues de ce village improvisé, désertes pendant la journée, s’emplissaient instantanément de la foule disparate des ouvriers. Les groupes qui revenaient de leurs divers chantiers se rencontraient, se confondaient et prenaient tous la même direction.
Une maison de bois, la seule qui par ses dimensions pouvait soutenir la comparaison avec la villa de l’entrepreneur, attirait tous les oisifs. Sur la porte, une pancarte portait ces mots en lettres calligraphiées: «Magasin du Gallego». Ce Gallego (Galicien) était en réalité un Andalou, mais tous les Espagnols qui viennent en Argentine deviennent obligatoirement des Galiciens[10].
C’était un débit de boissons en même temps{82} qu’une boutique où l’on trouvait les comestibles et les articles de luxe les plus divers. Le propriétaire se fâchait quand on appelait boutique ce qu’il appelait fièrement magasin, mais tout le monde au village continuait à désigner l’établissement par le nom modeste qu’on lui avait décerné le jour de sa fondation.
Un groupe de clients fidèles occupait de droit les abords du comptoir. Les uns étaient des émigrants européens qui avaient roulé par les trois Amériques, du Canada à la Terre de Feu. Les autres étaient des blancs ou des métis retournés à l’état primitif après de longues années de vie au désert: hommes au profil aquilin, à la grande barbe, aux cheveux longs, coiffés de larges feutres; ils portaient des ceinturons de cuir ornés de pièces d’argent où ils ne cachaient qu’à demi leur revolver et leur couteau.
Dehors, devant le cabaret baptisé «magasin», on pouvait voir les beautés les plus remarquables de la Presa, des métisses à la peau couleur de cannelle, aux yeux de braise, aux cheveux raides, noirs comme l’encre, aux dents d’une blancheur éclatante.
Certaines étaient énormes; les autres, extraordinairement maigres, semblaient sortir d’une ville assiégée, ou dévorées intérieurement par une flamme.
Elles attendaient leurs maris pour les empêcher de boire trop abondamment ou guettaient un compagnon pour la nuit.
Des lumières qui commençaient à briller dans les maisons piquaient de leurs points rouges la gaze violette du crépuscule.
Celinda et son compagnon contemplaient le village et le fleuve en silence comme dans la crainte que leur voix ne troublât le calme mélancolique du couchant.{83}
—Partez, mademoiselle Rojas, dit brusquement Richard, pour rompre le charme de l’heure, la nuit s’avance et votre estancia est loin.
Celinda ne croyait pas au danger. Ni les hommes ni la nuit ne lui faisaient peur; cependant, elle prit congé de Watson et mit son cheval au galop. Richard suivit, pour entrer dans la Presa, un espace découvert que les habitants considéraient comme la rue principale; dans cette agglomération récente, du reste, toutes les rues étaient principales par leurs vastes dimensions.
Avec prévoyance, le gouvernement de Buenos-Ayres avait décrété que dans les villages nouveaux surgis au désert les rues seraient larges d’au moins vingt mètres.
Qui pouvait savoir s’ils ne deviendraient pas un jour de grandes villes!... En attendant, les demeures basses, à un seul étage, restaient séparées de celles qui leur faisaient face par une étendue énorme que les ouragans glacials balayaient sans rencontrer d’obstacles ou que les colonnes de poussière recouvraient d’un épais nuage. Parfois le soleil brûlait la terre et faisait lever sous les pieds du passant des nuées bourdonnantes de mouches; d’autres fois les flaques laissées par les rares pluies obligeaient les habitants à marcher dans l’eau jusqu’au genou pour aller voir le voisin d’en face.
En avançant entre les deux rangées de maisons, Watson rencontra les principaux personnages de l’endroit. Il aperçut d’abord M. de Canterac, un Français, ancien capitaine d’artillerie, qui, à en croire certaines gens qui se disaient ses amis, avait dû abandonner sa patrie à la suite d’affaires d’ordre privé. Il était ingénieur au service du gouvernement argentin qui le chargeait de travaux lointains et pénibles que ses collègues du pays répugnaient à entreprendre. C’était un homme de quarante ans, mai{84}gre, les cheveux et la moustache grisonnants, l’aspect assez jeune cependant.
Il marchait d’un air martial, comme s’il portait encore l’uniforme, et ne négligeait pas, en plein désert, l’élégance de sa mise.
Canterac était entré à cheval dans la rue dite principale, vêtu d’un élégant costume d’écuyer, la tête couverte d’un casque blanc. Il aperçut Watson, et mit pied à terre pour marcher à côté de lui en tenant son cheval par la bride; il examina les plans que rapportait l’Américain.
—Et Robledo, quand revient-il? demanda-t-il.
—Je pense qu’il va arriver d’un moment à l’autre. Peut-être même a-t-il débarqué aujourd’hui à Buenos-Ayres. Il amène avec lui des amis.
Le Français, tout en marchant, continua à examiner les dessins du jeune homme, jusqu’au niveau de sa propre demeure, une petite maison de bois. Il jeta les rênes à son domestique métis avec une brusquerie toute militaire et dit à Ricardo, avant d’entrer chez lui:
—Je crois que six mois suffiront pour terminer le premier barrage du fleuve, et vous pourrez, Robledo et vous, irriguer immédiatement une partie de vos terres.
Watson se dirigea vers sa baraque; mais à peine eut-il marché quelques pas qu’il dut faire halte pour répondre au salut d’un homme jeune encore, vêtu d’un costume de ville, et qui avait l’aspect particulier des employés de bureau. Il portait des lunettes rondes d’écaille et serrait sous son bras un grand nombre de cahiers et de feuilles volantes. Il semblait un de ces fonctionnaires laborieux mais routiniers et incapables d’initiative ou d’ambition, qui vivent satisfaits, définitivement accrochés à leur médiocre emploi.
Il s’appelait Timothée Moreno et était né en{85} Argentine de parents espagnols. Le ministre des Travaux publics l’avait envoyé représenter l’administration à la Presa et c’était lui qui était chargé de payer à l’entrepreneur Pirovani les sommes que l’Etat lui devait.
Après avoir salué Watson, il se frappa le front et fit mine de revenir sur ses pas tout en regardant ses papiers.
—J’ai oublié de laisser chez le capitaine Canterac le chèque sur Paris que je lui remets tous les mois.
Puis il haussa les épaules et continua de marcher près de l’Américain.
—Je le lui donnerai en rentrant chez moi. De toutes façons il n’y a pas de courrier avant après-demain.
Ils passèrent devant le bungalow habité par l’homme le plus riche du campement au moment où celui-ci sortait pour s’accouder sur la balustrade d’une des galeries. Il les reconnut et se hâta de descendre l’escalier de bois.
L’Italien Enrico Pirovani était arrivé comme simple ouvrier en Argentine dix ans auparavant et il passait déjà pour un des hommes les plus riches du territoire patagon, qui s’étend de Bahia-Blanca jusqu’à la frontière des Andes chiliennes.
Toutes les banques respectaient sa signature. Il n’avait pas plus de quarante ans. Son visage était rasé; il était grand et musculeux mais avec cette mollesse commençante des corps que la graisse menace d’envahir. Il avait l’aspect extérieur du travailleur manuel qui a fait fortune et ne peut empêcher une certaine rusticité de déceler son origine. Il portait de nombreuses bagues et une grosse chaîne de montre; ses costumes étaient toujours resplendissants.
Il serra la main des deux hommes et jeta un regard intéressé sur les papiers que portait Moreno.{86} L’entrepreneur et l’employé de bureau se réunissaient chaque semaine pour parler des travaux.
L’Italien voulut absolument inviter Richard à entrer chez lui pour boire un peu.
—Je suis veuf et je vis seul, mais j’essaie de donner à ma maison du «confort» comme à Buenos-Ayres. Entrez, vous la verrez. J’ai fait de nouvelles acquisitions. La dernière fois vous ne l’avez pas visitée entièrement.
Watson dut le suivre car il savait qu’il fâcherait l’entrepreneur s’il ne consentait pas à admirer une fois de plus sa maison. Ils gravirent les degrés de bois et pénétrèrent dans la salle à manger, aux meubles d’un style à la mode mais trop lourds et trop chargés.
Pirovani les leur montra avec fierté en frappant de petits coups sur le bois de chêne pour en faire ressortir les qualités, et, les yeux au plafond, il rappelait le prix qu’ils lui avaient coûté. Il leur fit voir encore un salon encombré de son mobilier au point qu’on était contraint à mille détours parmi tant de fauteuils et de petits guéridons. La chambre à coucher enfin était si décorée qu’on eût dit celle d’une femme galante.
Dans toutes les pièces, la somptuosité écrasante des meubles contrastait avec la pauvreté des cloisons tapissées de papier ordinaire.
—Ah! cela m’a coûté quelque chose! dit l’entrepreneur avec un orgueil enfantin. Mais voyons, don Ricardo, vous qui êtes un jeune homme de bonne famille et qui avez vu bien des choses, dites-moi si vous ne trouvez pas cela très chic?
Ils revinrent dans la salle à manger, et une petite servante métisse, sa longue tresse dans le dos, mit sur la table des bouteilles et des verres.
—J’ai décidé, continua l’Italien, de prendre une «gouvernante»; ce sera Sébastienne, celle qui ser{87}vait à l’estancia de Rojas. Il faut pour diriger cette maison une femme de tête.
Watson ne voulut pas accepter un second verre. Il devait partir pour permettre aux deux hommes de parler des travaux entrepris au compte de l’Etat.
Quand il quitta la maison, il faisait nuit noire, et toute la vie de l’ancien campement semblait s’être concentrée dans le cabaret dont l’éclairage, le plus brillant du village, projetait sur le sol, par la double porte, deux rectangles de lumière rouge.
Les clients les plus respectables buvaient debout, devant le comptoir. Un Espagnol jouait de l’accordéon; d’autres ouvriers européens dansaient avec les métisses des valses et des polkas. Beaucoup de Chiliens, qui avaient dû passer la Cordillère et s’en iraient plus loin encore après quelques jours de travail, poussés par leur éternelle manie de mouvement. Ces gens-là tiraient leur couteau avec une facilité inquiétante, sans pour cela cesser de sourire et de parler d’un ton mielleux. Un autre groupe, celui des hommes du pays; nul ne savait de quoi ils vivaient ni où ils étaient nés, ces cavaliers nomades, barbus, couverts du poncho et de grands éperons à leurs bottes.
A l’instar des anciens gauchos ils portaient un large ceinturon de cuir, orné de pièces d’argent en arabesques, où ils passaient leurs armes.
Tous ces Américains toléraient avec un silence méprisant que l’accordéon jouât ses danses de «gallegos» ou de «gringos»; mais enfin l’un d’eux réclamait à grands cris les danses du pays. Comme cette demande était faite d’un ton de menace les couples enlacés à la mode européenne s’empressaient de se retirer. Alors les fils de la terre mimaient parfois les vieilles danses argentines, le pericon ou le gato; mais plus souvent c’était la cueca chilienne avec son accompagnement de cris{88} et d’applaudissements rythmés qui enflammait d’enthousiasme les clients du cabaret.
Le patron de l’établissement prêtait deux guitares qu’il gardait jalousement sous le comptoir. Les guitaristes faisaient mine de s’asseoir par terre, mais aussitôt une métisse courait leur offrir deux sièges d’honneur qui étaient deux crânes de chevaux.
C’étaient les meilleurs sièges de la maison. Il y avait en outre une ou deux chaises, mais disjointes et peu sûres; on les utilisait les jours de visite du commissaire de police ou de quelque autre représentant de l’autorité. Les squelettes abandonnés dans la campagne fournissaient des sièges plus solides et plus durables.
Au son des guitares les couples se formaient pour la danse chilienne. Les danseuses, tenant dans une main un mouchoir et de l’autre soulevant légèrement leurs jupes, tournaient avec lenteur tandis que les hommes, brandissant de la main droite des mouchoirs de couleur comme des frondes, dansaient à leur entour. C’était la danse des époques primitives qui reproduisait l’éternelle histoire du mâle poursuivant la femelle. Les femmes décrivaient de petits cercles pour esquiver l’homme, et celui-ci les pressait et les enveloppait dans des orbes plus larges.
Les métisses qui ne figuraient pas dans le bal frappaient dans leurs mains inlassablement pour accompagner le bourdonnement des guitares. Parfois l’une d’elles lançait un couplet de la cueca; alors les hommes poussaient des clameurs de joie et lançaient en l’air leurs chapeaux.
Un cavalier mit pied à terre devant le cabaret et attacha son cheval à un des poteaux de l’auvent. Il entra, et quand la lumière rouge des quinquets suspendus au plafond vint frapper son visage, presque tous le saluèrent avec respect.{89}
Il portait le poncho et les grands éperons des cavaliers du pays. Son profil aquilin et son teint foncé le rapprochaient du pur type arabe. Sa barbe et ses cheveux étaient longs et bouclés. Cet homme, qui ne semblait pas avoir plus de trente ans, pouvait passer pour beau; mais on surprenait parfois sur son visage une contraction déplaisante et ses grands yeux sombres brillaient, impérieux et cruels. Son surnom, «Manos Duras[11]», était célèbre dans le pays. C’était un voisin inquiétant car il vivait de la vente des bestiaux sans que personne eût jamais pu savoir où il effectuait ses achats.
Quelques anciens n’ignoraient pas son origine et déclaraient qu’il était né dans la Pampa centrale. Ses parents, ses grands-parents et toute sa famille étaient d’excellentes gens, des pâtres légitimes qui vivaient de l’élevage de leurs propres animaux. Mais Manos Duras était né pour être un pâtre marron, voleur de bétail et matamore.
Son honnête homme de père lui avait prodigué les bons conseils et les nobles exemples.
Un vieux client du cabaret constatait avec une gravité philosophique l’inutilité de ses efforts en citant un proverbe du pays:
«Al que nace barrigon, es en balde que lo fajen.» (Celui qui est né ventru, c’est en vain qu’on lui ceint la panse.) Le patron, en le voyant entrer, courut lui offrir un verre de gin tandis que les gauchos à la mine la plus sinistre portaient une main à leur chapeau pour saluer celui qui semblait être leur chef. Les ouvriers européens le regardaient avec curiosité en demandant son nom et les métisses vinrent au-devant de lui avec des sourires d’esclaves.
Manos Duras reçut avec une certaine hauteur cet accueil flatteur. Une des femmes se hâta d’aller{90} chercher pour lui un autre siège d’honneur, un autre crâne de cheval. Le terrible gaucho s’y installa tandis qu’autour de lui le reste des clients demeuraient assis sur le sol; la cueca, un instant interrompue par son entrée, reprit et ne s’arrêta pas à l’arrivée d’un autre personnage que le Gallego reçut derrière son comptoir avec de profondes révérences.
C’était don Roque, le commissaire de police de la Presa, seul représentant de l’autorité gouvernementale dans le village et ses environs. Le gouverneur du territoire de Rio Negro habitait au bord de l’Atlantique une agglomération où l’on ne parvenait qu’après un voyage à cheval de douze jours, c’est-à-dire six fois plus de temps qu’il n’en fallait pour aller à Buenos-Ayres en chemin de fer.
Aussi le commissaire jouissait-il de l’indépendance la plus complète, celle que confère l’oubli. Le gouverneur était bien trop loin pour lui donner des ordres. Son chef le plus immédiat était le ministre de l’Intérieur résidant à Buenos-Ayres, mais il était trop haut placé pour se soucier de son existence. En réalité, don Roque n’abusait pas de son pouvoir, et d’ailleurs il n’eût pas disposé de moyens suffisants pour le faire sentir bien lourdement. C’était un gros homme indulgent et d’un abord aisé; un bourgeois de Buenos-Ayres qui, ayant éprouvé des revers, avait demandé un emploi pour vivre et s’était résigné à l’exil de Patagonie.
Il portait avec son costume de ville des bottes et un grand chapeau et croyait ainsi se donner l’apparence qu’exigeait son emploi. Un revolver qu’il plaçait bien en vue par-dessus son gilet était le seul insigne de son autorité.
L’Espagnol se dessaisit de la meilleure chaise de l’établissement, qu’il gardait derrière son comptoir pour les visites extraordinaires, et le commissaire{91} alla se placer à côté de Manos Duras. Celui-ci ôta son chapeau pour le saluer, mais n’abandonna pas le crâne qui lui servait de siège.
Les deux hommes causèrent; le bal continuait. Don Roque se mit à fumer un cigare que le gaucho lui avait offert avec un geste de grand seigneur.
—On affirme, dit-il à voix basse, que c’est toi qui a volé la semaine dernière trois jeunes taureaux à l’estancia du Pozo Verde. L’endroit n’est pas de mon ressort, c’est dans le Rio Colorado; mais mon collègue, le commissaire de là-bas, te soupçonne d’être le voleur.
Manos Duras continua de fumer en silence, cracha, et dit enfin:
—Ce sont des calomnies de ceux qui voudraient m’ôter la fourniture de la viande du campement de la Presa.
—On a dit aussi au gouverneur du territoire que tu étais l’assassin des deux marchands turcs tués il y a quelques mois.
Le gaucho haussa les épaules et répondit froidement comme pour clore la conversation:
—On m’a accusé de tant de crimes, sans jamais apporter aucune preuve!
Le bal continua jusqu’à dix heures du soir au «magasin du Gallego». Dans les grandes cités ce sont les premières lueurs du jour qui mettent fin aux fêtes, mais dans ce pays où tout le monde se levait à l’aube, cette heure-là était jugée fort tardive.
A cette heure, les plus importants personnages du campement ne dormaient pas non plus. Ils tenaient une plume à la main et leur pensée était loin.
L’ingénieur Canterac, le coude sur la table, les yeux mi-clos, croyait voir le lointain Paris et dans Paris une maison proche du Champ-de-Mars où habitait au cinquième étage sa femme avec ses{92} enfants; une dame à la physionomie triste, aux cheveux blanchis, au visage encore frais. A ses côtés, deux fillettes. Devant elle un jeune garçon de quatorze ans, son fils aîné, qui l’écoutait parler... Et la mère leur montrait sur le canapé du modeste salon un portrait de Canterac jeune, en uniforme militaire.
Les meubles de l’appartement, leurs vêtements à eux tous portaient la marque d’une existence modeste, mais ordonnée, digne et non exempte de distinction.
L’ingénieur, troublé par ces visions qu’il avait appelées, fit un effort pour s’arracher à leur emprise et continua la lettre commencée.
«Oui, bientôt je vous reverrai. Les dettes d’honneur qui m’ont forcé à quitter Paris seront bientôt payées, grâce à toi ma courageuse compagne de toute la vie, à toi qui as su si bien employer les économies que je t’ai envoyées. Comme je voudrais te serrer dans mes bras et te dire encore une fois tout mon amour et toute ma reconnaissance! Et comme il me tarde de revoir nos enfants après une si longue séparation!»
L’ingénieur s’arrêta et demeura la main immobile, la plume levée. Il n’avait plus sa raideur impassible d’homme autoritaire. L’émotion faisait monter les larmes à ses yeux qu’il essuyait de la main. Il fit encore un effort pour concentrer sa volonté et termina sa lettre:
«Adieu, ma femme chérie; adieu, mes enfants. J’écrirai au prochain courrier.
«ROGER CANTERAC.»
Avant de plier le papier il ajouta un post-scrip{93}tum: «Ci-joint le chèque du mois. Le prochain sera plus important que tous ceux que tu as reçus car je compte toucher en plus de mon traitement des honoraires en retard que me doivent des particuliers pour qui j’ai effectué divers travaux pendant ces dernières années.»
Pirovani lui aussi était dans son bureau, à la même heure, la plume à la main et ses yeux vagues semblaient contempler intérieurement une vision idéale.
Sa pensée le conduisait en Italie vers un petit collège où se trouvait sa fille unique. C’était un collège de religieuses, et la plupart des élèves portaient un nom aristocratique, ce qui satisfaisait grandement la vanité puérile de l’entrepreneur.
Le sourire qu’il adressait à cette vision semblait ennoblir son visage. Il avança les lèvres comme pour envoyer un baiser à sa fille par-dessus trois mille lieues de terres et de mers. Puis il continua d’écrire:
«Travaille bien, mon Ida; apprends tout ce que doit savoir une dame du grand monde puisque ton père, après tant de privations et tant de peines, a pu rassembler une fortune qui lui permet de te faire une bonne éducation. J’ai été moins heureux que toi car je suis né pauvre et j’ai dû m’ouvrir un chemin dans le monde, tout seul et traînant après moi le poids de mon ignorance. Pour ne pas te causer d’ennuis je n’ai pas voulu me remarier... Que ne ferai-je pas pour toi mon Ida! L’année prochaine je pense arrêter mes affaires et quitter l’Amérique pour regagner notre patrie; j’achèterai un château dont tu seras la reine et peut-être quelque officier de cavalerie au nom illustre tombera-t-il amoureux de toi... Alors ton pauvre vieux papa sera jaloux... bien jaloux.»
Un sourire plein de bonté élargissait le visage de Pirovani tandis qu’il écrivait ces derniers mots.
La pensée de Moreno l’Argentin ne s’élançait pas aussi loin.
Il écrivait à la lueur d’une lampe à pétrole dans la baraque de bois où son bureau était installé; mais son imagination suivait la voie ferrée et s’arrêtait à deux journées de marche, dans un village voisin de Buenos-Ayres.
Il contemplait lui aussi une vision familière quand il levait un moment la tête pour quitter ses lunettes et les essuyer. Sa femme jeune, au visage très doux, tenait sur ses genoux un bébé en maillot; autour d’elle, deux petits garçons et une fillette un peu plus âgée, aucun des enfants cependant n’avait plus de sept ans. Le modeste logement était d’un aspect aimable et frais. Cette mère de famille, tout en soignant ses rejetons, devait se soucier de tenir sa maison en ordre.
«A toute heure je pense à toi et aux enfants. Si j’écoutais mon cœur je vous ferais venir tous à Rio Negro; mais nos petits souffriraient trop peut-être dans ce désert. La vie que je mène ici n’est pas faite pour des enfants, ni pour toi, vaillante compagne de ma vie.»
Moreno contempla sur la table la photographie de sa femme et de ses quatre enfants puis il l’embrassa avec attendrissement et se remit à écrire:
«Heureusement, je suis assez bien noté pour mon application au ministère et j’espère être nommé à Buenos-Ayres avant un an. Le mois prochain je demanderai un congé pour venir vous voir. Le voyage est cher mais je ne puis supporter plus longtemps cette douloureuse absence.»
Richard Watson n’écrivait aucune lettre mais il rêvait tout éveillé comme les autres.
Assis devant une planche à dessin sur laquelle il avait fixé une grande feuille de papier, il ébauchait le tracé d’un canal. Mais peu à peu le dessin se troubla et céda la place à une image réelle et proche. Les lignes bleues et rouges devinrent un fleuve bordé de saules, des terres désertes, des routes poudreuses.
Ce paysage lilliputien reproduisait exactement le pays qui entourait la Presa, mais l’échelle était si réduite qu’il tenait tout entier dans la planche. A travers la plaine minuscule il vit soudain galoper un cavalier gros comme une mouche qui bondissait avec une agilité joyeuse: c’était la señorita Rojas, habillée en garçon, qui brandissait son lasso au-dessus de sa tête.
Watson porta une main à ses yeux et se les frotta pour mieux voir. Mirages de la nuit!
Il passa ses doigts sur le papier comme pour effacer le panorama trompeur et le tracé des canaux reparut en lignes rouges et bleues.
Le jeune homme se plongea de nouveau dans son monotone travail de dessin linéaire; mais un moment après il leva les yeux de son papier. Il croyait cette fois voir Celinda à cheval, au fond de la pièce; mais ce n’était plus l’amazone pygmée de tout à l’heure; elle avait repris sa taille naturelle.
La jeune fille lui lança de loin son lasso, et se mit à rire de ce rire qui découvrait ses dents; machinalement, l’Américain baissa la tête pour esquiver la corde prête à l’emprisonner.
«Je rêve, pensa-t-il. Ce soir il m’est impossible de travailler. Allons nous coucher.»
Mais avant de s’endormir il revit le village entier tel qu’il l’avait contemplé avec Celinda du haut d’une colline, au coucher du soleil.{96}
La terre se noyait maintenant dans la nuit et sur le rideau bleu de l’horizon criblé de lumières, il crut voir surgir et s’agrandir une apparition immense, une femme grave et belle, couronnée d’étoiles et vêtue d’une tunique noire brodée d’astres, qui ouvrait ses bras de géante et coupait dans les jardins infinis les fleurs des rêves pour les verser en pluie de pétales phosphorescents sur le monde endormi.
C’était la nuit qui venait, miséricordieuse, évoquer pour chacun des hommes exilés en ce coin de terre tous les êtres chéris.
Comme Richard Watson était seul au monde, la nuit cueillait pour lui la fleur la plus printanière... et avant de fermer les yeux, le jeune homme connut la douce mélancolie qui toujours accompagne le premier amour.{97}
Dans la rue qu’on appelait rue principale, un groupe d’enfants s’arrêta de jouer et s’étonna bruyamment en apercevant l’aspect insolite de la voiture qui trois fois par semaine partait de la Presa pour aller attendre le train à «Fort-Sarmiento».
On retrouvait, dans ce petit groupe d’enfants, la diversité des races qui marquait toute la population du village. Les enfants des blancs se perdaient dans de vieux pantalons de leurs pères et leurs pieds dansaient dans des chaussures trop larges. Les petits indigènes ne portaient qu’une courte chemise ou s’en allaient, laissant à l’air leur panse rebondie où, sur la peau couleur chocolat, on voyait saillir le large bouton de leur ombilic.
Les voyageurs que tous ces enfants voyaient descendre à la Presa n’avaient ordinairement d’autre bagage que le sac de grosse toile où ils serraient leurs hardes; aussi restaient-ils stupéfaits devant la quantité de malles et de valises qui, ce jour-là, surchargeaient la voiture, vieille diligence tirée par quatre chevaux étiques souillés de boue.{98}
Une grande partie des bagages s’entassait sur le toit du véhicule qui, dans sa course grinçante, parmi les profondes ornières creusées dans la poussière du chemin, s’inclinait avec un balancement comique et inquiétant, comme s’il eût toujours été sur le point de verser.
A la porte du cabaret les désœuvrés s’assemblèrent pour admirer. La voiture s’arrêta devant la maison de bois habitée par Watson et celui-ci sortit, entouré de ses domestiques.
Hommes et femmes accoururent et s’exclamèrent, en voyant descendre l’ingénieur Robledo. On s’avançait, on lui serrait la main avec cette camaraderie confiante que crée la vie au désert. Puis tous semblèrent oublier l’Espagnol pour contempler curieusement les inconnus qu’apportait la diligence.
Le marquis de Torrebianca, descendu le premier, offrit la main à sa femme. La marquise portait un riche manteau de voyage dont l’originalité n’était pas de mise en ce lieu; elle paraissait maussade avec le masque dur de ses mauvais jours. Elle regardait, de côté et d’autre, étonnée puis déçue; malgré l’ample voile qui protégeait son visage, la poussière rougeâtre du chemin avait couvert ses traits et sa chevelure; ses yeux exprimaient un désespoir immense et tout en elle semblait crier: «Où suis-je venue me perdre!»
—Nous arrivons, dit joyeusement Robledo. Deux jours et deux nuits de chemin de fer pour venir de Buenos-Ayres et quelques heures en voiture à travers les tourbillons de poussière, c’est peu de chose! Le bout du monde est encore loin!
Quelques-uns des hommes qui avaient serré la main à Robledo se mirent spontanément à décharger les valises amoncelées sur le toit et à l’intérieur de la diligence.{99}
Une femme de chambre de la marquise avait envoyé de Paris à Barcelone ces colis, tout ce que les Torrebianca avaient pu sauver après leur grand naufrage.
Autour d’Hélène se formait un cercle d’enfants et de pauvres femmes, métisses pour la plupart; tous contemplaient avec admiration cet être tombé sans doute d’une autre planète sur la terre. Des fillettes touchaient furtivement ses habits pour juger la finesse de l’étoffe.
Les principaux personnages de l’agglomération arrivaient aussi; l’Espagnol présenta ses amis Canterac, Pirovani et Moreno. Watson, voyant que les hommes portaient les bagages dans sa baraque, s’approcha vivement de Robledo.
—Mais... cette dame si élégante va habiter avec nous?
—Cette dame, répondit l’Espagnol, est la femme d’un ami qui vient partager notre sort. Nous n’allons certes pas construire un palais pour elle.
La nouvelle venue ne put cacher son découragement quand elle eut traversé les différentes pièces de la maison des deux ingénieurs, sa maison désormais. Des cloisons en bois, quelques meubles grossiers encombrés de selles, d’appareils de topographie, de sacs à vivres. Tout était en désordre et sale dans cette demeure où vivaient deux hommes que leur travail appelait au dehors à toute heure.
Torrebianca souriait, humble et poli, en écoutant les explications de son ami: «Tout était très bien et il était très reconnaissant.»
—Voici les serviteurs, dit Robledo.
Il montra une vieille métisse fort grosse, la principale servante, puis deux jeunes métis aux pieds nus qui faisaient les courses et un Espagnol taciturne qui soignait les chevaux. Tous ces gens, ordinairement farouches, admiraient la belle dame{100} avec d’interminables sourires; Hélène finit par rire aussi, nerveusement, en pensant aux domestiques qu’elle avait laissés à Paris.
Après le repas, Robledo, qui voulait être informé de la marche des travaux, emmena son associé et se fit montrer les plans et les papiers divers concernant l’entreprise.
—Avant six mois, dit Watson, nous pourrons irriguer nos terres, Canterac l’affirme, et cette plaine stérile disparaîtra.
Robledo laissa voir sa joie.
—Un véritable paradis surgira, grâce à notre travail, de ces terres où ne poussent maintenant que des broussailles. Des milliers d’êtres viendront chercher ici une existence plus heureuse que celle qu’ils mènent dans l’ancien monde. Quant à nous, mon cher Ricardo, nous serons immensément riches tout en faisant le bien. Oui, la vie est ainsi! Pour qu’un progrès se réalise, il faut d’abord qu’un homme, égoïstement, s’enrichisse par lui.
Tous deux se turent, le regard vague; leur imagination leur montrait l’aspect futur des terres stériles après quelques années d’irrigation. Ils virent des champs éternellement verts, des canaux pleins de murmures où l’eau semblait rire, des chemins bordés de grands arbres, de petites maisons blanches... Watson pensait aux vergers de Californie, et Robledo à la huerta[12] de Valence.
Le premier, l’Américain revint à la réalité; sans parler, il montra la pièce voisine où s’étaient installés les voyageurs.
Torrebianca sommeillait dans un fauteuil de toile. Sa femme, assise dans un autre fauteuil, le front dans les mains, gardait une attitude tragique. Tou{101}jours elle se posait désespérément la même question: «Où suis-je venue me perdre!».
A Buenos-Ayres, son exil lui avait semblé supportable. C’était une grande ville à l’européenne; il y fallait rechercher longuement les derniers vestiges de la vie coloniale, pour se convaincre qu’on était en Amérique. Elle s’étonnait seulement d’être descendue dans un hôtel modeste, de n’avoir pas d’automobile à sa porte; mais aucune secousse n’avait troublé son existence. Tandis que ce voyage par les plaines interminables où le train file des heures et des heures sans rencontrer ni un être vivant, ni une maison, où le vide semble régner en maître à la surface du monde; l’arrivée enfin dans ce pays perdu où les roues des voitures et les pieds des voyageurs soulèvent des nuages de poussière, où la terre qui flotte dans l’air obstrue les poumons, où tous les gens ont des airs d’abandonnés et vous traitent cependant en camarades, comme si à force de vivre loin des autres agglomérations humaines ils avaient fini par se croire vos égaux!
Hélas! «où était-elle venue se perdre»!
Robledo devinant la pensée de Watson répondit à son interrogation muette.
—Mon ami travaillera avec nous comme ingénieur; ne vous inquiétez pas de lui. Il aura une part dans nos affaires, mais je la prendrai sur ce qui me revient.
Le jeune homme écouta le prudent récit que Robledo lui fit des malheurs des Torrebianca, puis il se borna à dire:
—Puisque votre ami vient travailler avec nous, j’exige que sa part soit prise sur ce qui nous revient à nous deux. Il me paraît être un excellent homme et je suis prêt à l’aider. Sa femme aussi me fait pitié.
Robledo, reconnaissant, serra la main du géné{102}reux Watson, et il ne parlèrent plus de cette question.
Le lendemain matin, Hélène, qui savait assez bien s’adapter aux vicissitudes de l’existence, fit preuve d’activité et d’initiative.
Quelques semaines auparavant, elle cherchait à briller dans les salons; elle voulait maintenant faire admirer à ces hommes ses talents domestiques. Vêtue d’un costume tailleur, qu’elle avait cessé de porter à Paris et qui était ici un modèle d’élégance, elle entreprit, les mains gantées, d’introduire dans la maison l’ordre et la propreté; elle commandait la grosse métisse et ses deux acolytes; mais lorsqu’elle essayait de prêcher d’exemple, sa maladresse devenait évidente. Parfois elle hésitait, ne savait plus diriger l’exécution de ses ordres et la métisse devait intervenir pour la tirer d’affaire.
La grande lampe qui servait à cuire les aliments utilisait la même essence que les moteurs des perforatrices. Hélène, encouragée par la facilité d’emploi de ce fourneau, voulut s’essayer aux travaux culinaires; elle dut bientôt reconnaître la supériorité de la servante à la peau cuivrée et prit enfin le parti de rire la première de son inaptitude aux travaux domestiques.
Pour faire quelque chose, elle quitta ses gants et commença de laver la vaisselle; elle les remit aussitôt, de peur que la fraîcheur de l’eau n’abîmât ses doigts fins et ses ongles brillants; aussi bien, lorsque le dégoût de sa nouvelle existence la jetait dans le désespoir, sa seule consolation était de contempler mélancoliquement ses mains.
Torrebianca, vêtu d’un costume de travail, entreprit avec Watson et Robledo la visite des canaux, se mit au courant des travaux tout en causant familièrement avec les ouvriers et observa le fonctionnement des machines perforatrices.{103}
En peu de temps, il fut souillé de poussière de la tête aux pieds; il ressentait une démangeaison douloureuse dans ses mains qui commençaient à s’endurcir, mais il connut aussi la joyeuse confiance de l’homme qui a trouvé enfin la certitude de gagner sa vie.
C’est à la nuit tombée que tous les jours les trois ingénieurs regagnaient leur demeure où la table était déjà mise. Dans les premiers temps, Hélène se plaignit de la grossièreté des assiettes et des couverts. La métisse acheta, sur son ordre, au magasin du Gallego, de menus objets bon marché, fabriqués à Buenos-Ayres.
Quelques plantes maigrement fleuries que les deux pages cuivrés cueillirent au bord du fleuve, donnèrent à la table un aspect plus riant. On commençait à sentir dans la maison la présence d’une femme élégante et belle.
Un soir, au moment où la cuisinière apportait le premier plat, Hélène laissa glisser de ses épaules une sortie de théâtre un peu usée qui lui servait de robe de chambre et apparut, décolletée, dans une toilette de cérémonie légèrement fanée, mais encore fort brillante, vestige de sa splendeur passée.
Watson la regarda avec stupéfaction; derrière elle, Robledo porta un doigt à son front, pour indiquer qu’il la croyait un peu folle.
Le marquis resta impassible, comme si aucun des actes de sa femme ne pouvait plus l’étonner.
—J’ai toujours dîné en décolleté, dit Hélène, et je ne vois pas pourquoi je changerais ici mes habitudes. Ce serait pour moi un vrai supplice.
Après le repas on causait longuement, on écoutait surtout Robledo; l’Espagnol parlait volontiers des hommes intéressants qu’il avait vu défiler dans cette «terre de tous». Beaucoup avaient parcouru{104} le monde entier avant d’arriver en Patagonie; d’autres venaient à peine de quitter l’Europe pour tenter l’aventure et se bâtir une existence nouvelle.
En débarquant à Buenos-Ayres, ils trouvaient devant eux les mêmes obstacles qu’ils avaient voulu fuir en abandonnant leur pays; la grande cité était déjà trop vieille pour eux et les pauvres y grouillaient dans les taudis des conventillos[13]; on n’y gagnait pas mieux sa vie qu’en Europe et parfois même on trouvait plus difficilement du travail que dans l’ancien continent, car de toutes parts les gens de même profession affluaient à la fois...
Alors ils se dispersaient et gagnaient les régions les plus lointaines de la République, ils envahissaient les territoires encore déserts où de grands travaux préparait les immigrations futures.
—Quelles curieuses gens j’ai vu passer par ici en ces quelques années! disait Robledo. Je fus intéressé un jour par un travailleur qui avait le nez rouge des alcooliques, mais dont la personne avait conservé un je ne sais quoi qui laissait supposer un passé intéressant. C’était une ruine humaine; mais semblable aux palais détruits dont un fragment de statue, un chapiteau découvert dans les décombres permettent d’imaginer l’histoire, cet homme, qui volait ses camarades et roulait parfois ivre mort sur le sol, conservait toujours dans sa déchéance des gestes et des expressions qui laissaient deviner son origine. Un jour, je le vis s’amuser à peigner un de nos contremaîtres et à lui relever les moustaches en pointe à la manière du kaiser Guillaume. Je lui fis boire tout ce qu’il voulut; c’est le plus sûr moyen de faire parler ces gens-là; il parla en effet. Cet ivrogne prématurément vieilli{105} était un baron de Berlin, ancien capitaine de la garde impériale, qui avait perdu au jeu d’importantes sommes à lui confiées par des supérieurs. Au lieu de se tuer comme l’exigeait sa famille, il partit pour l’Amérique et il tomba de plus en plus bas. Il devint général, mais il finit ouvrier ivrogne et paresseux.
Voyant que ce personnage intéressait Hélène, Robledo continua modestement:
—Il fut général pendant une des révolutions du Vénézuela. J’ai été moi aussi général dans une autre république; j’ai même été pendant vingt jours ministre de la guerre; mais on m’a mis à la porte. On me trouvait trop «scientifique» et je ne savais pas manier le machete[14] aussi bien que mes subalternes.
Ensuite, il parla d’un autre ivrogne silencieux et triste qui était venu mourir à la Presa et dont on voyait la tombe au bord du fleuve. Robledo avait trouvé des papiers intéressants au fond du sac de ce pouilleux vagabond.
Dans sa jeunesse il avait été un des grands architectes de Vienne. Il avait trouvé aussi une ancienne photographie représentant une dame à la coiffure romantique; elle était parée de longs pendants d’oreille et ressemblait à l’impératrice d’Autriche qui fut assassinée. C’était sa femme, morte à Khartoum, massacrée par les hordes fanatiques du Madhi, pendant que son mari marchait sous les ordres du général Gordon. Une autre photographie représentait un bel officier autrichien en redingote blanche très serrée à la taille; c’était le fils de ce mendiant.
—Il serait inutile—continua Robledo—de{106} vouloir relever ces vagabonds. On les nettoie, on leur offre une vie meilleure, on les sermonne pour les empêcher de boire et leur permettre de recouvrer leurs facultés d’hommes intelligents. Les voilà dans le droit chemin; on les croit heureux; puis, un beau matin, on les voit arriver le sac au dos: «Je m’en vais, patron, réglez-moi». N’essayez pas de les questionner. Ils sont contents, ils ne se plaignent pas, mais ils s’en vont. A peine ont-ils retrouvé le calme, le démon qui les entraîne par le monde les ressaisit. Ils savent que là-bas, derrière l’horizon, se dressent les Andes, que derrière les Andes, s’étendent le Chili, le Pacifique immense semé d’îles et plus loin encore les pays enchanteurs du continent asiatique... leur manie de mouvement se réveille et les travaille:
«Allons voir par là-bas.» Ils jettent leur sac sur leur dos, et marchent vers la misère et la faim, pour s’en aller mourir dans un hôpital ou dans la solitude d’un désert... S’ils ne meurent pas, s’ils ont pu continuer à poursuivre l’illusion qui fuit en voltigeant devant eux, on les voit revenir par ici; mais c’est après avoir fait le tour de la terre.
Quelquefois les deux ingénieurs parlaient de leur propre existence. Watson avait peu de choses à dire. Elevé en Californie, il avait débuté comme ingénieur dans les mines d’argent du Mexique; il y avait appris l’espagnol, puis il était passé aux mines du Pérou. Enfin, il était venu à Buenos-Ayres, y avait connu Robledo et s’était associé avec lui pour entreprendre les travaux du Rio Negro.
L’Espagnol ne rappelait pas volontiers la période de sa vie qui avait précédé son arrivée en Argentine. Le besoin d’agir l’avait poussé à prendre part à des révolutions pour lesquelles il n’avait que mépris. Il avait entrepris des affaires prodigieuses; les gouvernements et ses compagnons l’avaient trompé et{107} volé; de durs retours de fortune l’avaient précipité de l’opulence la plus folle dans la misère des vagabonds. Mais il évitait de raconter ses aventures dans d’autres pays; il ne parlait que de sa vie en Patagonie.
Il ne pouvait oublier les tortures que la soif lui avait fait endurer sur le plateau qui s’étend de la coupure du Rio Negro au détroit de Magellan. C’était au moment où, cessant de servir le gouvernement argentin, il était devenu ingénieur privé et s’était lancé dans ces déserts inexplorés, cherchant fortune.
Pour éviter des frais, il avait entrepris la traversée du désert avec un seul péon indigène et un peloton de six chevaux du pays qui tour à tour devaient porter les deux voyageurs. C’était des animaux résistants capables de se nourrir avec ce qu’ils trouvaient sur leur chemin.
Pour se guider, Robledo avait un plan, établi par d’autres explorateurs, où étaient portés les trous d’eau, seuls points où les voyageurs pouvaient faire halte.
Pendant les années précédentes, une grande sécheresse avait sévi. Ils arrivèrent à un puits et le trouvèrent plein d’eau salée. Il était habitué à l’eau saumâtre que, par un optimisme exagéré, les voyageurs du désert appellent eau potable; mais son estomac et celui du métis son compagnon, refusèrent d’admettre celle de ce puits-là. Ils continuèrent à marcher avec l’espoir d’être plus heureux au prochain trou d’eau. Cette fois, le puits ne contenait pas d’eau salée, il était complètement à sec... Ils avaient dû continuer leur marche en avant, à travers la plaine immense et monotone, en se guidant à la boussole; assoiffés comme des naufragés, ils marchaient haletants, et dans leurs yeux exorbités passaient des lueurs de folie.{108}
Par respect pour Hélène, Robledo ne faisait qu’une allusion voilée aux moyens que le métis et lui avaient dû employer pour ne pas périr; ils avaient bu leur urine et celle de leurs chevaux.
—Une idée fixe me tourmentait. J’essayais de me rappeler toutes les fois où j’avais refusé une invitation à boire; je pensais à tous ces liquides: bière, eau gazeuse, boissons glacées, que j’avais méprisées. Je me rappelais aussi comment dans toutes les fêtes auxquelles j’avais assisté, j’étais passé indifférent devant les grandes tables chargées de carafons et de bouteilles... Et l’esprit troublé par la fièvre, je me disais tout en marchant: «Si tu avais accepté alors tous les bocks de bière, toutes les eaux gazeuses, toutes les boissons glacées qu’on t’a offerts et que tu as dédaignés, tu aurais maintenant dans le corps une importante réserve de liquide qui te permettrait de supporter plus facilement la soif». Cet absurde calcul me torturait comme un remords et j’avais envie de me souffleter pour me punir de ma sottise.
Robledo racontait enfin comment, alors que les chevaux ne pouvaient plus avancer, ils avaient trouvé un puits d’eau saumâtre qui leur parut le plus délicieux liquide qu’ils eussent jamais bu... Arrivé au terme du voyage, il ne trouva rien. Les renseignements qui lui avaient fait espérer une affaire avantageuse étaient faux. C’est ainsi qu’il fallait lutter pour la fortune en Amérique, à une époque où, arrivant avec un demi-siècle de retard, on trouvait déjà occupées toutes les terres riches et facilement exploitables; il ne restait plus que des terrains lointains et ingrats où souvent la ruine et la mort guettaient le colon.
—Et cependant—continuait-il—les hommes ne cesseront pas d’accourir vers ce coin du monde. C’est là que pour eux réside l’espérance sans quoi{109} l’existence est un fardeau trop lourd... Tenez, passons en revue nos origines respectives: vous êtes Russe, Federico Italien, Watson Américain du Nord, moi Espagnol. D’où procèdent les gens qui nous arrivent tous les jours? Chacun d’une nation distincte. Je vous le dis, cette terre est la «terre de tous».
La maison des deux ingénieurs recevait chaque jour, après le dîner, la visite des plus importants personnages de l’agglomération. Canterac se présentait le premier, dans ses vêtements de coupe militaire: il apportait cependant plus de soins à sa mise depuis l’arrivée des Torrebianca. Moreno arrivait ensuite. Il se troublait toujours en saluant Hélène; sa langue s’embarrassait; il n’émettait, au lieu de paroles, que de vagues balbutiements. Pirovani venait enfin; il avait un costume neuf tous les deux jours et ne manquait pas d’apporter quelque présent pour la maîtresse de maison.
Canterac, riant sous cape, affirmait que l’Italien pour apparaître plus éblouissant, avait longuement poli ses bagues, sa chaîne de montre et même ses boutons de manchettes avant de sortir du bungalow.
Un soir, Pirovani se présenta vêtu d’un costume criard qu’il venait de recevoir de Bahia Blanca, et tenant à la main un bouquet d’énormes roses.
—Ces fleurs m’ont été apportées aujourd’hui de Buenos-Ayres, madame la marquise, et je m’empresse de vous les offrir.
Canterac lança à l’Italien un regard hostile et dit tout bas à Robledo:
—Il ment; Moreno, qui sait tout, m’a affirmé qu’il les avait commandées par télégramme. Il a fait galoper ce soir un homme jusqu’à la station pour les avoir à temps.
La métisse, aidée des jeunes garçons, levait la table{110} et, par la seule présence d’Hélène, la salle aux cloisons de bois, prenait un air de fête. Les trois visiteurs, en s’adressant à elle, répétaient avec une sorte d’extase, le mot «marquise» comme s’ils tiraient vanité de fréquenter une dame de si haute lignée.
Hélène avouait une certaine préférence pour Canterac. Ils avaient tous deux vécu à Paris, dans des mondes distincts, mais assez rapprochés. Ils ne s’étaient jamais rencontrés, mais ils avaient fini par se trouver des amis communs.
Pendant leur conversation, Moreno fumait avec résignation en échangeant quelques mots avec Watson, et Pirovani causait avec Robledo et Torrebianca. L’Italien ne prêtait pas grande attention à ses propres paroles et ses yeux inquiets ne cessaient d’espionner «madame la marquise» et son interlocuteur.
Après l’arrivée de Pirovani et de ses roses, la réunion changea complètement de caractère.
Le lendemain soir, les quatres convives étaient assis à table, plus silencieux que de coutume. Hélène avait passé pour dîner une de ses robes les plus sensationnelles, une robe qui eût paru audacieuse, même à Paris. Les trois ingénieurs avaient encore leurs vêtements de travail et paraissaient très fatigués du labeur de la journée. Robledo bâilla à plusieurs reprises: il avait peine à se maintenir éveillé. Le marquis s’était endormi sur sa chaise, et sa tête dodelinait régulièrement. Hélène regardait fixement Ricardo, comme si, jusqu’à ce moment, elle ne l’eût jamais bien vu; lui, évitait son regard.
Pirovani entra, portant un gros paquet; il avait revêtu un nouveau costume dont l’étoffe à petits carreaux de couleurs diverses ressemblait à la peau d’un reptile.
—Madame la marquise, un de mes amis de{111} Buenos-Ayres m’a fait parvenir ces caramels. Permettez-moi de vous les offrir. Vous trouverez aussi dans ce paquet des cigarettes égyptiennes...
Hélène eut un sourire en voyant le nouveau costume de l’entrepreneur et le remercia, en minaudant, de son présent.
Un moment après, Moreno se présenta chaussé de souliers vernis, habillé d’une jaquette aux pans très longs et coiffé d’un chapeau melon, comme s’il fût allé rendre visite au ministre à Buenos-Ayres.
Robledo, qui n’avait plus sommeil, exprima ironiquement son admiration.
—Quelle élégance!
—J’ai eu peur que les mites mangent ma jaquette dans ma malle, j’ai voulu lui faire prendre un peu l’air.
Puis il s’approcha timidement d’Hélène—«Bonsoir madame la marquise!» Et il lui baisa la main, en imitant le maintien des élégants personnages qu’il avait admirés au théâtre ou dans les livres.
Il ne quitta plus d’un pas la maîtresse de maison et engagea avec elle une conversation en a parté qui sembla provoquer l’indignation de Pirovani. Celui-ci finit par quitter sa chaise; il sentait le besoin de protester contre cet accaparement excessif.
—Avez-vous vu, dit-il à Robledo, comment est fagoté ce crève-la-faim!
Mais cette soirée réservait d’autres surprises. La plus extraordinaire manquait encore.
La porte s’ouvrit pour livrer passage à Canterac; pour que chacun pût l’admirer, le Français resta quelques instants immobile sur le seuil.
Il était en smoking, avec un plastron rigide et luisant et il avait donné à son pas un certain laisser-aller aristocratique, comme s’il fût entré dans{112} un salon parisien. Il salua les hommes d’un signe de tête cérémonieux et protecteur, puis il baisa la main d’Hélène.
—Moi aussi, marquise, j’éprouve le besoin de m’habiller, le soir, comme autrefois.
La Torrebianca, heureuse, accepta l’hommage, tourna le dos à Moreno et fit asseoir près d’elle le nouveau venu. Pendant la soirée elle causa de préférence avec le Français, tandis que Pirovani, visiblement furieux, restait dans un coin, anéanti par l’élégance de Canterac.
Quatre jours passèrent sans que l’entrepreneur reparût. Moreno s’étonna de cette absence et dès le premier jour, il alla se renseigner au domicile de l’Italien. Le soir il dit à Robledo:
—Il a pris le train pour Bahia-Blanca, sans avertir personne. Il doit avoir en vue quelque grosse affaire.
Les réunions continuèrent sans incident nouveau. Le Français, toujours en smoking, était l’interlocuteur préféré d’Hélène. Moreno, chaque soir, mettait sa jaquette, mais n’arrivait qu’à causer avec Torrebianca. Un soir, enfin, le marquis lui même sortit de sa chambre en smoking et comme Robledo s’étonnait du geste, il montra sa femme pour s’excuser.
Le cinquième soir, Moreno, en entrant, annonça vite:
—Grande nouvelle! Pirovani est revenu à la nuit tombante. Il va certainement arriver d’un moment à l’autre.
Tous attendirent son apparition comme l’événement de cette veillée.
Il ouvrit la porte et resta quelques instants immobile sur le seuil,—comme avait fait l’autre—pour se rendre compte de l’effet produit par son entrée.{113} Il était en habit; mais c’était un habit extraordinaire, éblouissant, où, sur la soie des revers zigzaguaient des moirures larges comme les veines du bois; son gilet blanc était richement brodé; à la boutonnière, il arborait un gardénia. Sur son plastron, où luisait une perle énorme, tranchait le large ruban noir d’un inutile monocle.
Il avait l’allure solennelle et magnifique d’un directeur de cirque ou d’un prestidigitateur célèbre et il affectait une impassible gravité, pour dissimuler son émotion. Il salua les hommes avec un air de fierté virile, et, s’inclinant devant «madame la marquise», lui baisa la main.
Un étonnement ironique brilla dans les yeux d’Hélène. Tout ce qui venait de Pirovani la faisait sourire. Cependant, flattée qu’il se fût ainsi transformé pour lui plaire, elle accueillit l’entrepreneur avec de grandes démonstrations d’amitié et le fit asseoir près d’elle.
Canterac se tint à l’écart, offensé de cette préférence inaccoutumée; Moreno paraissait scandalisé et disait à Robledo en montrant le frac de Pirovani:
—Voilà donc le grave objet de son mystérieux voyage!
L’Espagnol s’éloigna de lui et s’approcha de Watson qui, encore tout étourdi après l’entrée théâtrale de l’Italien, le considérait en se retenant de rire.
—Après le smoking, le frac, murmura Robledo. Le carnaval envahit notre désert et cette femme va tous nous rendre fous.
Il regarda le costume de l’Américain qui ressemblait au sien: un costume pratique, fait pour travailler à l’air libre, et sans mot dire, il considéra l’aspect que présentaient les autres.
Puis il pensa:
«Quelle perturbation, lorsqu’une femme comme{114} celle-là tombe au milieu d’hommes qui vivent seuls et qui travaillent! Et nous verrons peut-être des choses plus graves! Qui sait si nous ne finirons pas par nous entre-tuer sous ses yeux... Qui sait si cette Hélène ne sera pas semblable à l’Hélène de Troie?»{115}
—Un peu plus de maté, commissaire?
Don Carlos Rojas était assis devant une table avec Don Roque, le commissaire de police de l’endroit, dans la grande salle de son estancia. Une petite métisse qui attendait des ordres, debout à côté d’eux, les regardait de ses yeux bridés.
Chacun tenait dans la main droite la petite calebasse où l’on sert le maté et ils aspiraient le liquide parfumé à l’aide du chalumeau d’argent, qu’on nomme, là-bas «bombilla». Dès que la métisse se rendait compte, au sifflement de l’air dans les chalumeaux, que les récipients allaient être vides, elle courait au fourneau très proche, apportait la pava, sorte de théière pleine d’eau bouillante, et remplissait à nouveau les calebasses où macérait l’herbe maté.
Ils parlaient lentement, s’arrêtant parfois pour aspirer l’infusion. Rojas s’efforçait de dompter sa colère. La veille, on lui avait volé un jeune taureau et il accusait de ce méfait Manos Duras, toujours à l’affût du bétail d’autrui qu’il écoulait à la Presa.{116} Ce vol lui causait un double dommage, car s’il était éleveur il était aussi le fournisseur de viande du village et cette vente constituait un des revenus les plus sûrs de son estancia.
A l’arrivée du commissaire, venu sur sa demande pour constater le vol, il avait compté une fois de plus ses jeunes taureaux. Certainement il en manquait un. Et Rojas s’échauffait en parlant à don Roque; il pestait contre l’audace de Manos Duras et criait qu’il n’y avait pas de justice à Rio Negro.
—Trois fois je l’ai arrêté et fait envoyer à la capitale du territoire, dit le commissaire avec découragement. On le remet chaque fois en liberté, faute de preuves. Qu’y pouvons-nous? Personne ne veut témoigner contre lui.
Comme Rojas continuait à récriminer, don Roque ajouta, pour le calmer:
—Je vais essayer de trouver une preuve, cette fois. Je vous garantis, don Carlos, que je ferai l’impossible.
Il disposait de moyens bien faibles pour faire respecter la loi et il s’en plaignait. La troupe qu’il commandait se composait de quatre policiers indolents, vêtus d’uniformes délabrés et uniquement armés de longs sabres de cavalerie. Les habitants du pays, mieux partagés, leur prêtaient leurs carabines lorsqu’ils partaient à la poursuite de quelque bandit. Leurs chevaux, très mal nourris, étaient les plus maigres de la région.
—Nous vivons dans une nation fédérale, dit le commissaire, et seules les provinces autonomes ont une police bien organisée. Dans les territoires, nous dépendons, nous autres, les autorités, du gouvernement de Buenos-Ayres; mais nous sommes si loin qu’on nous oublie et nous ne pouvons compter que sur ce que nous improvisons nous-mêmes.
En critiquant ainsi l’abandon où se trouvaient les{117} territoires, les deux Argentins en vinrent insensiblement à exalter, par comparaison, la grandeur du reste du pays.
—On nous oublie ici, nous sommes des sauvages, continua don Roque; mais nous sommes en Patagonie et la civilisation n’y a pénétré que depuis quelques années. Par contre, don Carlos, comme le reste de notre pays a progressé en moins d’un demi-siècle! N’est-ce pas formidable, pucha[15]! Et ils finirent par oublier leurs préoccupations immédiates, pour penser seulement à la partie de leur patrie qui avait fait de vertigineux progrès. Ils entreprirent l’éloge de la région où ils vivaient. Don Roque était un patriote optimiste, enthousiaste, mais soupçonneux; il flairait des ennemis partout.
—Notre Patagonie maintenant déserte, vous verrez comme elle se fera belle dans quelques années, quand l’eau fécondera sa terre. C’est un bonheur pour nous que les Européens l’aient trouvée affreuse, sans quoi, ils nous l’auraient déjà volée.
Il répétait à Rojas ce qu’il avait lu, çà et là, dans des journaux et des livres.
—Il y a de cela longtemps, un gringo notoire qu’on appelait Carlos Darwin, le même qui a découvert que nous descendons tous du singe, est venu faire un tour dans ces parages. Il était jeune alors et il avait débarqué à Bahia Blanca d’une frégate de guerre anglaise qui faisait le tour du monde. Il voulait étudier les plantes et les animaux du pays; il n’eut pas grand travail car il n’y avait abondance ni des uns ni des autres. Aussi, il paraît qu’il s’en retourna désespéré et donna à ce pays le nom de «Terre de la désolation». Il nous a rendu là un fameux service, le gringo! S’il avait pu se douter de ce que deviendrait notre terre avec l’irrigation,{118} les Anglais nous l’auraient volée comme ils nous ont volé les îles Malvinas, celles qu’ils appellent îles Falkland.
Rojas aussi évoquait le passé et déplorait l’aveuglement de ses parents et de ses grands-parents. Ils avaient eu le tort d’être riches à une époque où les plus grandes fortunes de l’Argentine n’étaient pas encore édifiées.
C’était vers 1870, au moment où le gouvernement argentin, las de supporter les brigandages des indigènes sauvages et pillards qui venaient presque jusqu’aux portes de la capitale, avait achevé l’œuvre des vieux conquérants espagnols en lançant dans le désert une expédition militaire qui s’empara de vingt mille lieues de terres presque entièrement labourables.
—Le gouvernement vendait une lieue pour 500 pesos[16] et le peso d’alors ne valait que quelques centavos[17]. De plus, il accordait plusieurs années de crédit et même faisait paraître au Journal officiel le nom de l’acheteur, en proclamant qu’il avait bien mérité de la patrie. Les soldats qui prirent part à l’expédition reçurent aussi, comme récompense, des lieues de terrain; la plupart cédèrent leurs titres de propriété aux cabaretiers en échange de genièvre ou de vivres. Ce sont ces terres qui maintenant fournissent de blé et de viande la moitié du monde et qui ont vu surgir de leur sein tant de villes et de villages. La lieue de terrain, qui valait quelques centavos, vaut maintenant des millions.
—Beaucoup d’entre ceux qui possèdent ces terres n’ont pas eu d’autre mérite que de les garder sans les cultiver et de refuser de les vendre, en attendant que l’immigration européenne vînt augmenter{119} leur valeur. Mes ancêtres étaient déjà de vieux riches à cette époque et ils possédaient une grande estancia; ils ne voulurent pas acheter de cette terre nouvelle. Quelle faute!
Rojas oubliait qu’il avait lui-même follement dilapidé la plus grosse partie de son patrimoine; il pensait seulement à l’énorme fortune que ses ancêtres auraient amassée si, comme tant d’autres, ils avaient su profiter de l’épanouissement rapide du pays.
Quelqu’un interrompit à ce moment la conversation des deux Argentins. Celinda entra dans la pièce en costume d’amazone, embrassa son père et salua don Roque. L’estanciero sortit un instant pour aller chercher une boîte de cigares et le commissaire dit en regardant avec malice la jupe de la jeune fille:
—Dites-moi, on vous rencontre avec un autre costume dans la plaine.
Celinda sourit et le menaça gentiment du doigt pour l’inviter à se taire.
—Silence, si papa vous entendait!
Tandis que les deux hommes allumaient leur cigare et recommençaient à parler de ce Manos Duras qu’il fallait à tout prix poursuivre, Celinda s’éloigna de l’estancia sur un cheval qui portait un harnachement de dame. Une demi-heure après, elle galopait au bord du fleuve; mais elle était en costume d’homme et montait un autre cheval. Elle aperçut un groupe de cavaliers qui venaient à sa rencontre et s’arrêta pour les reconnaître.
L’ingénieur Canterac, pour faire sa cour, avait proposé à la marquise de Torrebianca une promenade près du fleuve; il voulait lui faire visiter les travaux qu’il dirigeait. Hélène verrait pendant cette promenade des centaines d’hommes lui obéir et se rendrait compte qu’il était bien le personnage le plus important du camp.{120}
Tous deux trottaient en tête du groupe. Derrière eux, Pirovani, médiocre cavalier, s’efforçait de pousser sa monture entre les deux interlocuteurs. Le marquis, Watson et Moreno fermaient la marche.
Au moment où Hélène et Canterac dépassèrent Celinda, les deux femmes se regardèrent. La marquise sourit, disposée à engager la conversation; mais la jeune fille demeura sombre, les yeux durs.
—C’est une fillette fort espiègle et joueuse, dit l’ingénieur, on dirait presque un garçon; mais je la crois capable de tourner la tête à plus d’un homme. On l’appelle souvent «la fleur du Rio Negro».
Hélène, qu’offensait l’attitude de la fille de Rojas, la regardait maintenant avec hauteur.
—C’est une fleur, peut-être, dit-elle; mais une fleur sauvage.
Puis elle passa, escortée de ses deux admirateurs.
Cette brève conversation avait eu lieu en français et Celinda ne put comprendre que quelques mots; elle devina cependant que l’autre avait mal parlé d’elle; elle fit une grimace méprisante et tira la langue.
Le second groupe de cavaliers passa. Le marquis fit à la jeune fille un salut cérémonieux; Moreno, occupé à surveiller le groupe où se trouvait la marquise, ne la remarqua même pas.
Richard Watson feignit de ne pas comprendre les signes que lui faisait Celinda et lui indiqua du geste qu’il était obligé de suivre les autres. La jeune fille, boudeuse, le laissa passer; puis, changeant d’avis, elle tira sur la bride, fit faire demi-tour à son cheval et suivit le groupe.
Tout en trottant, elle saisit de la main droite le lasso qui pendait au pommeau de sa selle et le lança sur son ami. Elle ramena la corde aussitôt et Watson dut, pour ne pas tomber, s’arrêter, puis{121} reculer, tandis que ses deux compagnons continuaient à marcher sans remarquer l’incident. Richard arriva aux côtés de la jeune fille les épaules toujours enserrées par le lasso. Il aurait pu se détacher et poursuivre sa route; mais comme cette espièglerie l’irritait, il préféra parler sans délai à la turbulente Celinda.
—Approchez, dit-elle souriante, en ramenant doucement la corde; comment avez-vous l’audace de vous montrer avec cette femme, sans ma permission?
L’ingénieur répondit d’un ton sec:
—Vous n’avez aucun droit sur moi, Mademoiselle Rojas, et je peux me montrer avec qui il me plaît.
Celinda pâlit à cet accent inattendu; mais elle se reprit et recouvrant toute sa gaieté, elle dit, en imitant la voix irritée de son interlocuteur:
—Monsieur Watson, j’ai sur vous des droits indiscutables, car votre personne m’intéresse et je ne peux supporter de vous voir en mauvaise compagnie.
L’Américain, vaincu par la gravité comique de la jeune fille, se mit à rire. Celinda l’imita.
—Vous connaissez mon caractère, gringuito... Il ne me plaît pas qu’on vous voie avec cette femme. D’ailleurs elle est trop vieille pour vous. Jurez que vous m’obéirez; à cette condition je vous rends votre liberté.
Watson jura solennellement, la main levée, en s’efforçant de ne pas rire et Celinda le délivra du lasso.
Puis ils poussèrent leurs chevaux dans une direction opposée à celle qu’avaient prise Hélène et son cortège de cavaliers.
Depuis le jour où l’ingénieur français avait con{122}duit Hélène aux chantiers du fleuve, en faisant étalage de son autorité sur les ouvriers, Pirovani humilié cherchait à prendre sa revanche. Un jour qu’il rêvait, accoudé à la balustrade extérieure de sa demeure, il crut avoir trouvé le moyen de vaincre son rival.
Une demi-heure après, un des contremaîtres que Pirovani chargeait toujours des missions les plus difficiles s’arrêta devant la maison.
C’était un Chilien intelligent et habile à se tirer des situations délicates. Ses compatriotes le surnommaient El Fraïle[18] parce qu’il avait été l’élève des dominicains de Valparaiso.
Le Fraïle avait des lettres et ne dédaignait pas d’employer des mots recherchés dont il modifiait la prononciation selon son caprice. Sa voix était mielleuse, ses gestes exagérément polis. Il aimait glisser dans la conversation des expressions poétiques; il avait quitté son pays natal après avoir donné à un de ses amis deux coups de couteau mortels.
Il se présenta, à cheval, devinant que le patron allait lui demander un long voyage. Il mit pied à terre et Pirovani s’approchant lui donna dans le dos quelques tapes amicales. Il l’appelait affectueusement tantôt chileno[19] tantôt roto[20], qualificatifs ironiques qu’au Chili les gens du peuple s’attribuent à eux-mêmes.
—Ecoute bien, roto, tu vas partir au grand galop pour la station. Le train pour Buenos-Ayres passe dans deux heures; il ne faut pas que tu le manques.
Le Fraïle, ordinairement impassible et souriant,{123} ne put réprimer un mouvement de surprise, en apprenant qu’on l’envoyait à Buenos-Ayres.
—Une fois là-bas, continua l’entrepreneur, tu remettras cette liste à don Fernando, mon représentant, que tu connais. Tu lui diras de faire les achats immédiatement, de te remettre les paquets et tu prendras le train quelques heures après. Tu as cinq jours pour aller et revenir.
Le Chilien prit un air grave en entendant ces ordres. La mission était certainement d’importance et il se sentit fier qu’on eût pensé à lui pour l’exécuter.
Pirovani lui remit une poignée de billets de banque destinés à couvrir les frais du voyage, lui dit adieu et tourna les talons, heureux comme l’est un général après avoir lancé l’ordre qui doit décider de la victoire.
Le Fraïle descendit l’escalier, tout pensif, les sourcils froncés. «C’est sans doute une demande d’outils indispensables... Peut-être aussi m’envoie-t-il chercher de l’argent.»
Pirovani était rentré chez lui; le Chilien ne se fatigua pas plus longtemps l’esprit à chercher une explication; il ouvrit l’enveloppe qu’il venait de recevoir et se mit à lire au milieu de la rue.
Il lut d’abord quelques lignes sans comprendre:
Une douzaine de flacons de «Jardin enchanté».
Une douzaine de flacons de «Nymphes et Ondines».
Six douzaines de boîtes de savon «Clair de lune».
Le contremaître poursuivit la lecture des divers feuillets du carnet. Il commençait à comprendre et son étonnement allait croissant. C’était pour cela qu’on l’envoyait à Buenos-Ayres, avec ordre de revenir sans délai!
—Padre san Francisco! murmura-t-il, tout ça{124} pour une seule femme? Il y a de quoi servir tout le harem du Grand Turc.
Mais comme, au fond, un voyage à Buenos-Ayres, même ainsi écourté, ne lui déplaisait pas, il monta joyeusement à cheval et piqua des deux dans la direction de la gare.
De tous les personnages qui venaient rendre visite à la marquise de Torrebianca, Moreno était en apparence le plus calme. Ses travaux administratifs ne l’occupaient guère qu’un jour par semaine; le reste du temps, il lisait dans la baraque où il avait installé son bureau. Il lisait avec avidité, sans jamais se lasser, et il était fort capable de dévorer un roman, parfois deux, en un jour. Il avait une vieille passion pour les récits romanesques; mais dans les longues heures de solitude à la Presa, elle s’était encore exacerbée. Pendant que chacun travaillait aux environs du village, il restait seul dans son rudimentaire cabinet.
Or, depuis l’arrivée du marquis de Torrebianca, ses goûts littéraires, un peu imprécis jusqu’alors, s’étaient affirmés et nettement définis: il aima par dessus tout les récits qui se déroulaient dans un milieu aristocratique et dont les héros étaient des gens «du grand monde».
Il pouvait maintenant vérifier l’exactitude de ces récits, puisqu’il fréquentait des représentants de la plus haute société parisienne.
Parfois, il suspendait sa lecture et ses yeux extasiés contemplaient le plafond. L’ambition chantait un hymne sous son crâne: «Oh! être un héros de roman! être aimé d’une grande dame!»
Un soir, Moreno vit arriver à l’improviste l’ingénieur Canterac à cheval. C’était l’heure où d’ordinaire il surveillait les travaux du barrage. Seul un événement important pouvait expliquer l’arrivée du capitaine.{125}
Le cavalier s’approcha de la fenêtre où l’Espagnol lisait et lui tendit la main en se penchant sur sa monture. Sans préambules inutiles, il dit avec une brièveté toute militaire:
—J’ai tenu à vous voir avant le départ du courrier. Je veux faire un cadeau à la marquise. La malheureuse manque de tout dans ce désert et vous vous souvenez, sans doute, que tout dernièrement elle nous confiait son ennui de ne pas avoir ici les parfums qu’elle employait à Paris.
Et l’ingénieur sortit de sa poche divers feuillets de papier qu’il tendit à Moreno.
—J’ai tiré cela de tous les catalogues de Buenos-Ayres que le patron du bar a pu me procurer. Il a bien tardé à me les donner; j’aurais voulu les avoir il y a trois jours pour profiter d’un autre train, mais enfin... Vous avez je crois beaucoup d’amis à Buenos-Ayres; écrivez donc qu’on vous envoie tous ces objets, vous en retiendrez le prix sur mon traitement de ce mois.
Moreno accepta et prit les papiers.
—Je pense, continua l’ingénieur, que cet insupportable Pirovani n’aura pas pris les devants.
Il s’éloigna vers les chantiers et Moreno examina les feuillets. Ses yeux dilatés de stupeur prirent à peu près la forme circulaire des lunettes d’écaille qui les protégeaient.
C’était une très longue liste, non seulement de parfums et de savons, mais d’objets de toilette de toute espèce. Le capitaine avait foncé dans les pages des catalogues comme dans une terre nouvellement découverte; il n’avait rien laissé derrière lui.
—Il y en a bien pour mille pesos, se dit l’employé, et il n’en touche que six cents par mois.
Son austérité d’homme de chiffres méthodique et prudent s’insurgeait contre ce défaut d’équilibre entre les recettes et les dépenses. Mais il finit par{126} sourire et par trouver naturelle cette folie. La marquise était si intéressante! Et puis, une femme de ce rang pouvait-elle en vérité subir les mêmes privations qu’une femme du commun?
Jusqu’au soir, Moreno fut agité et pensif. A plusieurs reprises, il tenta de continuer la lecture de son roman; mais le livre retombait toujours sur la table couverte de papiers administratifs. Il prit enfin une feuille de papier à lettre et, le sourcil froncé, avec l’expression craintive d’un enfant qui a peur d’être pris en flagrant délit de mensonge, il se mit à écrire:
«Ma brunette jolie, envoie-moi le plus tôt possible l’habit de cérémonie que j’avais fait faire à l’occasion de notre mariage. Notre existence a complètement changé! Nous recevons fréquemment la visite de très grands personnages; nous avons beaucoup de fêtes et je suis obligé de me tenir aussi bien que tout le monde. Cela peut me servir dans ma carrière», etc...
Moreno s’arrêta pour se gratter la tête avec le manche de son porte-plume. Puis il continua d’écrire avec, sur le visage, cette même expression enfantine d’inquiétude et de remords, jusqu’à la fin des quatre pages.
Tous les soirs, au cours de la réunion chez la marquise, Pirovani avait l’attitude soucieuse de l’homme qui veut parler et que l’émotion arrête. Au bout d’une semaine d’hésitations, il se décida à exprimer son désir et ce fut le soir même où l’employé de bureau comptait bien remporter le plus beau succès de sa vie.
Hélène portait une des robes décolletées qu’elle agrémentait ou dépouillait tous les jours de quelque ornement, pour leur donner, chaque fois, un air de nouveauté. L’ingénieur français et Torrebianca étaient en smoking et Pirovani portait encore son{127} majestueux habit noir... Mais il n’était déjà plus seul à porter ce vêtement. Moreno s’était présenté le dernier avec l’habit expédié par sa femme, habit très modeste en vérité et visiblement défraîchi; mais habit enfin. Celui de l’entrepreneur n’était donc plus l’unique, son possesseur se montra fort irrité de ce contre-temps qui le confirma dans sa résolution de parler au plus tôt.
Watson et Robledo portaient des costumes sombres. Ils s’étaient vus contraints de changer de vêtements chaque soir, pour se mettre en harmonie avec le milieu d’absurde élégance suscité par Hélène. L’Américain était fatigué des travaux de la journée; il étouffa quelques bâillements et se leva pour se retirer dans sa chambre. Hélène, qui depuis quelque temps le regardait avec intérêt, ne cacha pas son dépit de le voir se lever, la saluer froidement et se retirer sans paraître attristé de se séparer d’elle.
A ce moment, Canterac était en conversation animée avec la marquise; Moreno causait avec Robledo. Pirovani ne voulut pas laisser passer l’occasion qui se présentait de dire à Hélène toute sa pensée.
—Je n’osais vous parler, madame la marquise; mais il faut que je me décide enfin... Vous vivez dans un cadre indigne de votre beauté et de votre élégance.
Il embrassait d’un regard méprisant la pièce et les meubles qui la garnissaient.
—Si vous le voulez, dès demain, vous pourrez vous installer dans ma maison; elle est à vous. Pour moi, je trouverai à me loger dans la baraque d’un de mes employés.
Hélène ne fut pas étonnée outre mesure. On eût dit qu’elle attendait depuis longtemps cette proposition qu’elle semblait avoir peu à peu suggérée à{128} l’entrepreneur. Elle eut cependant un geste de refus tout en souriant à Pirovani, en le caressant des yeux. Elle parut enfin s’adoucir. Elle étudierait la proposition et consulterait son mari, avant de se décider.
Elle parla donc au marquis le jour suivant, pendant que Robledo et Watson surveillaient les travaux du fleuve. Torrebianca, malgré la soumission qu’il montrait devant tous les désirs de sa femme, fut scandalisé. Il ne pouvait accepter la générosité de Pirovani.
—Que vont penser les gens, en le voyant nous céder la maison dont il est si fier?
Il secouait énergiquement la tête. La pensée que ce compatriote vulgaire s’instituait son protecteur suscitait en son âme une révolte de caste. L’entrepreneur ne lui était pas antipathique; mais il ne pouvait admettre qu’il fût son égal.
Hélène, irritée par ce refus, se fâcha.
—Ton ami Robledo nous aide bien, et tu ne t’occupes pas de ce que peuvent en dire les gens... Est-il extraordinaire qu’un nouvel ami veuille nous prouver sa sympathie en nous cédant sa maison?
Torrebianca était si accoutumé à obéir à sa femme que ces quelques mots suffirent à briser sa résistance. Cependant, comme il protestait encore, Hélène ajouta pour le convaincre:
—Je comprendrais tes scrupules, si la maison nous était donnée; or, nous la louerons, je l’ai dit à Pirovani. Tu lui paieras le loyer quand l’entreprise dirigée par Robledo aura rétribué ton travail.
Le marquis, résigné, accepta tout. Il paraissait maintenant vieilli, découragé; une souffrance intime semblait le ronger.
—Fais comme tu voudras. Mon seul désir est de te voir heureuse.
Le lendemain, Hélène visita la maison de Pirovani{129} pour la reconnaître en détail, avant de procéder à son installation.
L’entrepreneur la reçut au sommet du perron et l’accompagna dans les diverses pièces; il était pâle d’émotion en se voyant seul avec «madame la marquise». Pour agir déjà en maîtresse de maison, celle-ci fit changer quelques meubles de place. L’Italien loua fort le bon goût de la grande dame et de l’œil il faisait signe à sa gouvernante métisse de s’extasier aussi.
Ils arrivèrent dans la chambre à coucher de l’Italien qui allait être désormais celle d’Hélène. Sur tous les meubles s’entassaient des paquets enveloppés de papier fin, ficelés et cachetés, qui dégageaient un parfum agréable. L’entrepreneur les ouvrit un à un et mit à jour des douzaines de flacons d’odeurs, de boîtes de savons et quantité d’autres articles de toilette; c’était toute l’énorme commande faite à Buenos-Ayres.
L’éclat des flacons de cristal taillé, des écrins doublés de soie ou de peau, des étiquettes dorées caressait agréablement les yeux, tandis que l’odorat était heureusement chatouillé par des parfums qui semblaient émaner d’un jardin surnaturel.
Hélène marchait de surprise en surprise; elle finit par rire et par pousser des cris de joie, non sans ironie.
—Quelle générosité?... Il y a là de quoi ouvrir une boutique de parfumeur.
Pirovani pâlissait davantage; la solitude irritait son désir; il essaya d’approcher sa bouche de celle de la marquise pour la baiser. Mais elle attendait depuis longtemps l’attaque; elle n’eut pas de peine à la repousser en avançant énergiquement ses deux mains.
—Vous voulez donc me faire payer le loyer de votre maison, comme un vulgaire marchand. Dans{130} ce cas, ce n’est plus un cadeau. Et moi qui vous croyais un gentleman!
Elle eut pitié de la confusion de l’Italien. Le malheureux avait peur de n’avoir pas agi avec tout le tact d’un homme du monde. Pour le consoler, elle lui effleura la bouche de sa main droite.
—Contentez-vous de ceci, dit-elle.
Pirovani couvrit cette main de tant de baisers enthousiastes qu’elle dut à la fin la retirer et l’inviter, en le menaçant du doigt, à demeurer prudent; puis elle continua de visiter la maison.
L’entrepreneur suivait tous ses pas; il semblait regretter son audace et aussi d’avoir si facilement obéi à cette femme.
Mais malgré tous ces sentiments opposés, il se rappelait le contact de cette main odorante et fine et il savourait son triomphe. Il persistait dans son opinion: «Oh! les grandes dames!... Il n’y a pas d’autres femmes au monde.»{131}
L’aspect de la maison de Pirovani changea beaucoup après l’installation des Torrebianca.
A travers les vitres des fenêtres on apercevait maintenant d’élégants rideaux; on ne voyait plus, sur les galeries extérieures, des domestiques crasseuses procéder en plein air à certains soins de toilette. La présence de cette dame, si élégante et si belle, avait obligé les serviteurs à prendre plus de soin de leur personne. Pour la grosse Sébastienne elle-même c’était, comme disaient ses amies, «dimanche tous les jours».
Les habitants de la Presa eurent une surprise nouvelle, outre l’arrivée d’Hélène dans la maison de l’entrepreneur. Dans le salon de Pirovani il y avait un piano demi-queue; personne jusqu’alors ne l’avait ouvert.
L’Italien l’avait acheté à Buenos-Ayres pour rendre service à l’un de ses compatriotes, marchand d’instruments de musique. On lui avait dit, d’ailleurs, qu’il n’est pas de salon distingué sans un{132} piano, mais un piano horizontal, au couvercle à demi soulevé.
Quand il avait fait l’emplette du précieux instrument, il croyait bien que jamais personne à la Presa ne l’utiliserait. Lorsque Hélène, qui ne cessait de fumer pendant les heures de solitude, était lasse de parcourir toutes les pièces, la cigarette aux lèvres, pour admirer l’élégance et le confort de sa nouvelle maison, elle ouvrait le piano et laissait courir ses doigts sur les touches. Pendant des heures entières elle répétait des romances de sa jeunesse, inconnues presque de la génération venue après elle, ou elle rejouait les airs qui étaient à la mode au moment où elle avait fui Paris.
Souvent, enthousiasmée par ces évocations du passé, elle éprouvait le besoin irrésistible d’allier sa voix à celle de l’instrument. En l’entendant chanter, Sébastienne et les autres servantes cessaient de travailler dans la cour; elles pénétraient lentement dans la maison, charmées comme les bêtes que subjuguèrent la voix et la lyre d’Orphée.
Une partie des habitants subissait aussi cette attraction. Lorsque, la nuit venue, les travailleurs avaient terminé leur repas, des enfants et des femmes se dirigeaient vers la maison de Pirovani et s’asseyaient sur le sol, à quelque distance, pour contempler les fenêtres où s’allumaient de faibles reflets rouges. Si des enfants turbulents commençaient à se poursuivre en jouant, leur mère leur imposait silence.
—Taisez-vous, polissons, la dame va chanter!
Elles frissonnaient d’une émotion religieuse quand montait la voix d’Hélène, soutenue par les accords du piano. A travers les cloisons de bois, la mélodie semblait venir d’un monde lointain pour enchanter cette multitude d’êtres naïfs qui depuis des années{133} n’avaient entendu d’autre musique que le son des guitares du cabaret.
Quelques hommes, enflammés d’admiration et de désir, venaient grossir ce public fruste. Ils étaient restés indifférents devant la fille de Rojas l’estanciero, qu’ils trouvaient semblable à un garçon; mais ils s’enthousiasmaient en voyant passer à cheval, en costume d’amazone, la marquise de Torrebianca.
—Voilà une femme!... Regardez-moi si c’est arrondi! Et, en l’écoutant chanter, ils restaient hébétés, envahis d’une volupté délicieuse. Ils pensaient que seule une femme très belle pouvait chanter ainsi.
Une semaine après l’installation des Torrebianca dans leur nouvelle demeure, Sébastienne annonça à ses voisines que «madame» allait désormais recevoir chaque jour ses amis, comme les dames riches de Buenos-Ayres. Le soir, les commères de la Presa s’assemblèrent devant les fenêtres brillamment éclairées. Hélène, assise au piano, chantait des romances sentimentales, tandis que ses invités commençaient d’arriver.
D’abord se présentèrent l’ingénieur français et Moreno. Ce dernier, en habit sous son pardessus, avait cru devoir compléter son costume par un chapeau haut de forme. Il n’était pas, lui, comme Pirovani, qui portait un chapeau mou avec l’habit de soirée. «Madame la marquise», une femme du monde, avait certainement remarqué cette faute de goût.
Canterac s’arrêta, le pied sur la première marche de l’escalier, et dit à son compagnon:
—Je ne devrais pas entrer. C’est la maison de Pirovani, cet intrigant, que je déteste, mais je fâcherais la marquise si je n’assistais pas à la soirée.
Moreno était l’ami de tout le monde; il n’avait{134} jamais détesté réellement personne; il crut devoir prendre la défense de l’absent.
—Je vous assure que l’Italien est un très brave homme; je suis certain qu’il vous aime beaucoup.
Mais Canterac refusait d’écouter toute parole conciliante.
—Il manque de tact; il est toujours en travers de mon chemin. Cela pourrait finir mal pour lui.
Ils entrèrent, et le marquis vint les recevoir. Ils passèrent au salon et s’arrêtèrent, immobiles, tandis qu’Hélène continuait de chanter, comme si elle n’eût pas remarqué leur entrée.
Deux autres invités, Robledo et Pirovani, se rencontrèrent devant la maison. L’Italien portait, par-dessus son habit, une pelisse neuve et s’était coiffé d’un haut de forme reluisant qu’il avait commandé par télégramme à Bahia Blanca, comme si un démon familier lui eût rapporté les malins propos de son ami Moreno.
Dans les groupes de curieux, que la nuit cachait à demi, on riait et on chuchotait. Les uns se moquaient du cylindre de soie brillante où l’entrepreneur avait fourré sa tête; d’autres l’admiraient, fiers qu’on trouvât dans leur désert de tels chapeaux.
—Je viens en visite chez moi, en somme, dit Pirovani, pour faire admirer sa générosité.
—Vous avez eu tort de céder votre maison, répondit simplement Robledo.
L’Italien prit un air de supériorité.
—Vous m’avouerez que la vôtre ne pouvait convenir à une aussi grande dame. Je n’ai pas d’instruction, mais je sais à quoi la politesse m’oblige; aussi...
Robledo haussa les épaules et continua sa marche, comme pour ne plus l’entendre. L’entrepre{135}neur le suivit et, montrant une des fenêtres éclairées, il dit avec ferveur:
—Quelle voix d’ange! Quelle âme d’artiste!
Robledo eut un nouveau haussement d’épaules, et tous deux entrèrent dans la maison.
Au salon, ils s’arrêtèrent auprès des trois hommes qui écoutaient sans bouger; dès qu’Hélène eut lancé la dernière note de sa romance, l’Italien se mit à applaudir et à pousser des clameurs d’enthousiasme. Canterac et l’employé de bureau s’empressèrent alors d’exprimer aussi leur admiration, chacun à sa manière.
Dans la nouvelle maison, les réunions furent moins simples et moins austères que chez Robledo. Sébastienne, qui prisait par-dessus tout le maté, ce remède à toutes les maladies, ce nectar délicieux, dut servir, avec l’aide de deux petites métisses, des tasses d’eau chaude additionnée d’une chose appelée thé.
Hélène affectait de s’occuper de la bonne marche du service, pour évoluer parmi ces hommes qui la suivaient de leurs yeux avides, tandis que leurs mains tremblantes répandaient sur les soucoupes le contenu de leurs tasses. Ses trois admirateurs essayèrent à plusieurs reprises d’entrer en conversation avec elle; mais elle savait si bien les évincer, sans la moindre brusquerie, qu’ils finissaient par causer avec le marquis. Par contre, la marquise recherchait le seul homme qui n’eût pas essayé de lui parler. Elle réussit enfin, après diverses manœuvres, à s’asseoir à une extrémité du salon, près de Robledo.
—Il est certain que Watson n’a pas voulu venir, dit-elle à l’Espagnol. De plus en plus, je comprends que je ne lui suis pas sympathique... et à vous non plus.
Robledo eut un geste pour se défendre de cette{136} accusation, mais il ne dit rien; elle insista, se prétendit victime de l’injuste antipathie des deux associés, et l’ingénieur finit par répondre:
—Nous sommes, Watson et moi, des amis de votre mari, et nous sommes effrayés de voir avec quelle légèreté vous laissez les gens qui viennent vous rendre visite concevoir des espoirs que je veux croire vains.
Hélène se mit à rire; les paroles de Robledo, prononcées d’un ton plein de gravité, semblaient l’amuser.
—Ne craignez rien, je ne suis pas née d’hier. Une femme qui connaît le monde comme je le connais n’ira pas se compromettre ni faire une folie pour ces hommes-là!
D’un regard ironique, elle enveloppa ses trois prétendants qui tenaient toujours compagnie au marquis.
—Je ne suppose rien, dit Robledo sans changer de ton. Je vois ce qui se passe; à Paris, j’ai vu aussi bien des choses... et l’avenir me fait peur.
Hélène, indécise, regarda son interlocuteur. Elle ne savait si elle devait rire encore ou se fâcher. Elle parla, enfin, avec l’accent d’une personne qu’on vient d’offenser.
—Je ne suis, je crois, ni meilleure ni pire qu’une autre. Je suis simplement une femme, née pour vivre dans l’abondance et le luxe, et jamais je n’ai trouvé de compagnon capable de me donner ce qui m’est dû.
Robledo la regarda en silence; elle ajouta, baissant la tête:
—Vous ne connaissez pas ma vie. Pendant la meilleure partie de ma jeunesse, j’ai couru après la richesse; quand je croyais la tenir, elle m’échappait et je reprenais ma course... Et ce fut ainsi toujours, toujours!{137}
Un instant encore elle se tut, pour concentrer sa pensée, puis elle reprit sur le ton de la confession:
—Les hommes ne peuvent pas comprendre les angoisses et les ambitions qui torturent les femmes d’aujourd’hui. L’automobile et le collier de perles sont comme l’uniforme de la femme moderne. J’ai eu tout cela plus d’une fois, mais mon bonheur était incertain, fragile, et chaque jour je craignais de tout perdre. Nous avons tous besoin d’entendre chanter l’espérance, pour continuer à vivre; aussi veux-je espérer qu’ici mon mari fera fortune. Quand cela sera-t-il? je ne sais... mais cette pensée me fait supporter mon affreux exil.
Elle continua tristement:
—Et puis, que va-t-il gagner? Peut-être des centimes, quand déjà vous avez amassé des milliers et des milliers de pesos... Ah! j’aurais mérité un autre homme!
Elle releva la tête et sourit mélancoliquement en regardant l’Espagnol.
—Mon bonheur eût été, peut-être, de rencontrer un compagnon comme vous: entreprenant, énergique, capable de dompter la fortune rebelle... Il vous a manqué, à vous aussi, pour assurer votre triomphe, une femme inspiratrice d’enthousiasme.
Robledo à son tour sourit, l’air bon enfant.
—Il est bien tard pour parler de ces choses.
Mais elle le regarda dans les yeux, tout en protestant contre ce découragement.
—Il n’est jamais trop tard pour agir dans la vie. Les hommes énergiques sont semblables aux terres exubérantes des tropiques, qui connaissent la mort, jamais la vieillesse, car un printemps infatigable y fait lever une vie toujours nouvelle. Ils disposent de la volonté qui commande l’imagination; et l’imagination, comme un peintre fou, répand sur la toile grise de la réalité les couleurs éclatantes de sa palette.{138}
Tout en parlant, Hélène avait approché son visage de celui de Robledo. Ses yeux semblaient vouloir pénétrer ceux de l’Espagnol; un moment, il se troubla, mais il se reprit aussitôt et secoua la tête.
—Ce que vous dites, chère amie, est sans doute fort intéressant; mais les hommes vraiment énergiques évitent de compliquer leur existence en ressuscitant des printemps trompeurs.
Ils continuèrent à parler. Elle voulut revenir sur son passé.
—Si je vous contais mon histoire! Toutes les femmes sont persuadées que leur vie fut un roman et que pour passionner le monde entier, il suffirait de la raconter avec quelque adresse. Pour moi je ne prétends pas que mon passé ait été intéressant; il fut, je crois, seulement attristé par la disproportion qui toujours exista entre ce que je crois mériter et ce que la vie a voulu m’accorder.
Un instant elle se tut, comme saisie d’une pensée pénible.
—N’allez pas croire que je sois une de ces parvenues qui ont faim de plaisirs et de luxe parce qu’elles ne les connurent jamais. Au contraire, si j’ai besoin d’argent et de luxe pour vivre, c’est que je les ai possédés en naissant. Mon enfance fut riche et ma jeunesse pauvre. Quels combats j’ai dû livrer pour recouvrer mon rang d’autrefois et pour me faire une existence conforme à mon éducation première! Et la lutte continue... les catastrophes se multiplient... et chaque fois je me retrouve plus éloignée du point d’où je suis partie. Me voici dans un des coins les plus ignorés de la terre; je suis réduite à vivre presque comme les premiers êtres que l’histoire connaisse; et vous me faites des reproches!
Robledo s’en excusa.
—Je suis votre ami et celui de votre mari; je{139} me contente de vous prévenir que vous prenez une mauvaise voie. Vous jouez avec ces hommes un jeu dangereux.
Il montrait les trois hauts personnages de la Presa qui continuaient à causer avec Torrebianca.
—D’ailleurs avant votre arrivée, la vie était ici monotone, sans doute, mais calme et fraternelle. Votre présence semble avoir transformé ces hommes; ils se regardent en ennemis et j’ai peur que leur rivalité, un peu puérile aujourd’hui, ne tourne à la tragédie. Vous oubliez que nous vivons bien loin de tous les groupements humains, et que cet isolement nous ramène peu à peu à la vie barbare. Nos passions, que l’existence des villes avait domptées, secouent ici le joug de l’éducation et se déchaînent librement. Prenez garde, il est dangereux de jouer avec elles.
Hélène se moqua de ses craintes et sourit, un peu méprisante; elle ne pouvait admettre cette pusillanimité chez un homme aussi fort.
—Ne m’enlevez pas ma cour. J’ai besoin d’être entourée d’admirateurs, comme les grands artistes orgueilleux. Que deviendrais-je si je n’avais même pas le plaisir d’être coquette?
Puis, elle ajouta, le sourcil froncé, la voix dure:
—Que faire ici? Vous avez pour vous distraire votre travail, vos luttes contre le fleuve, les exigences des ouvriers. Moi, je m’ennuie tout le jour; certains soirs j’ai eu parfois l’idée de mourir; du moins, la nuit tombée, je retrouve mes admirateurs, mon exil se fait plus supportable... En tout autre lieu, peut-être aurais-je ri de ces hommes; ici, ils m’intéressent. Ils sont pour moi, dans ce désert, comme une heureuse trouvaille.
Son regard se dirigea, avec une ironie souriante, vers ses trois soupirants.
—Ne craignez rien, Robledo, je ne perdrai pas{140} la tête pour eux. Je me rends bien compte de ma situation.
Elle se comparait à un voyageur, armé d’un revolver, mais avec une seule cartouche, et que les rôdeurs de la Cordillère attaquaient, dans la traversée du plateau patagon. S’il faisait feu, il ne tuerait qu’un seul ennemi; les autres se jetteraient sur lui, le voyant désarmé. Il valait mieux gagner du temps, en les menaçant tous, sans tirer.
—Je ris à la seule idée que je pourrais me décider pour l’un d’eux. Ce ne sont pas ces hommes-là qui me feront tourner la tête. D’ailleurs, même si l’un des trois venait à m’intéresser, je resterais prudente. Que diraient ou même que feraient les autres en se voyant mis à l’écart. J’aime mieux leur laisser à tous le bonheur incertain que donne l’espérance.
Elle remarqua que sa longue conversation avec l’Espagnol faisait naître un malaise et scandalisait les autres invités. Elle se leva.
—Qui va me donner une cigarette?
Tous trois s’avancèrent à la fois, offrant leurs étuis, et l’entourèrent; on eût dit qu’ils étaient prêts à se battre, pour s’arracher ses paroles et ses gestes.
La première soirée de la marquise de Torrebianca ne prit fin qu’après minuit, chose inouïe dans ce désert. Seules, les fêtes au bar du Gallego s’achevaient aussi tard, certains samedis où les ouvriers avaient touché la paie de la quinzaine.
Le lendemain, Sébastienne eut toute la matinée les yeux lourds de sommeil et les pieds gourds. Elle s’était levée à l’aube, comme d’habitude, après avoir attendu, pour se coucher, que le dernier invité fût parti.
Elle se tenait sur une des galeries extérieures et grondait à voix basse les petites servantes métisses qui{141} risquaient d’éveiller la maîtresse, en procédant bruyamment au nettoyage de la maison. Soudain, elle parut oublier sa colère et s’abrita d’une main les yeux pour mieux voir un cavalier qui faisait cabrer son cheval au milieu de la rue et agitait un bras pour la saluer.
—Ma jolie demoiselle!... Je n’arrive jamais à la reconnaître avec son costume de petit homme. Comment allez-vous?
Rapidement, elle descendit les marches de l’escalier de bois et traversa la rue, pour aller au-devant de Celinda Rojas.
Elles ne s’étaient pas revues, depuis le jour où Sébastienne avait quitté l’estancia; par haine de don Carlos la métisse crut devoir étaler les splendeurs de sa nouvelle situation.
—C’est une grande maison, mademoiselle, soit dit sans vouloir critiquer la vôtre. L’argent y coule comme l’eau, et puis, la patronne, une gringa très bien, on dit qu’elle est née marquise, là-bas dans son pays. L’Italien, qui est pire que le diable pour rogner des sous aux ouvriers, devient à moitié fou quand il s’agit de faire plaisir à cette belle dame, et il s’arrange pour qu’elle ne manque de rien. Hier, elle a donné une réunion, avec de la musique. Je pensais à vous, ma jolie petite, et je me disais «Comme ma petite patronne serait heureuse d’entendre chanter cette marquise!»
L’amazone l’écoutait, en approuvant de la tête; le récit avait sans doute excité sa curiosité.
Pour l’éblouir davantage encore, Sébastienne énuméra toutes les personnes qui avaient assisté à la fête.
—Tu n’as pas oublié quelqu’un? demanda Celinda quand elle eut fini de débiter sa liste. Tu n’y a pas vu don Ricardo, l’homme qui travaille aux canaux avec don Manuel?{142}
La métisse secoua la tête.
—Le gringo n’a pas paru de la soirée.
Puis elle se mit à rire, en appliquant sur une de ses cuisses de pachyderme des claques qui mettaient en évidence, sous la jupe légère, ses puissantes rondeurs.
—Oui, oui, je sais, je sais, fillette... On m’a parlé de l’affaire; on vous voit tous les jours ensemble, à cheval, dans ces parages, le gringo et toi, et vous ne laissez pas passer un jour sans vous rencontrer... Si quelquefois vous vous embrassez, cherchez un endroit bien caché. Attention, les gens d’ici sont très bavards et ne perdent pas une occasion de jaser. Et puis, méfiez-vous des hommes qui surveillent les travaux, ils ont de ces lunettes qui font tout voir de loin.
Celinda rougit et fit mine de protester.
—Oh! mais je trouve cela très bien, continua la métisse. Ce don Ricardo est un bon et beau garçon; il fera un fameux mari pour vous, si don Carlos, avec le fichu caractère que le bon Dieu lui a donné, ne se met pas en travers. Les gringos d’Amérique sont de braves gens, quand ils ne boivent pas. J’ai une amie qui s’est mariée avec un qui est mécanicien et elle le mène où elle veut, par le bout du nez. J’en connais une autre qui...
Mais ces histoires n’intéressaient pas l’amazone:
—Alors, dit-elle, don Ricardo n’est pas venu, hier au soir?
—Ni hier, ni avant-hier. Il n’a encore jamais mis les pieds ici.
Sébastienne la regardait avec malice, et un sourire plein de bonté dilatait son visage joufflu et cuivré.
—Jalouse déjà, petite? Allons, il n’y a pas de quoi rougir. Nous sommes toutes pareilles, quand nous aimons un homme. On commence par penser{143} que quelqu’un va nous l’enlever... mais rien à craindre pour vous. Vous êtes une perle, patroncita[21]. La dame est belle aussi, surtout quand elle vient de se peigner et de se mettre sur la figure toutes ces choses qui sentent bon, et qu’on lui porte de Buenos-Ayres. Mais à côté de vous... rien à faire! Je l’ai presque vue naître, ma petite fillette; quant à la marquise, elle ne doit plus savoir quand elle est née.
Puis, pour ne pas trop se vieillir elle-même, elle crut devoir ajouter:
—A vrai dire, la marquise ne doit pas être si âgée, mais qui ne paraîtrait pas vieille à côté de vous, mon trésor? Ah! tout le monde ne peut pas être un bouton de rose!
Un instant, elle cessa de parler pour regarder de côté et d’autre, puis, baissant la voix et se dressant sur la pointe des pieds, elle dit avec toute la joie d’une commère qui peut cancaner en paix:
—Il faut que vous sachiez, ma jolie, que beaucoup de gens lui courent après; mais pas don Ricardo. Le pauvre gringo se contente de vous aimer, vous, mon petit jasmin. Les autres suivent la marquise... au pas! comme des autruches: le capitaine, l’Italien, l’homme aux papiers, tu sais, l’employé du gouvernement; ils sont tous fous et se regardent en chiens de faïence! Et le mari n’y voit rien; quant à elle, elle se moque de tous et elle s’amuse à les faire souffrir... Je crois que pas un des hommes qui viennent à la maison ne lui plaît.
Ces paroles ne semblaient pas rassurer Celinda: au contraire elle s’en effrayait mentalement, car elle pensait: «Watson, on ne peut pas le comparer aux autres.»{144}
Elle sentit le besoin d’exprimer son idée.
—Oui, les autres ne lui plaisent pas peut-être, mais don Ricardo est plus jeune qu’eux tous, et ces femmes qui ont connu le monde et qui commencent à vieillir ont parfois de telles... fantaisies.{145}
Le fameux Manos Duras vivait sur la bordure du haut plateau, face à la Pampa. Il apercevait au loin, devant lui, les limites de la Patagonie, et à ses pieds la vaste et tortueuse coupure du fleuve, avec un coin de l’estancia de Rojas.
Sa maison, construite en briques crues, était entourée de cahutes plus misérables encore et d’enclos formés de quelques vieux madriers fichés en terre, où l’on ne voyait que de loin en loin paître des animaux.
Tout le monde connaissait, dans le pays, l’emplacement du rancho[22] de Manos Duras; mais bien peu y étaient allés, car l’endroit avait mauvaise réputation. Ceux qui passaient, inquiets, par ces parages, n’étaient rassurés que s’ils trouvaient les lieux déserts. Alors les chiens au pelage hirsute, aux yeux sanglants, aux crocs aigus, compagnons habituels du gaucho, n’accouraient pas en aboyant,{146} vers le chemin. On ne voyait pas davantage ses chevaux tondre l’herbe maigre des environs.
Manos Duras était parti. Peut-être était-il en maraude le long des rives du rio Colorado, où le bétail était plus abondant que près du rio Negro; peut-être poussait-il jusqu’aux contreforts des Andes, pour aller retrouver ses amis de la vallée de Bolson, peuplée surtout d’aventuriers chiliens, ou bien ceux qu’il avait sur les berges des lacs andins. Ces excursions dans la Cordillère, chuchotaient les gens, lui servaient à vendre au Chili les animaux volés en Argentine.
D’autres fois le rancho de Manos Duras présentait une animation extraordinaire. Des gauchos errants s’installaient pendant quelques semaines dans les cahutes d’argile, et nul ne savait avec certitude d’où ils venaient ni où ils s’en iraient, en quittant le pays. Ces visites mettaient fort mal à l’aise le commissaire de la Presa qui craignait chaque matin d’apprendre qu’un vol avait été commis... Cependant, les jours passaient, sans que rien vînt troubler la paix du village ni des environs. Chez Manos Duras, on tuait et on écorchait les bêtes; le gaucho vendait la viande dans tout le pays; mais comme nulle plainte ne parvenait à don Roque, celui-ci se gardait bien de rechercher la lointaine provenance des animaux.
Un beau jour, les compagnons de Manos Duras se dispersaient; lui, continuait sa vie solitaire, ou disparaissait aussi pendant quelque temps, à la grande joie du commissaire.
Il vivait, en ce moment, avec trois laconiques compagnons aux faces sinistres qui, d’après les commérages du cabaret, étaient descendus d’une vallée de la Cordillère.
—Trois hommes de bien qui ont eu des malheurs, disait le gaucho, en parlant d’eux, trois bons{147} amis qui sont venus habiter mon rancho en attendant que les méchants se lassent de les calomnier.
Un jour qu’il faisait très chaud, Manos Duras monta à cheval pour aller faire quelques achats au camp. On était aux premières heures de l’après-midi. C’était l’hiver en Europe; ici, régnait le terrible été d’un pays sec, au climat extrême.
La terre déserte paraissait trembler sous le soleil. La réverbération faisait onduler les lignes droites et déplaçait les contours des collines, des édifices et des êtres. Parfois aussi, sous cette lumière capricieuse, les objets apparaissaient doubles et renversés. Dans ce pays sans une goutte d’eau, on croyait les voir se refléter dans d’immenses lacs. C’étaient les mirages du désert, dont la forme est si changeante et si imprévisible qu’elle parvient même à étonner les fils du pays, habitués cependant à toutes les illusions d’optique.
A l’extrémité lointaine de la coupure ouverte par le fleuve, presque au niveau de l’horizon, se traînait comme un long ver noir, un flocon cotonneux en avant.
Manos Duras fit halte pour mieux voir. Ce n’était par le courrier de Buenos-Ayres.
—C’est sans doute un train de marchandises qui vient de Bahia Blanca, se dit-il.
On le voyait quoiqu’il fût encore à bien des kilomètres de la Presa, qu’il allait dépasser d’autant, pour ne s’arrêter qu’à Fort Sarmiento.
Les yeux acquéraient, dans cette plaine, une puissance plus grande; la rétine embrassait de plus vastes étendues et les distances semblaient moindres qu’en d’autres pays.
Le gaucho contempla un instant la marche du convoi lointain, puis il remit son cheval au galop. Pour raccourcir sa route, il avait coutume de tra{148}verser un grand morceau des domaines de Rojas, qui s’avançait entre son rancho et l’agglomération éloignée.
Avec l’indifférence de l’habitude, il laissa son cheval suivre un sentier tortueux à peine tracé parmi les broussailles.
Mais il fit cette fois une fâcheuse rencontre. Don Carlos Rojas était sorti, lui aussi, pour visiter son estancia; il ruminait en marchant des projets pour l’avenir.
Les terres hautes resteraient toujours aussi pauvres et ne pourraient nourrir qu’un petit nombre d’animaux. Les jeunes taureaux étaient «criollos[23]» comme il disait lui même, avec quelque mépris; osseux, aux sabots durs, aux longues cornes, la chair parcheminée, forcés de se contenter d’une herbe grossière et peu abondante, ils étaient les descendants dégénérés du bétail que les colonisateurs espagnols avaient acclimaté là, des siècles auparavant, l’amenant à travers l’Atlantique sur leurs minuscules vaisseaux.
Plein de remords, il se rappelait les animaux de luxe de l’estancia de son père, ces taureaux énormes, l’échine plane comme une table, aux cornes diminuées, aux os recouverts de chairs opulentes. C’étaient disait-il lui-même, de véritables montagnes de biftecks... Alors il se prenait à imaginer la fécondité future de ses terres basses que les miracles de l’irrigation allaient bientôt fertiliser.
Elles prodigueraient la luzerne avec autant d’abondance que la terre de Chanaan, et il pourrait nourrir au bord du Rio Negro un de ces merveilleux troupeaux comme on en voit dans les estancias voisines de Buenos-Ayres. Le rude et maigre bétail du{149} pays céderait la place à de superbes animaux, dus aux croisements des meilleures races de la terre.
Don Carlos cheminait, tout en rêvant à cette transformation magnifique avec la volupté d’un artiste qui polit dans son esprit l’œuvre future, lorsqu’il vit venir vers lui un cavalier.
Il plaça sa main au dessus de ses yeux pour mieux le voir et frémit de colère:
—Le diable m’écrase si ce n’est pas ce voleur de Manos Duras!
Le gaucho, en passant près de lui, porta une main à son chapeau pour le saluer; puis il éperonna son cheval.
Don Carlos hésita un instant, puis mit au galop sa monture qu’il poussa devant Manos Duras pour lui barrer le passage et le forcer à s’arrêter.
—Qui vous a permis de traverser mes terres? demanda-t-il d’une voix sifflante et que la colère faisait trembler.
Les gens qui traitaient ainsi Manos Duras n’obtenaient ordinairement d’autre réponse qu’un regard plein d’insolence et de silencieuse menace. Cette fois, ses yeux hardis évitaient de rencontrer le regard de l’estanciero et il répondit d’une voix égale, comme pour s’excuser.
Il savait bien qu’il n’avait aucunement le droit d’emprunter ce chemin, sans l’autorisation du maître de ces terres; mais il évitait ainsi un long détour en se rendant à la Presa.
Il ajouta, argument sans réplique:
—Et puis, don Carlos, vous laissez passer tout le monde.
—Oui, mais pas toi, répondit Rojas, furieux. Si je te rencontre encore dans l’estancia, c’est avec une balle que je te saluerai.
A cette menace Manos Duras dépouilla toute affec{150}tation de respect. Il regarda Rojas d’un air méprisant et dit en pesant sur les mots.
—Vous êtes un vieux, sans quoi vous ne parleriez pas ainsi.
Don Carlos tira son revolver de sa ceinture et le braqua sur la poitrine de Manos Duras.
—Et toi, tu es un voleur de bétail, dont tout le monde a peur, je ne sais trop pourquoi. Si jamais tu voles encore une de mes bêtes, le vieux que je suis se chargera de te régler ton compte.
Le gaucho n’osa porter la main à ses armes, car l’estanciero le visait toujours avec son revolver et l’expression de son visage laissait voir clairement qu’il n’hésiterait pas à mettre ses menaces à exécution. Sûr de recevoir une balle au premier geste suspect, le bandit se contenta de dire en le regardant avec des yeux pleins de rancune:
—Nous nous retrouverons, patron, et nous causerons plus à notre aise.
Sur cette promesse, il piqua son cheval et partit au galop sans tourner la tête, tandis que don Carlos restait immobile le revolver à la main.
Près du fleuve, le gaucho fit une rencontre plus agréable. Un groupe de cavaliers s’avançait; il fit halte pour les reconnaître. C’était la marquise de Torrebianca, en amazone, escortée de Canterac et de Moreno.
L’ingénieur l’avait à nouveau pressée de venir contempler les progrès des travaux du barrage; elle n’avait pas pu se dérober plus longtemps. Dans l’intérêt de sa tranquillité, il importait qu’elle rétablît l’équilibre entre Pirovani et le Français. Ce dernier n’avait pas de maison à offrir; il voulait du moins prouver à Hélène que, directeur des chantiers du fleuve, il était le supérieur de cet Italien, qui devait maintes fois s’incliner devant ses décisions.
L’employé de bureau avait été flatté qu’on l’invi{151}tât aussi; d’ailleurs il était temps à son gré qu’on cessât de le prendre pour un homme de tout repos.
Il venait à cheval derrière Hélène, qui ne s’occupait pas de lui le moins du monde. Elle semblait pourtant se souvenir de sa présence si Canterac devenait trop pressant, s’il tendait la main pour saisir la sienne ou pour se permettre sournoisement d’autres privautés.
—Moreno, ordonnait la marquise, avancez et placez-vous à ma gauche pour que le capitaine garde sa distance. Je n’aime pas les militaires, ils sont trop hardis.
Tous trois s’arrêtèrent de causer pour considérer Manos Duras qui demeurait immobile au bord du chemin. Moreno prononça le nom du gaucho, et Hélène ressentit une telle curiosité qu’elle se décida à lui parler.
—C’est vous le fameux Manos Duras, de qui on m’a dit tant de choses?
Le rude cavalier semblait troublé par les paroles et le sourire de la dame. Il commença par ôter respectueusement son chapeau «comme devant une image sainte» pensa Moreno. Puis il dit avec l’air théâtral qui chez lui était naturel:
—Vous avez devant vous ce misérable, madame, et voici le plus beau moment de ma vie.
Le gaucho la regardait avec des yeux brûlants d’adoration et de désir; elle sourit, heureuse de cet hommage barbare.
Canterac trouvait cette conversation ridicule; avec des gestes d’impatience et des murmures de protestation, il indiquait qu’il entendait poursuivre sa route; elle ne voulut pas l’écouter et continua de parler en souriant à ce gaucho qui l’intéressait.
—Il court sur votre compte des histoires terri{152}bles. Sont-elles vraies? Combien de gens avez-vous tués?
—Pure calomnie, madame! répondit Manos Duras en la regardant fixement. Mais, si vous me le demandez, je tuerai tous les jours qui vous voudrez.
Cette réponse plut à Hélène, qui dit en se tournant vers Canterac:
—Comme il est galant... à sa manière! Vous m’avouerez qu’un pareil hommage ne manque pas d’agrément.
Mais ce dialogue familier entre Hélène et le bandit semblait irriter de plus en plus l’ingénieur. A plusieurs reprises, il essaya de pousser son cheval entre les deux interlocuteurs pour mettre fin à la conversation, mais Hélène l’arrêtait chaque fois d’un geste contrarié.
Voyant qu’elle s’obstinait à causer avec Manos Duras, il se rabattit sur Moreno, incapable de garder pour lui seul sa colère.
—Ce gaucho est un insolent, il faudra lui donner une leçon.
L’employé approuva sans réserves la première partie de la phrase, mais il haussa les épaules en entendant le Français parler de leçon. Que pouvaient-ils contre le nomade redoutable, quand le commissaire lui même lui témoignait une sorte de respect?
—Il vous faut obtenir, continua l’ingénieur, qu’on ne lui achète plus de viande au camp et qu’on n’accepte aucune des affaires qu’il proposera.
Moreno fit un geste affirmatif. S’il ne désirait que cela, c’était facile.
Hélène reprit enfin sa marche après avoir salué le gaucho avec une certaine coquetterie; elle était satisfaite de le voir ému, ses yeux avides brillants de désirs.
—Pauvre homme! c’est un type bien curieux!{153}
Tandis que les trois cavaliers s’éloignaient, Manos Duras demeura immobile près du chemin. Il voulait voir cette femme quelques moments encore. Il avait sur le visage une expression grave et pensive, comme s’il pressentait que cette rencontre allait influer sur son existence. Mais lorsque Hélène eût disparu avec ses compagnons derrière un monticule de sable, le gaucho, que sa présence n’éblouissait plus eut un sourire cynique. Des images lascives défilèrent dans sa pensée, chassèrent ses hésitations et lui rendirent son audace coutumière.
—Pourquoi pas? se dit-il. Elle est toute pareille à celles qui dansent au bar du Gallego. Toutes sont des femmes.
La marquise et ses compagnons continuèrent leur promenade au bord du fleuve. Soudain elle se souleva un peu de sa selle pour voir plus loin.
Dans une prairie que des saules bas bordaient du côté du fleuve, on voyait deux chevaux sellés en liberté.
Un homme et un jeune garçon avaient mis pied à terre et semblaient s’amuser à lancer très haut le lasso. C’était un lasso de corde, léger et facile à manier, mais moins solide que le lasso de cuir qu’employaient les cavaliers du pays.
Son instinct de femme plutôt que ses yeux permit à Hélène de reconnaître le jeune garçon.
C’était la Fleur du Rio Negro qui apprenait à Watson à manier le lasso et qui s’amusait de la maladresse du gringo. Comme Torrebianca allait tous les jours diriger les travaux du fleuve, Richard avait maintenant plus de liberté; il en profitait pour suivre la fille de Rojas dans ses courses vagabondes.
Hélène fit signe à ses deux compagnons de ne pas la suivre et s’approcha de la prairie où se tenaient les deux jeunes gens.
Celinda l’aperçut la première et brusquement,{154} elle tourna le dos avec un mouvement d’hostilité. En même temps, elle ordonna à Watson de lui ajuster un de ses éperons qu’elle avait peur de perdre.
Le jeune homme s’agenouilla, puis il fit mine de se relever; son aide était inutile; l’éperon de Celinda était solidement fixé. Mais elle insista pour le faire rester dans cette position.
—Voyons, gringuito, je vous dis qu’il va tomber. Regardez donc mieux.
Elle ne consentit à reconnaître son erreur et ne lui permit de se relever que lorsque l’autre eut tourné bride. Hélène avait deviné le stratagème et compris les gestes hostiles: elle s’éloigna, piquée.
Les trois cavaliers entrèrent dans la rue centrale du campement un peu après le coucher du soleil. Devant la maison de Pirovani, qu’elle considérait déjà comme la sienne, la marquise descendit de cheval en s’appuyant sur Moreno, car l’Espagnol avait devancé l’autre pour jouir de son agréable contact.
Le Français salua avec une raideur militaire et s’éloigna tandis qu’Hélène entrait dans la maison. Un jour perdu! Il était furieux contre lui-même et contre les autres.
Pirovani parut à l’entrée d’une rue et voyant que Moreno se dirigeait vers son logement il courut à sa rencontre. Il désirait ardemment connaître les péripéties de cette excursion où il n’avait pas été invité. Naïf comme le sont les jaloux il craignait que pendant cette courte promenade Canterac ait pris une grande avance sur lui. Il sourit avec une joie puérile quand l’employé lui raconta comment «madame la marquise» lui avait demandé de se placer entre elle et l’ingénieur français pour le tenir à distance.
—Oh! je sais bien qu’elle ne peut le souffrir,{155} dit l’Italien, j’en ai la preuve... Mais comme il dirige les travaux et rend parfois service à Robledo et à son mari, elle n’a pas osé dire ce qu’elle pense de lui.
Un nuage passa sur son bonheur lorsque Moreno lui parla de leur rencontre avec Manos Duras et de l’amicale conversation du gaucho et de la marquise.
De cela surtout, l’entrepreneur fut scandalisé.
—Nous sommes forcés de vivre ici comme des égaux, parce que nous sommes tous reclus dans le même désert, dit-il avec indignation. Un beau jour ce gaucho voleur se croira en droit d’assister tout comme nous aux réunions du soir chez la marquise. C’est inouï!
—Le capitaine, ajouta Moreno, demande qu’on n’achète plus de viande à Manos Duras et qu’on n’accepte aucune des affaires qu’il pourrait proposer. Mais c’est vous, plutôt que lui, qui pourrez décider la chose.
Pirovani approuva avec véhémence.
—Nous le ferons; le Français a raison... c’est la première fois depuis longtemps que je suis d’accord avec lui.{156}
Quelques mois après le début des travaux à la Presa, les habitants des diverses colonies établies au bord du Rio Negro se mirent à parler avec admiration du nouveau bar du Gallego et le proclamèrent le plus bel établissement de la région. Le propriétaire avait apporté à l’intérieur des améliorations nouvelles aussi instructives qu’intéressantes.
Parmi les premiers ouvriers venus à la Presa se trouvait un Anglais qui pendant ses années d’aventures avait poussé jusqu’au centre sauvage du Paraguay; il en avait rapporté comme uniques bénéfices quatres caïmans empaillés et un boa de plusieurs mètres dont les indigènes avaient bourré le ventre avec des herbes. Il était mort du delirium tremens, quelques semaines après son arrivée, et l’honorable cabaretier, son créancier, s’était emparé des animaux pour en décorer le plafond de sa boutique. En réalité Antonio Gonzalez regardait avec une appréhension héréditaire l’énorme reptile, mais ces ornements d’un nouveau genre plaisaient aux plus notoires ivrognes du pays. Couvert de mou{157}ches, le serpent s’étendait au milieu du plafond et les quatre caïmans se balançaient aux quatre coins, montrant au public leurs ventres jaunes et la plante de leurs pattes. On accourait d’abord pour admirer ces objets insolites. Cependant, la première curiosité passée, le patron du cabaret remarqua que cette décoration n’était pas du goût de tous ses clients. Les Italiens et les Andalous auraient à la rigueur consenti à boire sous la panse jaunâtre des caïmans, mais ils n’osaient plus lever la tête pour vider leur verre de peur d’apercevoir la forme sinistre de l’énorme serpent rongé de mouches. Les plus audacieux ne se décidaient cependant à entrer, que s’ils avaient fermé la main droite, et avancé comme des cornes l’index et l’auriculaire tout en murmurant «Lagarto! Lagarto!» pour conjurer le mauvais sort.
Le Gallego se sacrifia une fois de plus. Le boa fut décroché et vendu à un cabaretier de Buenos-Ayres et seuls les quatre caïmans continuèrent à se balancer au plafond comme des lampes funéraires éteintes.
L’intérieur du cabaret était orné d’une infinité de drapeaux, destinés à flotter tous sur le toit aux jours de fête. Il y avait là, revendiqués par les ouvriers des divers pays du globe, tous les rectangles de couleur que les hommes ont inventés pour se séparer de leurs semblables. Antonio Gonzalez les admettait tous: celui de l’Irlande libre aussi bien que celui de la République sioniste. Il avait eu cependant une sérieuse discussion avec certains compatriotes natifs de Barcelone, qui avaient voulu lui imposer le drapeau catalan.
—Je l’accepte, disait-il avec une solennité diplomatique. Je ne discute que ses dimensions.
Il arrêta enfin qu’il resterait quatre fois plus petit que le drapeau espagnol.{158}
Les jours de fêtes patriotiques il pavoisait sa maison avec l’aide de Fritérini et il donnait des explications au commissaire, seul représentant de l’autorité.
—Vous êtes très savant, don Roque, mais pour ce qui est des drapeaux, je connais mon affaire mieux que personne. D’abord, au-dessus de tous les autres il faut placer celui de l’Argentine; puis à sa droite, sans discussion possible, celui de l’Espagne. C’est nous qui venons après les Argentins dans ce pays. Oui, vous savez bien, Isabelle la Catholique, et Solis et don Pedro de Mendoza et don Juan de Garay... Il citait au hasard, encore, des noms de navigateurs et de conquérants. Et maintenant Fritérini, mio caro, place les autres drapeaux à ton idée car nous sommes tous égaux et cette terre comme dit don Manuel est la terre de tous.
En été les mouches envahissaient la salle du bar. Elles tombaient dans les verres, pénétraient dans les bouches, les narines et les oreilles. Elles se laissaient tuer, mais il y en avait tant que les clients lassés renonçaient à les chasser et se contentaient de cracher ou de souffler quand elles se glissaient dans leur bouche ou leurs oreilles. Des cloisons de bois ou de planches surgissaient aussi des insectes sanguinaires qui perforaient les épidermes et suçaient le sang de l’homme.
En hiver, toutes les portes étaient fermées et l’atmosphère épaisse du cabaret était chargée d’odeurs de tabac, de genièvre, de vin âcre, de linge mouillé et de cuir de souliers. Les règles commerciales les plus illogiques guidaient la marche de l’établissement. Il n’y avait presque pas de chaises dans la salle. Les guitaristes reposaient leur fondement sur des crânes de chevaux et une partie des clients s’asseyaient sur le sol quand la fatigue les{159} prenait; cependant derrière le comptoir, les files de bouteilles de champagne étaient renouvelées sur les étagères chaque semaine.
Les soirs de paie, les ouvriers sans famille instauraient des orgies babyloniennes. Ils arrosaient les boîtes de sardines et de foie gras avec des bouteilles de Pommery-Greno; toute la nuit le whisky et le gin déliaient les langues.
Du reste le pain manquait et il fallait ronger du biscuit dans la semaine. On parlait beaucoup du chemin de fer et on faisait des paris sur le jour où les trains s’arrêteraient enfin régulièrement à la Presa. Dans l’ancien monde les voies ferrées étaient établies entre les villes déjà construites; mais dans ce monde nouveau on lançait d’abord les rails à travers le désert; puis, de cinquante en cinquante kilomètres, on créait une station autour de laquelle un village se développait.
—Pourquoi n’y aurait-il pas une station ici, à la Presa, où nous sommes plus de mille habitants? clamait Antonio Gonzalez, le patron du cabaret. Par contre le train s’arrête à des endroits où il n’y a qu’un cheval attaché à un poteau pour attendre la correspondance. Nous devrions envoyer une délégation à Buenos-Ayres.
Certains groupes causaient à part, sans paraître intéressés par le bal ni par les femmes attachées à l’établissement.
Les défricheurs parlaient de l’alpataco, cet odieux arbuste du pays dont la tête broussailleuse n’atteint qu’une faible hauteur mais qui pousse dans le sol des racines longues parfois de trente mètres. Son bois était dur comme du bronze et faisait rebondir les haches quand il ne les brisait pas. Pour arracher un de ces arbustes il fallait plusieurs hommes et un jour de travail; si les défricheurs qui le{160} rencontraient travaillaient à forfait, ils avaient un fier sujet de jurer et de se lamenter.
Le garçon qui portait le surnom de Fritérini était un jeune homme pâle aux cheveux rejetés en arrière, aux yeux fiévreux; lorsqu’il avait fini de servir les clients, il s’approchait d’une table occupée par quelques ouvriers espagnols et il leur décrivait les beautés de sa ville natale dans un langage d’Italien arrivé depuis deux ans seulement dans le pays.
—Je ne dis pas que qué Brescia sia une grande cita: questo no; ma, quand c’est le soir, les jeunes gens ils vont avec la mandoline faire des serenatas, et chacun a son amore... Oh! plus beau qu’ici... Ah! Brescia!
Le Gallego, accoudé sur le comptoir, écoutait parler les plus vieux des clients, des cavaliers du pays qui avaient chevauché des Andes à l’Atlantique, du Colorado au détroit de Magellan pour guider les acheteurs de bétail ou pour découvrir dans le désert des trous d’eau et des pâturages nouveaux. Leur patience défiait le temps, et les semaines ou les mois qu’avaient duré leurs voyages, ils en parlaient comme de jours.
L’un deux aimait à raconter sa dernière expédition dans les chaînons des Andes méridionales et sa visite aux lacs les plus solitaires. Il avait servi de guide pendant ce voyage à un savant européen que lui adressait un autre savant à qui, vingt années auparavant, il avait rendu le même service. Au cours de la première expédition, ils avaient trouvé des restes d’animaux monstrueux, qui dataient d’une période préhistorique: des squelettes gigantesques qu’ils étiquetaient et mettaient en caisse pour qu’on pût les reconstituer dans les musées de l’ancien continent.
Son dernier voyage avait été plus original. Le deuxième savant recherchait aussi des animaux pré-{161}historiques, mais il prétendait les trouver vivants. Chez les rares habitants campés au pied de la Cordillère, la croyance se perpétuait qu’il existait encore dans certaines régions du désert patagon des bêtes énormes de formes inouïes, derniers vestiges de la faune des époques où la vie apparut sur la planète.
Certains juraient de fort bonne foi avoir vu de loin le plésiosaure s’engloutir dans le cristal mort des lacs andins ou brouter l’herbe qui croît sur les bords.
Mais ils l’avaient vu le soir, quand l’ombre immense et violette de la Cordillère s’étend sur la plaine. Les incrédules soutenaient que cette vision surgissait toujours tandis que l’observateur rentrait avec plus d’un verre dans le corps, de quelque bar lointain.
Le vieux guide exposait le pour et le contre et terminait ainsi:
—En une année entière de recherches nous n’avons jamais rencontré un seul de ces animaux, et pourtant nous avons marché, de lac en lac, du Nahuel Huapi presque jusqu’à Magellan. Mais j’ai vu de mes yeux sur la terre des traces de pieds plus grands que des pieds d’éléphants, que les habitants de l’endroit nous montraient. J’ai vu aussi au bord d’un lac des masses d’excréments séchés aussi hautes que moi, et qui ne pouvaient provenir d’aucune bête connue. Quand je l’interrogeais, mon savant se taisait, sans dire oui ni non. Qui sait ce que nous aurions trouvé si nous étions restés là-bas plus longtemps! Peut-être quand les habitants deviendront plus nombreux dans ces contrées découvrira-t-on un de ces monstres solitaires.
Le patron du bar aimait lui aussi interroger ses plus vieux clients au sujet de certains hommes mystérieux qui étaient passés dans le pays aux premiers{162} temps de la domination, tout juste après l’expulsion des Indiens.
C’étaient des personnages de sang royal, devenus des vagabonds pour connaître l’âpre volupté d’une liberté sauvage.
Le Gallego avait lu dans des livres et des journaux l’histoire de Jean Ort, cet archiduc d’Autriche, qui avait renoncé à son titre pour parcourir les mers sur son yacht luxueux plein de belles femmes et de musiciens.
Un jour le bruit avait couru que le bateau s’était perdu corps et biens au cap Horn. Mais Jean Ort n’était pas mort.
—Je l’ai connu, disait un ancien de la Presa; c’était un homme comme vous et moi, ni plus ni moins, un de ceux qui arrivent avec leur sac sur le dos pour demander du travail. Il était grand, blond et il buvait toujours seul. Il n’avait jamais dit à personne qu’il s’appelait Jean Ort, mais nous le savions tous. D’ailleurs il portait dans son sac un gobelet d’argent avec l’écusson royal de sa famille et il aimait à s’en servir pour boire tout seul dans son petit rancho parce que c’était celui qu’il avait tout enfant quand il allait à l’école. Puis brusquement ce vagabond avait disparu. Certains supposaient qu’il se cachait dans les pires quartiers de Buenos-Ayres; d’autres assuraient l’avoir rencontré à Paysandu où il s’était établi photographe. Nul ne savait où il était mort.
—Des blagues! disaient les sceptiques en écoutant ces récits. Tous les gringos qui viennent par ici sans avoir envie de travailler posent au Jean Ort pour se faire admirer des imbéciles.
D’autres consommateurs, ceux d’aspect aisé, s’inquiétaient de l’avenir de ce village naissant. Le sort en était lié à celui de ce Gonzalez qui pour l’heure étalait à l’air sa poitrine velue, dépeigné, souillé de{163} poussière, les manches retroussées et fixées par des élastiques pour lui dégager les mains. Le garçon lui-même avait meilleure apparence que le patron, mais celui-ci avait en dépôt au «Banco español» de Bahia Blanca des économies et quelques milliers de pesos, et de plus il était propriétaire de mille hectares de terrain aux environs du campement.
Mais qu’était cette prospérité actuelle en comparaison des millions de pesos qui allaient lui échoir le jour où la Presa, aujourd’hui simple camp de travailleurs, deviendrait une agglomération importante, où son magasin se transformerait en un luxueux établissement comparable à ceux de Buenos-Ayres, où les terres poudreuses qu’il avait acquises donneraient une infinité de parcelles pour lesquelles les colons italiens et espagnols lui verseraient d’importantes redevances. Ce jour-là, il pourrait revenir dans sa patrie et s’installer à Madrid. Pourquoi ne serait-il pas, alors, député ou sénateur? Peut-être même le ferait-on vicomte ou marquis comme tant de cabaretiers enrichis en Amérique!
Il arrêtait bientôt le cours ambitieux de ses pensées pour revenir à la rude réalité qui l’entourait encore. Devant ses clients, intéressés comme lui à l’irrigation des terres, il dénigrait leur aspect actuel pour rendre plus frappant le contraste avec leur prospérité future.
—Qu’y a-t-il ici, si on met à part les habitants de la Presa? Des autruches et des pumas, voilà tout.
Ses auditeurs se divertissaient au souvenir des bandes d’autruches qui descendaient du plateau jusqu’au bassin du fleuve, attirées sans doute par ce spectacle nouveau: les travaux effectués par l’homme au bord de l’eau.
La demoiselle de l’estancia de Rojas s’amusait à poursuivre ces troupeaux de bêtes haut perchées qui s’enfuyaient en ouvrant largement le compas de leurs{164} pattes solides; parfois le lasso de l’amazone les atteignait à la course.
Le puma, poussé par la faim, descendait lui aussi des hauteurs pendant l’hiver et venait rôder autour des ranchos et des baraques de la Presa.
Quand on parlait du puma quelques clients se mettaient à sourire en regardant Fritérini. Un beau matin, le garçon qui était sorti dans la cour du bar avait vu bondir du fond d’un tonneau vide une espèce de tigre tacheté, de la grosseur d’un chien. C’était un puma qui s’était blotti dans ce refuge pour dormir et pour l’effroi du nostalgique évocateur des sérénades de Brescia.
—Quand nous aurons de l’eau, disait Gonzalez, quand nous pourrons enfin irriguer nos terres, des milliers d’hommes viendront vivre ici.
Comme lui, ses rustiques clients prenaient sans effort un accent plus que lyrique pour célébrer les merveilles de l’eau. Pas très loin de la Presa, se trouvait Fort Samiento, où l’on allait prendre le train. Ce village avait poussé autour d’un fortin de l’époque de l’expulsion des Indiens. L’armée d’occupation avait ouvert sans peine un petit canal en profitant de la pente du fleuve, et l’eau avait fait de l’endroit une oasis prodigieuse au milieu des terres desséchées. Des peupliers énormes protégeaient de leur muraille les enclos. La vigne, tous les légumes et tous les arbres fruitiers poussaient à profusion dans cette terre vigoureuse qui commençait à procréer après des milliers d’années de sommeil. Sa richesse étonnait davantage par son contraste avec le désert qui s’étendait de nouveau au delà des points où les canaux poussaient leurs ramifications dernières.
Mais les gens de la Presa admiraient surtout une autre oasis située à quelques lieues en aval, en un point où le fleuve subissait une dénivellation naturelle{165} qui avait permis de pratiquer facilement une saignée pour l’irrigation.
C’était un Basque qui avait ouvert là sans peine des canaux et conduit l’eau sur des lieues et des lieues de terre plantée de luzerne.
La qualité de cette pâture excitait l’admiration des clients du bar. Tous croyaient avec ferveur aux miracles de la luzerne bien arrosée. Il suffisait dans le territoire de Rio Negro de semer, une fois pour toutes, cette plante d’origine asiatique. Les champs de luzerne abondamment pourvus d’eau étaient perpétuels. A Fort Sarmiento on en trouvait qui dataient de l’époque qui avait immédiatement suivi l’expulsion des Indiens, et après trente et quelques années d’existence ils étaient meilleurs que le jour des semailles. On les fauchait et la plante repoussait plus vigoureuse et plus luxuriante.
—Si l’homme pouvait manger de la luzerne, déclarait sentencieusement le Gallego, la question sociale serait résolue pour toujours car chacun sur la terre aurait largement de quoi manger.
Malheureusement les animaux seuls pouvaient s’assimiler cet aliment merveilleux. Les brebis que le Basque laissait paître dans ses champs semblaient des bêtes d’une autre planète où quelque nourriture miraculeuse eût donné aux êtres une taille exagérée.
—On dirait des animaux vus à travers des jumelles grossissantes, disait le cabaretier.
Son riche compatriote le Basque, fier de ses prés immenses et de ses brebis énormes comme des mâtins, aimait à dire aux vagabonds qui passaient en bordure de sa propriété:
—Si tu arrives à prendre ce mouton sur ton dos, je te le donne. Mais l’homme malgré ses plus grands efforts ne parvenait pas à soulever la lourde bête. Lorsqu’il recevait un hôte, le Basque lui offrait un{166} dindon à la broche. Et l’invité, à le voir sur la table se trompait, le prenait pour un agneau rôti.
Le patron du bar rêvait d’égaler quelque jour la richesse de son compatriote en créant d’immenses champs de luzerne. Et tandis qu’il s’entretenait de ces pâturages fameux avec d’autres propriétaires qui escomptaient eux aussi l’irrigation de leurs terres désertes, les heures de la nuit passaient rapidement. Ils éprouvaient les mêmes émotions qu’un enfant lorsqu’il écoute à la veillée quelque conte prodigieux.
—Quand verrons-nous la terre de nos champs rougir et se couvrir d’eau comme l’argile dont nous faisons des briques.
Cette pensée les jetait dans l’extase. Puis ils regardaient l’horloge. Il était tard; il fallait se coucher, pour être levé demain à l’aube. Tous en quittant le cabaret tournaient instinctivement leur regard vers le fleuve sombre qui depuis des milliers d’années glissait en silence au milieu des terres stériles en leur refusant sa caresse génératrice de tant de merveilles.
En attendant l’heure où il serait millionnaire grâce à l’irrigation, le patron du bar tirait un de ses plus sûrs revenus des courses de chevaux qu’il organisait certains dimanches. Il fallait pour cela l’autorisation de don Roque, et il n’était pas facile de l’obtenir.
Le commissaire redoutait ses supérieurs. Le gouvernement fédéral avait défendu ces fêtes dans le territoire de mœurs primitives car il en résultait toujours des beuveries et des rixes. Mais l’ancien bourgeois de Buenos-Ayres avait besoin, pour se résigner à vivre en Patagonie, de compensations plus douces que son traitement de fonctionnaire; aussi, quand le cabaretier le prenait à part, ses scrupules étaient vaincus.
—Mais, au nom de Dieu, Gallego, pas de réclame {167}pour tes courses! suppliait le commissaire. Qu’il n’y ait pas de tapage, hein; s’il arrivait un malheur et si on le savait à Buenos-Ayres!... Il faut que la fête soit seulement pour les habitants du campement.
Mais l’affaire demandait au contraire une certaine publicité, et de plusieurs lieues à la ronde de nombreux cavaliers commençaient d’arriver l’après-midi du samedi.
Dans le pays les fêtes étaient rares et il fallait profiter des courses de la Presa. La population du camp semblait triplée. Le bar épuisait en vingt-quatre heures la provision de liqueurs du mois.
Manos Duras saluait de nombreux cavaliers venus de ranchos lointains et qui l’avaient parfois aidé dans ses affaires. Tous montaient leurs meilleurs chevaux pour prendre part aux courses.
Les prix offerts par le Gallego n’étaient pas de grande importance: un billet de vingt pesos, des mouchoirs de couleurs vives, un flacon de gin; mais les gauchos, fiers de leurs éperons, de leur ceinture et de leur couteau au manche d’argent, venaient triompher pour l’honneur et pour la gloire et s’en retournaient satisfaits d’avoir pu faire étalage de leur adresse virile devant ces étrangers travailleurs incapables de monter un cheval sauvage.
Ils repartaient rarement le soir même. Ils jugeaient nécessaire de s’attarder un peu pour fêter leur triomphe et le cabaret faisait surtout recette pendant les dernières heures du dimanche. C’était là pour don Roque des heures terribles, et lorsqu’il y pensait il hésitait à accorder de nouveau sa licence, au risque de perdre la petite compensation que lui glissait le Gallego.
Le public ne trouvait pas à se loger dans le bar; il formait des groupes à l’extérieur et Fritérini, aidé par les femmes, entrait et sortait sans arrêt, chargé de bouteilles et de verres. Les guitares accompagnaient les cris et les applaudissements de la foule{168} entassée autour des danseurs. Le commissaire se tenait au large avec ses quatre soldats aux longs sabres, car il savait que sa présence, loin de calmer les esprits, ne servait le plus souvent qu’à les exciter.
Il redoutait surtout les ouvriers chiliens. Pendant les fêtes ordinaires, les Chiliens buvaient avec leurs compagnons de travail; leur ivresse croissait méthodiquement et leur humeur n’en était nullement affectée. Habitués à partager l’existence des ouvriers européens ils chantaient et dansaient la cueca sans que la paix en fût troublée. Tout au plus leur patriotisme agressif montait-il d’un ton à mesure qu’ils absorbaient une quantité croissante de liquide:
—Vive le Chili! criaient-ils en chœur entre deux cuecas. Certains, plus enthousiastes, complétaient l’exclamation et la lançaient dans toute sa pureté classique, comme le font les rotos pendant les fêtes patriotiques ou à la guerre dans les charges à la baïonnette «Vive le Chili... merde!»
Mais les jours de courses, la présence d’étrangers et surtout de ces cavaliers à fière mine, si vains de leurs selles plaquées d’argent, de leurs armes et des ornements métalliques de leurs costumes, semblait faire naître parmi les rotos, gens qui vont à pied, un vague besoin de provocation, par haine et par jalousie.
Soudain les guitares cessaient de vibrer, un fracas de dispute éclatait; par-dessus les glapissements des femmes, un cri de mort; puis un silence profond. Les gens s’écartaient pour livrer passage à un homme aux yeux fous, à la main droite rouge de sang.
—Place, frères, j’ai fait un malheur!
Tous le laissaient passer; nul n’essayait de l’arrêter, pas même le commissaire qui s’arrangeait pour être loin de l’endroit.{169}
C’eût été une infraction aux lois établies par les anciens qui connaissaient mieux la vie que ceux d’aujourd’hui. Le frère du blessé ou du mort ne s’occupait que de l’homme étendu sur le sol et ne tentait pas de barrer la route à l’agresseur. Il avait tout le temps d’aller en quête de celui qui avait «fait un malheur» et, là ou il le trouverait, d’exercer son droit de vengeance en «faisant un malheur» à son tour.
Quand un de ces incidents arrivait, don Roque, oublieux des largesses de Gonzalez, s’indignait:
—Ne t’avais-je pas dit que cela finirait mal, Gallego? Nous allons voir maintenant ce qu’on va dire à Buenos-Ayres. Un beau jour une de tes histoires me fera perdre ma place.
Mais de Buenos-Ayres rien n’arrivait et don Roque ne perdait pas sa place. Il était le seul représentant de l’autorité et d’accord avec son collègue de Fort Sarmiento; on enterrait le mort, lorsque mort il y avait, et si la victime n’était que blessée, elle se laissait soigner et affirmait n’avoir jamais vu celui qui lui avait donné un coup de couteau; elle ne le reconnaîtrait même pas si on le lui présentait.
Quelques mois passaient et la mauvaise volonté de don Roque persistait: «Ouais, Gallego, tu ne m’y prendras plus...»
Mais la générosité du cabaretier dissipait enfin ses craintes et on annonçait une nouvelle course de chevaux.
Si la fête avait pris fin sans rixes, Gonzalez, triomphant, prenait l’offensive:
—Vous voyez bien! cette population est en progrès, on peut avoir confiance en sa tenue et l’histoire de l’autre fois n’était en somme qu’un petit incident.
Pour éviter d’être démenti par les faits, le cabaretier étendait sa générosité à Manos Duras et lui glis{170}sait un billet de banque pour acheter la paix, car le gaucho pouvait tout faire en donnant des conseils de douceur à ses amis et en inspirant la terreur aux autres.
Un samedi soir, Robledo rentrait par la rue centrale après avoir visité ses canaux. En passant devant la maison de Pirovani il détourna la tête et pressa le pas de sa monture de peur qu’Hélène n’ouvrît une fenêtre pour l’appeler. Depuis bien des jours il n’était pas retourné la voir. Il éprouvait cette crainte vague qui annonce l’approche du danger sans qu’on puisse dire de quel côté il menace.
Le campement de la Presa lui paraissait changé depuis quelques semaines. Son aspect extérieur était toujours le même, mais sa vie interne subissait d’inquiétantes transformations. On voyait s’évanouir cette aménité monotone et cette confiance un peu rude qui caractérisaient les relations des habitants entre eux.
Gualicho, le terrible démon de la Pampa, chassé en même temps que les indigènes, venait reconquérir ce pays qui avait été le sien. Robledo se rappela comment les Indiens avaient coutume de combattre le génie du mal dès qu’ils avaient cru remarquer sa présence au milieu d’eux.
Lorsque leurs razzias et leurs coups de main contre les tribus voisines commençaient à échouer, lorsque les maladies ou la famine se déclaraient avec une violence insolite dans leurs villages, tous les cavaliers s’armaient et entraient en campagne pour vaincre le maudit Gualicho.
Ils s’escrimaient contre l’ennemi invisible avec leurs lances et leurs massues appelées macanas; ils lançaient leurs boleadoras, sortes de courroies terminées par deux boules de pierre qu’ils projetaient en l’air et qui allaient s’enrouler autour de l’ennemi; ils accompagnaient de hurlements leurs grands{171} coups d’estoc et de taille, cependant que les femmes et les petits enfants, à pied, s’unissaient à cette offensive générale en frappant l’air de leurs bâtons et de leur poings. L’un de ces coups innombrables toucherait forcément l’esprit malin et l’obligerait à fuir. Lorsqu’enfin tous tombaient sur le sol, exténués, la tranquillité leur revenait, car ils étaient convaincus que l’ennemi s’était éloigné de leur campement.
L’Espagnol pensait qu’en ce moment la Presa devait être hantée par Gualicho le diable malin et trompeur de la Pampa. Il poussait les hommes les uns contre les autres. Tous se regardaient avec hostilité et semblaient se trouver différents de ce qu’ils étaient autrefois. Faudrait-il rassembler la population en masse pour frapper et mettre en fuite l’invisible ennemi?
Il méditait ainsi lorsque soudain son cheval sursauta et s’arrêta si brusquement qu’il faillit passer par-dessus l’encolure.
Au même instant des coups de revolver claquèrent et il vit voler en éclats les vitres des fenêtres et des deux portes du bar.
Par ces brèches passèrent en même temps que les balles des bouteilles, des verres et même un crâne de cheval. Puis des gauchos, amis de Manos Duras, apparurent, marchant à reculons et faisant feu de leurs revolvers. Des ouvriers du village sortirent à leur tour de l’établissement et se mirent à tirer sur eux. D’autres, qui avaient déjà épuisé leurs cartouches, avançaient, le couteau au poing.
Un blessé tomba et se mit à se traîner dans la poussière. Puis, Robledo vit un autre homme s’écrouler. Gonzalez fit son apparition, en manches de chemise comme toujours, avec ses deux élastiques autour des biceps. Il levait les bras, suppliait, lançait pêle-mêle des ordres et des malédictions. Les{172} métisses attachées au cabaret qui offraient leurs charmes après avoir versé de l’alcool, sortirent aussi, épouvantées et hurlantes, pour s’enfuir jusqu’au bout de la rue.
Robledo tira son revolver, éperonna son cheval et vint se placer entre les combattants; il visait alternativement les uns et les autres, tout en criant pour rétablir l’ordre. Aidé par les voisins qui accouraient armés pour la plupart de carabines, il put ramener momentanément la paix. Les gauchos prirent la fuite, poursuivis par les ouvriers de la digue, et les femmes, danseuses de l’établissement ou femmes du village, s’élancèrent ensemble pour entourer les deux blessés et les relever.
Gonzalez, qui protestait à grands cris et que nul n’écoutait, eut un sourire de joie en reconnaissant Robledo, comme si la présence de l’ingénieur eût dû suffire pour tout arranger.
—Ce sont les amis de Manos Duras, dit-il, qui viennent faire du tapage parce qu’on ne permet plus à ce bandit de fournir la viande au village et qu’on l’empêche de traiter d’autres affaires. Il devait y avoir demain course de chevaux; Manos Duras a provoqué cette bataille pour me faire du tort. On dirait que le diable est lâché sur cette terre, don Manuel. Nous étions si tranquilles autrefois.
Tout en sueur et encore ému par le souvenir du combat, il continua à bredouiller des explications. Il reconnaissait que les Chiliens soulevaient parfois des discussions orageuses; mais ce n’était que de temps en temps, à la suite d’excès de boisson. Cette fois ils n’étaient nullement responsables. Pauvre rotos! C’étaient les gens du pays qui, semblant obéir à un mot d’ordre, s’étaient montrés insolents et avaient provoqué les ouvriers pour troubler la tranquillité du village.
—Et cela va durer, don Manuel; je connais Manos{173} Duras. S’il avait voulu de l’argent, il serait venu m’en demander; ce ne serait pas la première fois... Mais il y là-dessous quelque chose que je ne comprends pas et qui lui fait chercher le scandale à tout prix.
On venait de relever les blessés et de les porter dans le bar. Un homme partit à cheval pour ramener le médecin de Fort Sarmiento qui ne visitait la Presa que deux fois par semaine. Des femmes coururent chercher avant son arrivée un ouvrier sicilien qui jouissait d’une grande réputation de guérisseur. Les badauds entraient dans le magasin pour se rendre compte de la gravité des blessures. Au milieu de la rue des commères criaient contre Manos Duras et ses compagnons.
Robledo, pensif, reprit sa marche et se dirigea vers sa maison. Gonzalez avait raison, le diable était lâché. Quelqu’un avait profondément transformé la vie de la Presa.
Le jour suivant il remarqua un grand changement dans les groupes qui travaillaient près du fleuve. Les ouvriers engagés par l’entrepreneur, assis par terre, fumaient ou sommeillaient. Quelques-uns, des Espagnols, chantonnaient en frappant dans leurs mains, et de leurs yeux perdus semblaient contempler la patrie lointaine.
Le contremaître chilien surnommé le Fraile allait d’un groupe à l’autre pour secouer cette inertie, mais il n’arrivait qu’à faire rire les travailleurs. Un des plus vieux lui répondit avec insolence:
—Tu ne penses pas sans doute hériter de l’Italien?... Alors... pourquoi aurais-tu plus d’intérêt que lui à nous faire travailler? Il y a beau temps qu’il n’est pas venu ici.
Un autre journalier, plus jeune, ajouta avec un rire bestial.
—Il court comme un chien derrière la belle{174} gringa qui sent si bon et qu’on appelle la marquise. Oh! moi aussi si je pouvais...
Et il ajouta quelques mots sales, dont les autres rirent avec une expression de désir sauvage. Soudain un jeune apprenti qui, d’une petite hauteur, surveillait les environs, lança le cri d’alarme:
—Un ingénieur!
Immédiatement tous sautèrent sur pieds, cherchèrent leurs outils et feignirent de travailler avec ardeur, tandis que l’Espagnol avançait entre les groupes au pas lent de son cheval.
Ils regardaient à la dérobée Robledo, et dès qu’il s’était éloigné ils laissaient tomber leurs outils et s’asseyaient à nouveau. L’ingénieur tourna plusieurs fois la tête et comme la veille il se dit qu’une puissance occulte bouleversait la vie de la colonie. Gualicho était présent en tous lieux; même hors du village, il faisait sentir sa puissance en désorganisant le travail des hommes.
Laissant derrière lui les nombreux ouvriers de Pirovani il atteignit l’endroit où ses propres journaliers creusaient les canaux. Ces travailleurs-là ne demeuraient pas inactifs. Torrebianca les dirigeait, les surveillait et leur offrait l’exemple de son activité. Il aperçut Robledo et l’entraîna à part comme pour lui communiquer une mauvaise nouvelle:
—L’exemple déplorable des ouvriers de la digue commence à contaminer les nôtres. Nos hommes réclament comme les autres moins d’heures de travail... Je me demande à quoi pense ce pauvre Pirovani. Il laisse ses travaux complètement à l’abandon.
Robledo regarda fixement Torrebianca et resta silencieux, tandis que l’autre continuait à lui donner des informations.
—Hier soir, Moreno me disait que Pirovani et Canterac commencent à se faire la guerre. L’un{175} refuse, comme ingénieur, d’approuver les travaux que l’autre poursuit comme entrepreneur. Il veut lui porter préjudice et retarder les versements que l’Etat lui effectue... Pirovani dit qu’il va suspendre les travaux et se rendre à Buenos-Ayres, où il a beaucoup d’amis, pour porter plainte contre l’ingénieur.
A ces mots l’Espagnol sortit de son indifférence muette.
—Et pendant ces discussions, dit-il avec colère, l’hiver arrive; le fleuve grossira avant que la digue soit terminée, les eaux détruiront et emporteront le travail de plusieurs années, et tout sera à recommencer.
Le marquis, qui semblait tout pensif, s’écria soudain:
—Et ces deux hommes étaient si amis! Certainement quelque chose est venu les séparer.
Robledo dut forcer son regard pour l’empêcher de traduire la pitié et l’étonnement; il fit de la tête un signe affirmatif.{176}
Peu de temps après le lever du soleil, Moreno sortit de sa maison, mandé d’urgence par Canterac.
Il trouva l’ingénieur en train d’arpenter avec impatience son logement. Il avait déjà passé des bottes et une culotte de cheval. Son ceinturon garni d’un revolver et sa vareuse étaient posés sur une chaise.
Les manches de sa chemise entr’ouverte étaient retroussées et on voyait encore sur lui la trace toute fraîche de ses ablutions matinales.
Son visage était plus dur, plus autoritaire que les autres jours. Une idée tenace et importune semblait ancrée sous son front soucieux. Sur les meubles et dans tous les coins on voyait de nombreux paquets élégamment ficelés et cachetés dans leur enveloppe de papier fin.
On devinait que l’ingénieur avait mal dormi par la faute de cette idée dont il voulait faire part à Moreno. Celui-ci prit un siège et se prépara à écouter. Canterac resta debout et dit à l’employé tout en continuant sa promenade:{177}
—Ce Pirovani est tout ce qu’il y a de plus vulgaire, mais il l’emportera toujours sur moi. Il est si riche!
Puis il montra les nombreux paquets qui encombraient une partie de la pièce:
—Voilà tous les parfums que nous avions commandés à Buenos-Ayres. C’est de l’argent perdu; ceux de l’Italien sont déjà arrivés.
Moreno s’empressa de se disculper. Il avait fait le nécessaire pour hâter l’expédition de la commande; mais l’autre, au lieu d’envoyer ses ordres par lettre, avait dépêché un messager à Buenos-Ayres.
Canterac voulait se montrer indulgent; il accepta les excuses de l’employé et lui donna quelques tapes dans le dos:
—Je n’ai pu dormir de la nuit, mon cher Moreno. J’ai conçu un projet et je veux le discuter avec vous. Il faut que j’écrase cet intrigant qui ose se mesurer à moi... Ici tous les gens se croient égaux, comme si toute hiérarchie était abolie dans le monde. Peut-être même cet entrepreneur se croit-il supérieur à moi qui suis son chef; il suffit qu’il ait plus d’argent que moi.
Canterac eut un sourire cruel et continua:
—Je m’arrangerai pour qu’il en ait moins. Jusqu’à ce jour, j’avais toléré certaines choses en contrôlant ses travaux. Dorénavant non: il perdra quelques bons milliers de pesos ou il sera obligé de résilier son contrat et de vider les lieux.
Il s’approcha ensuite de Moreno pour lui parler à voix basse comme s’il eût craint d’être entendu.
—Je veux frapper un grand coup, mener à bien un projet grandiose que cet émigrant sans éducation ne pourrait pas même imaginer. J’y ai pensé hier au soir. Au premier moment cette idée m’a semblé déraisonnable, mais après avoir longuement réfléchi j’ai trouvé que le projet était original et digne d’être réalisé si c’est possible... Pirovani a offert une mai{178}son à la marquise. Moi je lui offrirai un parc... un parc que je ferai surgir en plein désert patagon! Comment trouvez-vous cette idée, mon cher Moreno?
L’employé l’écoutait, attentif, puis avec étonnement, mais il ne sut que répondre. Il lui fallait d’autres explications, et le Français continua de parler:
—Dans ce parc, je donnerai une fête, une garden-party en l’honneur de notre amie la marquise et je m’offrirai cette petite vengeance d’inviter ce rustre enrichi pour qu’il meure d’envie. Vous voudrez bien être assez aimable pour tout diriger. Voici les instructions; j’ai tout écrit hier soir en profitant de mon insomnie.
L’Argentin prit le papier que lui tendait Canterac, le lut et regarda l’ingénieur avec stupéfaction comme s’il eût douté de sa raison.
—Je conçois votre étonnement... Ce sera cher, je le sais, mais n’importe. Dépensez sans crainte, je viens de toucher quelques milliers de pesos que je comptais envoyer à Paris. J’aime mieux faire à la marquise la surprise de mon parc. Je gagnerai de l’argent plus tard, j’ai confiance en l’avenir.
Et il dit cela de bonne foi, avec le doux optimisme de ceux que l’amour entraîne.
Le jour suivant était un dimanche, et Watson se rendit dans la matinée à l’ancienne maison de Pirovani pour y voir Torrebianca. Il avait besoin de lui parler d’une affaire qui intéressait les travaux en cours. Robledo était parti pour Buenos-Ayres deux jours auparavant pour demander aux banques de lui consentir de nouveaux crédits qui permettraient de continuer les travaux et aussi pour vendre des terrains qu’il possédait dans la pampa centrale.
Le jeune homme gravit avec quelque inquiétude le perron de bois après avoir examiné les fenêtres à la dérobée. Il frappa avec précaution à la porte comme s’il tenait à ne pas être entendu par tous{179} les habitants de la maison, et il sourit en voyant que Sébastienne ouvrait la porte.
—Monsieur n’est pas là. Il est parti avec don Canterac pour Fort Sarmiento ce matin. Et don Robledo, comment va-t-il?
La métisse, comme beaucoup de gens dans le pays, plaçait le don indifféremment devant les prénoms et les noms[24].
Watson allait se retirer quand une portière se souleva dans l’antichambre, découvrant une main blanche dont le poignet portait une montre-bracelet. Cette main lui faisait des signes empressés pour le retenir. Puis Hélène apparut tout entière et souriante l’invita à entrer. Richard, intimidé, n’eut pas la force de refuser; il la suivit au salon et il s’assit les yeux baissés.
—Enfin vous voici dans ma maison... Je dois vous être peu sympathique puisque vous ne venez jamais me rendre visite.
Watson balbutia de vagues excuses, mais elle continua:
—Peut-être vous a-t-on dit du mal de moi? N’essayez pas de le nier: il n’est pas étonnant qu’on me traite ainsi. Les femmes sont si souvent calomniées. Nous nous faisons tant d’ennemis en refusant d’accéder à certains désirs!
Hélène avait pris un ton ingénu pour formuler ses plaintes. Elle était tout près de Richard et le jeune homme était troublé par le parfum de sa chair saine et soignée.
—Je suis bien malheureuse, Watson, ajouta-t-elle. J’attendais une occasion opportune pour vous le confier. Vous me croyez coquette et je m’étourdis pour{180} me masquer à moi-même le vide de ma vie. Depuis des années je me sens bien seule!
Richard avait perdu la méfiance qu’il éprouvait tout à l’heure; il l’écoutait avec un intérêt naïf et la croyait:
—Mais votre mari?
A cette innocente question une lueur d’ironie parut trembler dans les yeux d’Hélène. Mais elle dissimula son étonnement moqueur pour répondre avec tristesse.
—Ne parlons pas de lui. C’est un excellent homme, mais il n’est pas le mari qu’il faut à une femme comme moi. Il n’a jamais su me comprendre. D’ailleurs c’est un faible dans la bataille de la vie et moi, qui étais née pour atteindre aux plus hautes destinées, je suis restée ce que je suis et je suis venue échouer dans ce pays presque sauvage, parce qu’il lui manquait les qualités essentielles.
Elle regarda fixement Watson qui, interdit, baissait les yeux, et elle reprit, d’un ton pensif:
—Soyez sûr qu’un homme jeune et énergique serait allé loin avec une femme comme moi à son côté.
Watson leva les yeux, surpris, puis il regarda de nouveau ses pieds pour éviter le regard d’Hélène. La marquise sourit de le voir si craintif et susurra d’une voix mélancolique:
—La vie est ainsi faite: les hommes que nous méprisons nous remarquent et ceux qui nous intéressent nous fuient presque toujours.
A ces mots le jeune homme releva la tête et la regarda sans manifester aucune crainte, avec un air interrogateur. Que voulait dire cette femme?
Il avait peu d’expérience de la vie, et d’autre part, en homme d’action, il aimait peu la lecture, et n’avait pu entrevoir l’existence à travers les livres; il avait cependant parcouru en chemin de fer ou sur{181} les bateaux quelques romans simplistes pleins d’aventures naïvement invraisemblables, et il avait vu une centaine de films cinématographiques; dans les pages de ces romans et sur la toile des cinémas il avait appris à connaître le type de la femme fatale, belle mais perverse, qui détourne du chemin de l’honneur les hommes qu’elle tente. Si la marquise allait être sa femme fatale à lui? Robledo n’avait pas beaucoup de sympathie pour elle...
Mais bientôt il pensa aux héroïnes calomniées et persécutées qui l’avaient souvent ému, dans les mêmes livres et dans les mêmes films; des victimes de ce genre abondaient peut-être dans le monde.
Il regardait toujours la Torrebianca pour tâcher de deviner si elle était une femme fatale ou une créature injustement persécutée; mais elle avait baissé les yeux pour dire avec une douceur attristée:
—J’ai bien souffert quand j’ai compris que vous me fuyiez. Je suis entourée d’êtres égoïstes et grossièrement matérialistes; j’ai besoin d’une affection noble et pure, d’un ami désintéressé, d’un compagnon qu’ait attiré mon âme et non mon corps.
Watson, instinctivement, hocha la tête. Ce mouvement réflexe indiquait qu’il approuvait intérieurement ces paroles. Il commençait à se former une opinion sur cette femme.
—J’ai toujours cru, ajouta-t-elle, que vous pourriez être cet ami idéal. Vous semblez si bon... Hélas! vous me détestez, vous me fuyez, vous me prenez sans doute pour une femme à redouter, comme il y en a tant sur la terre, et je ne suis qu’une malheureuse.
Richard se leva, la main sur le cœur, pour protester avec plus de véhémence. Il n’avait jamais eu d’antipathie pour elle et n’avait jamais cherché à fuir sa compagnie. Il était un gentleman et n’avait jamais eu pour l’épouse de son compagnon Torrebianca que{182} des pensées pleines de respect. Il avouait cependant que jusqu’à ce moment il l’avait mal connue.
—Ce n’est pas extraordinaire. On se parle pendant des années et des années parfois, on croit se connaître, puis un jour, soudain, on se connaît vraiment et on se trouve bien différents de ce qu’on avait imaginé. Pour moi, après ce que je viens d’entendre...
Il se tut, mais son silence et ses yeux exprimaient l’émotion qu’il avait ressentie en écoutant Hélène.
Elle se leva aussi, s’approcha de Watson et lui tendit la main.
—Vous acceptez donc d’être cet ami dont j’ai tant besoin pour continuer à vivre? Vous consentez à devenir mon soutien et mon guide?
Le jeune homme, que son regard troublait, balbutiait des mots indistincts tout en serrant cette main de femme qui s’attardait dans la sienne. La marquise accueillit ces vagues indices d’assentiment avec une joie enfantine.
—Quel bonheur! Vous viendrez me voir tous les jours. Vous m’accompagnerez dans mes promenades à cheval et je ne serai plus suivie partout par ces inévitables soupirants qui m’impatientent sans arrêt.
La joie de la Torrebianca ne fut pas sans étonner Richard. Il n’avait rien promis de tout cela, mais il n’osa protester. Elle semblait ne plus douter que le jeune homme dût être son chevalier servant, et elle eut un rire un peu malicieux.
—Et puis, quand nous sortirons ensemble, vous m’apprendrez à lancer le lasso. Qu’il est beau d’avoir ce talent!
Elle se rendit compte immédiatement que ces paroles étaient inopportunes. Watson avait détourné les yeux et son front parut s’assombrir tandis que défilaient en lui de lointaines images.
Il se rappelait le soir où Hélène l’avait surpris avec{183} Celinda au bord du fleuve alors que la jeune fille lui apprenait à lancer le lasso.
Hélène s’avança plus près encore du jeune homme pour chasser ce souvenir et vint appuyer ses mains sur les revers de sa vareuse. Elle semblait vouloir se mirer dans ses pupilles, et elle concentrait dans ses propres yeux tout son pouvoir de séduction.
—Amis, vraiment, susurra-t-elle, amis pour toujours? Amis malgré la calomnie et l’envie?
Le jeune homme se sentit vaincu par le contact et le parfum de cette femme. Le souvenir des rives du fleuve et des joyeuses leçons que lui donnait Celinda se dissipa. Quelque chose en lui voulut résister encore à cet entraînement. Dans sa mémoire passa le souvenir des fatales héroïnes de romans. Il eut un mouvement comme pour dire non, et il prit dans ses mains celles de la marquise pour les éloigner de sa poitrine. Mais quand ses doigts touchèrent cet épiderme de femme il se sentit défaillir et ses mains pressèrent celles de la marquise en une voluptueuse caresse. Alors, comme les yeux d’Hélène semblaient implorer une réponse aux questions qu’elle venait de poser, il dit «oui» de la tête.
A partir de ce jour, Watson seul accompagna la femme de Torrebianca dans ses promenades à cheval. Devant l’ancienne maison de Pirovani, un métis chargé de soigner les montures de l’entrepreneur tenait par la bride une jument blanche portant un harnachement féminin. Richard arrivait à cheval; Hélène apparaissait au sommet du perron en costume d’amazone, et au même instant l’entrepreneur entrait dans la rue, comme si, dissimulé, il eût attendu jusque-là l’occasion de se montrer.
Il était lui aussi à cheval, mais «madame la marquise» éludait sa compagnie.
—Allez à vos affaires, monsieur Pirovani. Mon mari affirme que vous les négligez beaucoup, et cela{184} me fait de la peine... Monsieur Watson qui est maintenant plus libre m’accompagnera.
L’Italien finissait par accepter avec une certaine reconnaissance ces paroles. Comme cette femme s’intéressait à ses affaires! Elle ne pouvait guère manifester plus clairement la sympathie qu’elle éprouvait pour tout ce qui touchait à sa personne. D’ailleurs Watson était un compagnon qui ne pouvait pas exciter de jalousie, car tout le monde dans le pays le considérait comme le fiancé de la fillette de Rojas... Il se résignait enfin, bien que de mauvaise grâce, à s’en aller visiter les travaux de la digue.
Parfois, quand Hélène était déjà en selle, Canterac se présentait lui aussi à cheval pour l’accompagner. Mais Hélène lui faisait de sa cravache de petits signes de refus.
—Je vous ai déjà dit plusieurs fois que je ne voulais pas d’autre compagnon que mister Watson, lui répondit-elle un jour. Pour vous, capitaine, continuez à préparer cette énorme et mystérieuse surprise que vous me réservez.
Canterac vit les deux cavaliers s’éloigner et quoiqu’il ressentît une soudaine irritation chaque fois qu’Hélène le repoussait, il s’efforça de se surmonter et se dirigea vers la maison de Moreno.
L’employé lisait un roman près de sa fenêtre et, apercevant Canterac, il s’accouda sur l’embrasure pour lui rendre compte de l’avancement des travaux:
—Nous employons pour construire ce parc près de deux cents hommes et quarante charrettes.
L’ingénieur écouta sans descendre de cheval les explications que Moreno lui donnait de sa fenêtre.
—J’ai enlevé ces hommes à Pirovani en leur offrant double salaire. De plus j’ai raflé toutes les charrettes que l’Italien avait louées et toutes celles de{185} Fort Sarmiento. Tout cela retardera un peu les travaux du barrage, mais chacun de votre côté vous tâcherez ensuite de regagner le temps perdu.
Les ouvriers travaillaient à cinq lieues de là, vers l’aval, dans un endroit assez marécageux où les crues avaient fait surgir un bois où dominaient les peupliers. Ils écartaient la terre au pied des troncs et mettaient à découvert les racines pour les trancher au milieu; ils faisaient alors pencher l’arbre et le couchaient sur un char à bœufs qui s’avançait lentement le long de la rive et qui mettait un jour entier pour apporter sa charge à la Presa.
—C’est un travail long et difficile, dit Moreno. J’ai poussé jusque-là hier pour tout voir par moi-même et je vous assure que nos hommes gagnent bien leur argent.
Près de la Presa, dans une plaine nue, voisine du fleuve, d’autres ouvriers creusaient des trous dans le sol. Quand les charrettes apportaient les arbres, ils les redressaient et les plantaient dans les trous puis ils entassaient tout autour de la terre pour les maintenir droits.
—Ce sont des arbres hauts seulement de quelques mètres, mais ils feront un effet extraordinaire dans ce désert où on n’en trouve aucun à leur comparer. Soyez sûr, capitaine, que ce sera une surprise peu commune. L’Italien sera bien forcé d’en convenir.
Canterac eut en entendant ces derniers mots un sourire de satisfaction.
—Vous viendrez à bout de tous vos billets de banque, continua Moreno, il pourrait même arriver qu’avant la fin l’argent nous manque un peu, mais vous aurez votre parc... Il est vrai que ce parc ne vous occasionnera pas de nouveaux frais car le lendemain peut-être de la fête les arbres seront desséchés et morts.
Et l’employé se mit à rire devant l’énormité de ces{186} dépenses inutiles; il admirait et plaignait l’ingénieur tout à la fois.
Cependant, Hélène et Watson chevauchaient lentement sur la berge du fleuve. Elle lui tenait la main et lui parlait affectueusement, d’un air maternel.
—Je m’aperçois, Richard, d’après ce que vous me dites, que Robledo dirige tout ici et que vous êtes un peu comme son employé... Je ne devrais pas m’occuper de vos affaires, mais tout ce qui vous concerne m’inspire tant d’intérêt... Je ne dis pas que l’Espagnol commette des indélicatesses en répartissant les bénéfices; certes non. Robledo est un homme correct, mais il abuse un peu des avantages que lui donne son âge. Il faut vous émanciper de cette tutelle si vous voulez monter jusqu’où vous pouvez prétendre, seul et sans tuteurs.
Richard avait défendu son associé en entendant les premières insinuations; mais le conseil d’Hélène le rendit pensif et préoccupé; il le reçut sans un mot de protestation.
Tandis qu’ils causaient, bercés doucement par le pas lent de leurs chevaux, un cavalier, au fond de la plaine, apparut puis se dissimula à plusieurs reprises, quittant la rive du fleuve pour pénétrer dans les dunes de sable que les inondations avaient laissées à l’intérieur des terres. Ce cavalier qui s’approchait puis s’éloignait d’un galop capricieux était Celinda Rojas.
Hélène remarqua la première ces évolutions et elle sourit d’un air moqueur.
—Je crois qu’on vous cherche, dit-elle à Richard.
Celui-ci regarda dans la direction qu’elle indiquait et, reconnaissant l’amazone, ne put cacher un certain trouble.
—C’est mademoiselle Rojas, répondit-il en rougissant légèrement. C’est une enfant et nous sommes{187} assez bons amis. Elle est pour moi comme une petite sœur, ou pour mieux dire, comme un camarade. N’allez pas vous imaginer...
La Torrebianca qui souriait ironiquement et feignait de ne pas croire à ses protestations lui dit avec une froideur qui l’attrista:
—Allez la saluer pour qu’elle ne vous importune plus de sa surveillance et venez me rejoindre.
Après avoir lancé ces mots d’un ton impératif elle mit son cheval au trot vers l’intérieur des terres, foulant les rudes buissons qui craquaient en se brisant comme du bois sec.
Aussitôt Celinda cessa d’évoluer dans le lointain et elle courut ventre à terre au-devant de Richard. Quand elle fut près de lui, elle le menaça du doigt en imitant l’expression sévère d’un précepteur qui réprimande un élève. Puis elle dit avec une gravité comique:
—Ne vous ai-je pas dit plus de cent fois, mister Watson, que je ne voulais pas vous voir avec cette femme-là? Je passe maintenant des jours entiers à courir la campagne inutilement et si j’arrive enfin à rencontrer monsieur, je le trouve toujours en mauvaise compagnie.
Mais Watson n’était plus le même homme; il ne rit pas de cette feinte colère. Au contraire, il parut froissé par le ton plaisant qu’elle avait pris, et il répondit sèchement:
—Je puis aller avec qui il me plaît, mademoiselle. Il n’existe entre nous qu’une bonne amitié malgré ce que trop de gens supposent à tort. Vous n’êtes pas ma fiancée et je n’ai aucune raison de rompre avec mes relations pour obéir à vos caprices.
Celinda demeura stupéfaite et Richard en profita pour s’éloigner en saluant sèchement, dans la direction qu’avait prise Hélène.{188}
La fille de Rojas se rendit compte que l’Américain s’échappait réellement; elle fit un geste de colère, tout en lui criant des phrases suppliantes:
—Ne partez pas, gringuito. Ecoutez-moi, don Ricardo; ne vous fâchez pas... J’ai dit cela pour rire comme les autres fois.
Watson feignait de ne pas entendre et continuait sa course; elle saisit alors le lasso qui pendait à l’arçon de sa selle, le déroula pour le lancer sur le fugitif.
—Venez ici, désobéissant.
Avec une précision parfaite, le lasso tomba sur Richard et l’emprisonna, mais au moment où Celinda commençait à tirer sur la corde, l’ingénieur prit dans sa poche un canif et trancha la boucle. Son mouvement fut si rapide que la jeune fille, ne rencontrant brusquement aucune résistance, faillit tomber de cheval.
Watson se débarrassa du tronçon de corde qui entourait ses épaules et le jeta à terre sans se retourner. La fille de Rojas continua à ramener son lasso, qui traînait mollement sur le sol.
Quand elle eut dans la main le bout de la corde elle contempla avec tristesse l’extrémité que le canif avait tranchée. Des larmes lui troublèrent les yeux. Puis, pâle de colère, elle regarda les dunes derrière lesquelles l’Américain avait disparu.
—Que le diable t’emporte, gringo ingrat! je ne veux plus te voir... Je ne te lancerai plus mon lasso et si un jour tu veux me retrouver, c’est toi qui seras obligé de me lancer le tien... si tu en es capable!
Et, sans pouvoir résister davantage à la cruauté de sa déconvenue, Celinda cacha son visage dans ses mains, pour que ces champs sablonneux, ce fleuve impétueux et solitaire, qui tant de fois l’avaient vue rire, ne pussent aujourd’hui la voir pleurer.{189}
Le jour de la grande surprise préparée par Canterac arriva. Les ouvriers dirigés par Moreno plantèrent les derniers arbres dans la plaine voisine du fleuve.
Des groupes de curieux admiraient de loin le bois improvisé. De Fort Sarmiento et même de la capitale du Neuquen des gens arrivèrent, attirés par cette fête d’un nouveau genre. Quelques travailleurs tendaient d’un arbre à l’autre des guirlandes de feuillages et fixaient des faisceaux de drapeaux.
Fritérini, élevé au grade de maître d’hôtel, avait tiré du fond de sa valise un frac quelque peu rongé de mites, souvenir du temps où il servait comme garçon de restaurant dans les hôtels d’Europe et de Buenos-Ayres. Soucieux de maintenir intacts son plastron rigide et sa cravate blanche, il donnait des ordres à un groupe de métisses du bar transformées en servantes qui préparaient des tables pour la fête du soir.
Don Antonio El Gallego avait lui aussi subi une{190} grande transformation extérieure. Il était vêtu de noir et une grosse chaîne d’or traversait son gilet d’une poche à l’autre. Il comptait au nombre des invités, car, représentant du haut commerce, il avait bien le droit d’être compris parmi les notables de la Presa; mais comme on avait commandé la collation à son établissement, il avait jugé bon de se transporter sur les lieux de la fête dès les premières heures de l’après-midi, pour s’assurer que tous les préparatifs se déroulaient avec régularité.
Parmi les badauds, que maintenait une clôture de fils barbelés, se tenaient quelques gauchos, dont le fameux Manos Duras. Après la bataille du cabaret il était revenu tranquillement au camp pour s’expliquer. Il reconnaissait que certains des provocateurs étaient ses amis, mais ils étaient tous majeurs et il n’avait pas à répondre de leurs actes comme un père. Il se trouvait loin de la Presa quand le choc s’était produit; pourquoi voulait-on le compromettre dans une affaire où il n’avait pris aucune part?
Le commissaire dut se contenter de cette justification; le patron du bar l’accepta également, car il aimait mieux avoir Manos Duras pour ami que pour ennemi; Manos Duras était donc présent et il contemplait avec une attention quelque peu ironique les préparatifs de la fête. Les autres gauchos, silencieux comme lui, semblaient rire intérieurement à la pensée du travail accompli. Les gringos transportaient les arbres de l’endroit où Dieu les avait fait naître; et tout cela pour une femme!
Les gens du peuple se montraient plus hardis dans leurs jugements et ne se gênaient pas pour les exprimer bien haut. Des femmes, parmi les mieux vêtues, s’attaquaient à la marquise.
—La garce! qu’est-ce que les hommes ne feraient pas pour elle!
Elles comptaient les cadeaux de l’entrepreneur{191} Pirovani, si avare pourtant et si dur pour les ouvriers.
Par chaque train arrivaient de Buenos-Ayres ou de Bahia Blanca à l’adresse de la marquise des paquets payés par l’Italien. Et de plus, une charrette chargée d’un tonneau ne cessait d’apporter de l’eau du fleuve à la maison de Pirovani. Cette grande dame avait besoin d’un bain toutes les vingt-quatre heures.
—Tout cela n’est pas naturel; elle doit avoir dans la peau quelque chose qui ne veut pas sortir, affirmaient sentencieusement quelques femmes.
Toutes, forcées d’aller plusieurs fois par jour de leur demeure à la rivière avec une cruche sur le dos, considéraient cette charrette et ce tonneau comme un luxe inouï. Un bain chaque jour, dans ce pays où le moindre souffle de vent soulève la terre en colonnes si épaisses et si lourdes qu’il fallait se courber pour résister à leur poussée! Beaucoup d’entre elles gardaient encore dans leur chevelure ou dans les doublures de leurs robes la poussière des semaines précédentes, et cette folle dépense d’eau les indignait comme une injustice sociale.
Une femme, pour se consoler, lança une allusion méchante à l’ingénieur Torrebianca:
—Il est capable de venir ce soir avec les bons amis de sa femme!... Pas possible qu’un homme soit aussi aveugle. Certainement ils s’entendent.
Celinda, à cheval, passa lentement parmi les groupes et regarda d’un air hostile le parc improvisé. Puis elle marcha vers le village pour ne pas entendre les commentaires scabreux des femmes.
Gonzalez, sans cesser de surveiller la mise en place des tables, tenait un discours à quelques-uns de ses clients en leur montrant le fleuve. Il avait trouvé le moment propice pour étaler avec une doctorale gravité les connaissances qu’il avait glanées dans les propos de son compatriote Robledo.{192}
Les Indiens avaient appelé ce fleuve Rio Negro, «la rivière noire», à cause des dures peines qu’ils éprouvaient à remonter son courant rapide. Les conquérants le nommaient «Fleuve des Saules». Aujourd’hui encore les saules abondaient sur ses rives, et les troncs que roulait le courant constituaient pour les barques un danger constant.
Il était resté inexploré pendant des siècles, puis un missionnaire anglais avait fait une tentative pour donner à son pays la priorité dans cette importante région de passage.
C’est alors que les Espagnols, qui avaient eu bien des choses à faire après s’être emparés de la plus grande partie de l’Amérique, jugèrent nécessaire l’exploration du fleuve.
L’enseigne Villarino entreprit cette expédition obscure et difficile dans le dernier tiers du xviiie siècle; don Manuel l’appelle le dernier représentant de l’héroïque génie des découvreurs espagnols.
Il partit de Carmen de Patagones avec soixante hommes d’équipage, sur quatre lourdes barques mal faites pour un tel voyage. Il s’enfonça avec cette poignée de marins dans un pays complètement inconnu où vivaient les Indiens les plus irréductibles et les plus féroces, qui poussaient parfois leurs incursions jusqu’aux abords de Buenos-Ayres.
Pendant des centaines de lieues les quatre barques naviguèrent entre ces rives où les guettaient les terribles Aucas.
—Nous qui connaissons le courant du fleuve nous pouvons comprendre les difficultés de cette expédition vers l’amont, et sur barque à voile. Ils emportaient quinze chevaux qui devaient haler les bateaux dans les passages difficiles. Quatre fois les ouragans brisèrent la mâture des embarcations. L’expédition dura de longs mois et, faute de guides du pays, elle s’égara souvent dans les affluents et dut revenir{193} ensuite en arrière... Ils cherchaient cette mer que les Indiens affirmaient avoir vue de leur yeux et qui n’est autre que le lac Nahuel Huapi. Il communique en effet avec le Rio Negro par le bras du Limay. Eh bien! aujourd’hui où nous possédons des embarcations cent fois meilleures, personne n’a jamais voulu recommencer le voyage de l’enseigne Villarino.
Pendant que Gonzalez continuait son patriotique discours les groupes devenaient plus importants. Un orchestre composé de quelques Italiens venus de Neuquen se mit à déchirer l’air de la stridence de ses cuivres. Immédiatement quelques couples commencèrent à danser. Don Antonio s’indigna de ce manque de respect à l’égard de l’organisateur de la fête.
—Ne les laisse pas danser avant l’arrivée de la marquise, dit-il à Fritérini, la cérémonie est en son honneur et monsieur de Canterac sera certainement mécontent si elle commence avant l’heure.
Mais les musiciens et les danseurs ne tinrent aucun compte de ses scrupules et le bal continua.
Cependant, Hélène, brillamment parée pour la fête, se trouvait encore dans le salon de sa maison. Son visage était sombre et irrité.
—Cela n’arrive qu’à moi, pensait-elle. Fallait-il que cette nouvelle nous parvînt justement aujourd’hui?... Allez donc ne pas croire aux caprices de la fatalité!
Torrebianca avait reçu le matin une lettre d’Italie que lui expédiait son notaire: il l’avait tendue à Hélène, le visage bouleversé.
«Depuis votre départ pour l’Amérique la santé de madame la marquise était si chancelante que nous attendions d’un moment à l’autre une issue fatale. Elle est morte en pensant à vous. Le dernier mot qu’elle eut la force de prononcer dans son agonie fut votre nom. Je vous envoie ci-joint quelques rensei{194}gnements sur l’héritage qui malheureusement n’est pas....»
Hélène s’arrêta de lire pour regarder son mari d’un air interrogateur; mais il demeurait la tête en avant, anéanti par cette nouvelle. Elle hésita avant de parler, puis comme le temps passait sans que son mari rompît le silence, elle dit lentement:
—Je suppose que cet événement qui n’a rien d’imprévu, puisque souvent tu m’avais fait part de tes craintes, ne nous empêchera pas d’assister à la fête.
Torrebianca leva les yeux et la regarda, stupéfait...
—Que dis-tu? Songe que celle qui vient de mourir était ma mère.
Elle feignit la confusion et répondit doucement:
—La mort de cette pauvre dame me fait beaucoup de peine. C’était ta mère et cela me suffit pour que je la pleure... mais songe aussi que je ne l’ai jamais vue et qu’elle-même ne m’a connue que par mes portraits. Reprends tes esprits et sois un peu logique. A cause d’un événement malheureux qui s’est passé à l’autre bout de la terre, nous ne pouvons pas nous dispenser d’assister à une fête qui a occasionné des frais énormes à celui qui l’a organisée.
Elle s’approcha de son mari et lui dit d’une voix insinuante tout en lui caressant de la main le visage:
—Il faut savoir vivre. Nul ne connaît ton malheur? Imagine-toi que la lettre n’est pas arrivée aujourd’hui et que tu ne peux pas la recevoir avant le courrier d’après-demain. C’est entendu, n’est-ce pas? Tu ignores la nouvelle et tu viens avec moi, ce soir. A quoi bon y penser maintenant? Tu as bien le temps de méditer sur ce triste événement.
Le marquis secoua la tête. Puis il porta une main à ses yeux et, appuyant son coude sur ses genoux il gémit d’une voix sourde:{195}
—C’était ma mère... ma pauvre mère qui m’aimait tant!
Il y eut un long silence. Torrebianca se réfugia dans une pièce voisine comme pour dérober à sa femme son chagrin. Hélène, maussade et irritée, l’entendait gémir et marcher derrière la porte.
Le temps passait. Elle regarda la pendule: trois heures. Il fallait prendre une décision. Elle eut une moue cruelle et haussa les épaules. Puis elle marcha vers la porte par où son mari avait disparu:
—Reste ici, Frédéric, ne t’occupe pas de moi. J’irai seule et je trouverai un prétexte pour t’excuser. A bientôt, mon chéri. Crois bien que si je te laisse c’est uniquement pour ne pas peiner nos amis. Ah! quel supplice que les exigences du monde.
Sa voix avait des inflexions tendres, mais un rictus de rage tordait les coins de sa bouche. Elle mit son chapeau et sortit. Du haut du perron elle put voir la rue complètement déserte.
Tous les habitants du village se trouvaient autour du parc improvisé. Canterac et l’entrepreneur chacun de leur côté avaient décidé que ce jour serait férié et donné congé à leurs hommes.
Devant la maison attendait une petite voiture à quatre roues; un métis dormait sur le siège, gardant entre ses lèvres épaisses et bleues un cigare de Paraguay, tandis qu’un essaim de mouches bourdonnaient autour de son visage en sueur.
Hélène pensa à ses admirateurs qui sans doute guettaient avec impatience son arrivée. Ils s’étaient abstenus de venir la chercher parce que la veille elle avait exprimé le désir de se rendre à la fête seulement accompagnée de son époux. Une femme doit éviter de donner prise à la calomnie.
Elle s’écartait de la maison pour gagner la voiture, quand elle entendit un galop de cheval. Un{196} cavalier venait de surgir d’une ruelle voisine. C’était la Fleur du Rio Negro.
Le mystérieux instinct de la haine fit qu’Hélène devina sa présence avant de l’avoir aperçue. Sans attendre que le cheval fût arrêté l’intrépide amazone se laissa glisser de sa selle. Puis elle s’avança avec la démarche lourde du cavalier qu’étonne encore le contact du sol:
—Madame, un mot seulement.
Et elle se plaça entre la marquise et le marchepied de la voiture pour lui barrer le passage.
Malgré sa fierté, Hélène fut troublée par le regard dur de la jeune fille. Cependant elle eut un mouvement hautain qui demandait «Est-ce bien moi que vous cherchez.» Celinda comprit et répondit d’un geste affirmatif.
La marquise, toujours muette, lui fit signe de parler, et la fille de Rojas dit d’un ton agressif:
—Vous n’avez donc pas assez de tous ces hommes que vous rendez fous? Il vous faut encore voler ceux qui sont à d’autres femmes?
Hélène la regarda des pieds à la tête sans répondre un mot. Elle essayait de l’impressionner avec des airs de supériorité...
—Je ne vous connais pas, petite! dit-elle enfin. J’ai idée, d’ailleurs, qu’il y a entre nous une trop grande différence de classe et d’éducation; nous en resterons là, s’il vous plaît.
Elle essaya de l’écarter et de passer, mais Celinda, irritée par cette réponse méprisante, leva le rebenque qu’elle tenait dans sa main droite.
—Eh! diable en jupons!
Elle abattit son fouet sur le visage d’Hélène, mais l’autre se mit aussitôt en défense et saisit le bras de son adversaire. Une intense pâleur se répandit sur son visage et ses yeux, agrandis par la surprise,{197} lancèrent un éclair fauve. Puis elle dit d’une voix rauque:
—Bien, petite, ne vous mettez pas en peine. Je compte ce coup comme reçu. C’est un cadeau que l’on n’oublie pas; je m’en souviendrai quand je le jugerai bon.
Elle lâcha le bras de Celinda; celle-ci, déjà calmée, le laissa retomber, comme honteuse de son agression.
Hélène profita de ce mouvement d’hésitation pour sauter dans la voiture. Elle toucha le conducteur à l’épaule. Le métis était resté endormi jusqu’à ce moment, le cigare à la bouche, et ne s’était pas rendu compte de ce qui s’était passé à côté de son véhicule.
A peine sortie du village, Hélène aperçut au loin le parc improvisé et la multitude qui s’agitait tout autour.
Un cavalier, qui semblait revenir du lieu de la fête, la croisa au trot et ôta son chapeau pour la saluer. Hélène reconnut Manos Duras et sourit machinalement en réponse à son salut respectueux. Puis, sans bien se rendre compte de ce qu’elle faisait, elle l’appela de la main. Le gaucho fit faire demi-tour à son cheval, s’approcha de la voiture et se mit à marcher à hauteur des roues.
—Comment allez-vous, Madame la Marquise? Pourquoi êtes-vous si pâle?
Hélène fit un effort pour retrouver son calme.
Sans doute les traces de l’émotion qu’elle venait d’éprouver étaient encore visibles sur son visage; il fallait qu’elle arrivât à la fête tranquille et souriante, et que nul ne pût deviner l’outrage qu’elle avait reçu.
Comme pour mettre fin promptement à son entretien avec Manos Duras, elle lui demanda avec une gaieté forcée:{198}
—Vous m’avez bien dit un jour que vous aviez beaucoup d’estime pour moi et que vous seriez toujours prêt à exécuter un de mes ordres, quelque terrible qu’il fût?
Manos Duras salua, la main à son chapeau, et sourit en découvrant ses dents de loup.
—Ordonnez, Madame. Désirez-vous que je tue quelqu’un?
Tandis qu’il parlait, le désir brillait dans ses yeux. Elle eut un geste d’effroi hypocrite.
—Tuer? Oh! non... quelle horreur! Pour qui me prenez-vous?... Le service que j’aurai l’occasion de vous demander peut-être sera bien plus agréable pour vous... Nous en reparlerons.
Elle eut peur que le gaucho ne tardât à prendre congé, et d’un geste énergique elle lui ordonna de se retirer. Elle était arrivée à proximité du lieu de la fête et il était peu convenable que, venant sans son mari, elle y arrivât avec un tel compagnon.
Manos Duras retint son cheval et la voiture s’éloigna. Pendant quelques minutes il suivit des yeux cette femme, la plus extraordinaire qu’il eût jamais rencontrée; quand il l’eut perdue de vue, son regard de dogue soumis redevint dur et agressif.
Les invités pénétraient peu à peu dans le parc artificiel, entourés de la curiosité de la foule que le commissaire et ses quatre hommes, fort affairés, maintenaient derrière la clôture de fil de fer. Ces invités étaient des commerçants espagnols ou italiens établis dans les villages voisins ou venus de l’île lointaine de Choele-Choel, le dernier point où atteignent les rares bateaux capables de remonter le Rio Negro. Les contremaîtres et les mécaniciens du chantier se présentaient aussi avec leurs femmes qui avaient déballé leurs costumes de fête, réservés jusqu’ici aux brefs séjours qu’elles allaient faire à Bahia Blanca ou à Buenos-Ayres.{199}
Robledo parcourait les courtes allées du parc et admirait ironiquement l’absurde création de Canterac. Moreno lui faisait noter avec un certain orgueil tous les détails de l’œuvre qu’il avait dirigée.
—Ce qu’il y a de plus remarquable, c’est une espèce de berceau ou plutôt de sanctuaire de verdure qui se trouve au bout de la futaie. Le capitaine tentera certainement d’y amener la marquise. Mais elle est fine et elle saura lui glisser dans les mains.
Il clignait malicieusement de l’œil en parlant des projets de Canterac, puis il reprenait sa gravité pour affirmer la parfaite vertu de la marquise qui n’était pas la femme que beaucoup de gens croyaient.
Il se préparait à montrer à l’Espagnol le fameux «sanctuaire» de verdure, mais, soudain, sans transition, il l’abandonna en murmurant une excuse et s’élança vers l’entrée du parc. Hélène venait d’arriver. Les autres soupirants imitèrent Moreno et coururent à sa rencontre; mais après avoir salué les trois hommes, elle montra nettement sa préférence pour Watson, qui lui aussi était allé au-devant d’elle. Elle causa avec les autres, mais ses yeux caressants restaient fixés sur Richard. Robledo, qui de loin examinait le groupe, ne manqua pas de s’en apercevoir.
Contrarié par ce qu’il venait de découvrir, il s’approcha pour saluer la Torrebianca. Puis, à voix basse, il pria Watson de le suivre; mais le jeune homme faisait semblant de ne pas comprendre. Tout gonflé de son importance en tant qu’organisateur de la fête, l’ingénieur français s’interposa enfin entre Hélène et les invités et lui offrit son bras pour lui montrer toutes les beautés de sa création forestière.
Robledo en profita pour toucher du doigt le dos de Watson et pour l’inviter à l’accompagner dans{200} sa promenade sous la futaie. Dès qu’ils furent seuls, l’Espagnol lui montra la femme qui s’éloignait appuyée au bras de Canterac et lui dit avec bonté:
—Méfiez-vous, Richard. Je crois que cette Circé ne demande qu’à vous enchanter à votre tour.
Watson, qui, jusqu’à cette heure, l’avait toujours écouté avec déférence, le regarda cette fois d’un air de hauteur.
—Je suis assez grand pour aller tout seul, répondit-il sèchement, et quand à vos conseils, vous me les donnerez quand je vous les demanderai.
Puis il tourna le dos en murmurant des mots inintelligibles et s’en fut à la recherche d’Hélène.
L’Espagnol demeura d’abord stupéfait de la brusque réponse de son associé; puis il s’indigna.
—Cette femme! pensa-t-il. Elle va encore m’enlever mon meilleur ami!
A ce moment commençait la partie de la fête qui, pour beaucoup des invités, était la plus intéressante. Fritérini donnait des ordres à pleine voix aux métisses chargées du service. Sur les tables, faites de planches supportées par des chevalets et couvertes de draps de lit fraîchement lavés en guise de nappes, apparurent les victuailles les plus riches et les plus extraordinaires qu’avaient pu fournir le magasin du Gallego et tous les autres cabarets ou auberges des colonies proches de Rio Negro. C’étaient des mets européens ou nord-américains qui gardaient un goût de renfermé, un parfum d’étain et de fer blanc: porc de Chicago, saucisses de Francfort, foie gras, sardines de Galice, piments de la Rioja, olives de Séville, le tout venu, à travers l’océan, dans des boîtes métalliques ou des petits barils de bois.
Le choix des boissons était extraordinaire. Seuls quelques gringos venus des pays dits latins recherchaient les bouteilles de vin rouge. Les autres, en particulier les fils du pays, tenaient pour une bois{201}son grossière les liquides couleur de sang, et la transparence des vins blancs leur était signe d’aristocratie.
Les bouchons de champagne ne cessaient de sauter à grand bruit. On buvait le vin mousseux comme on eût bu de l’eau du fleuve.
—C’est cher en Europe, disait un Russe aux longs cheveux graisseux, mais ici, avec la différence du change!...
Le méticuleux Moreno s’inquiétait de la soif grandissante des invités. Il faisait des signes mystérieux à l’enthousiaste Fritérini et lui glissait au passage quelques mots dans l’oreille pour lui recommander l’économie et la prudence.
—Pourvu que les pesos de Canterac y suffisent! pensait-il. Je commence à croire que nous n’aurons pas assez d’argent pour tout payer.
Cependant l’ingénieur français s’enfonçait avec Hélène au milieu des arbres et s’arrêtait parfois pour lui signaler les plus beaux.
—Ce parc n’est pas celui de Versailles, belle marquise, disait-il en imitant les façons galantes des siècles passés. Mais dans sa médiocrité, il vous exprime du moins le désir que j’ai eu de vous être agréable.
Pirovani, feignant la distraction, marchait derrière lui à quelque distance. Il ne pouvait cacher le dépit que lui causait cette fête imaginée par son rival. Il reconnaissait qu’il n’aurait pu inventer rien de semblable. Ah! l’instruction était bien utile!
En s’avançant dans le bois artificiel il donnait à la dérobée de rudes poussées aux arbres les plus proches pour essayer de les faire tomber. Mais ses mauvais desseins échouaient. Tous les arbres restaient debout. Cet imbécile de Moreno avait bien fait les choses quand il avait prêté son concours à Canterac.{202}
Ses extrémités se glacèrent et tout son sang lui reflua au cœur lorsqu’il vit le couple pénétrer dans un épais berceau de feuillage, à l’extrémité d’une avenue. C’était le fameux sanctuaire dont Moreno avait parlé.
—La reine peut prendre place sur son trône, dit Canterac. Et il indiqua à Hélène un banc rustique surmonté d’une espèce de dais fait de guirlandes de verdure et de fleurs de papier.
Enhardi par la solitude, le Français exprima son amour en termes véhéments, et se dit prêt à tout sacrifier pour Hélène. Il lui avait souvent fait les mêmes aveux, mais cette fois ils étaient seuls et la fête semblait avoir rendu sa passion plus agressive.
Elle était assise sur le banc rustique, près de l’ingénieur, et elle montrait quelque inquiétude, sans perdre pour cela son sourire de tentatrice. Canterac lui saisit les deux mains et voulut aussitôt la baiser sur la bouche. Mais la Torrebianca, qui s’attendait à l’attaque, sut se défendre à temps et fit effort pour le repousser.
Ils luttaient de la sorte quand l’entrepreneur parut à l’entrée du cabinet. Aucun des deux ne le vit. Canterac s’obstinait à vouloir embrasser Hélène et, oubliant ses minauderies de coquette, elle le repoussait avec violence.
—C’est de la déloyauté, dit-elle d’une voix haletante. Je dois être décoiffée. Vous allez abîmer mon chapeau... Restez tranquille! Si vous persistez, je vous quitte.
Mais elle fut enfin réduite à se défendre si énergiquement que Pirovani crut le moment venu d’intervenir et pénétra résolument à l’intérieur du cabinet. L’ingénieur, en l’apercevant, abandonna Hélène et se leva, tandis qu’elle réparait le désordre de sa coiffure et de ses vêtements. Les deux hommes{203} se regardèrent fixement; l’Italien se sentit contraint de prendre la parole.
—Vous êtes bien pressé, dit-il ironiquement, de vous faire payer les frais de la fête.
Canterac fut si étonné d’entendre un simple entrepreneur l’insulter à cet endroit même, dans un parc somptueux né de son esprit, qu’il resta un instant sans pouvoir parler. Puis sa colère d’homme autoritaire éclata, fulgurante et froide.
—De quel droit m’adressez-vous la parole? J’aurais dû m’abstenir d’inviter chez moi un émigrant sans éducation, qui a fait sa fortune on ne sait trop comment.
Furieux d’être ainsi outragé en présence d’Hélène, Pirovani fut pris d’une rage folle. La violence de son tempérament sanguin le poussait à l’action immédiate; pour toute réponse il se jeta sur l’ingénieur et le gifla. Immédiatement les deux hommes s’empoignèrent et se mirent à lutter à bras-le-corps, tandis que la Torrebianca, perdant la tête, poussait des cris d’épouvante.
Les invités accoururent, et les premiers à se présenter furent Robledo et Watson, chacun de leur côté.
L’ingénieur et l’entrepreneur, qui se roulaient sur le sol, étroitement enlacés, avaient en grande partie détruit le sanctuaire de verdure.
Pirovani, plus puissant et plus vigoureux que Canterac, l’étouffait de son poids. La colère lui faisait oublier tout ce qu’il savait d’espagnol et il blasphémait en italien, invoquant la Vierge et la plupart des habitants du ciel. Il priait à grands cris ceux qui tentaient de s’interposer de le laisser manger le foie de son rival. En quelques secondes, il était revenu aux années de sa jeunesse, où il se battait avec ses compagnons de misère dans quelque trattoria du port de Gênes.{204}
En les tiraillant avec énergie et en distribuant quelques bons coups de poing, des hommes de bonne volonté parvinrent à séparer leurs deux chefs. Watson, sans s’occuper des combattants, s’était élancé vers la marquise et s’était placé devant elle comme pour la défendre d’un péril.
Robledo regarda les deux adversaires. Contenus chacun par un groupe d’hommes ils s’insultaient de loin et bavaient des injures, les yeux injectés de sang. Tous deux avaient brusquement oublié l’espagnol et ils bredouillaient les mots les plus sales de leurs langues respectives.
Puis il contempla la marquise de Torrebianca qui, soutenue par Watson, gémissait comme une fillette.
«Il ne manquait plus que ce scandale! se dit-il. J’ai peur que cette femme ne soit bientôt cause de la mort d’un homme.»{205}
Watson et Robledo, préoccupés par l’événement qui s’était produit quelques heures auparavant dans le parc inventé par Canterac, terminèrent silencieusement leur repas.
Un obstacle infranchissable semblait s’être élevé entre eux. Watson montrait un visage assombri et évitait de regarder Robledo qui levait de temps en temps les yeux sur son associé avec un sourire plein d’amertume. Il pensait à Hélène, ce cruel despote, qui peut-être avait excité Richard contre lui.
Le jeune homme quitta la table, prit congé en murmurant quelques mots indistincts et saisit son chapeau pour sortir.
—Il va la voir, se dit l’Espagnol; loin d’elle, il ne vit plus.
Dans la rue centrale, Watson rencontra des groupes qui discutaient avec ardeur. Les rectangles rouges que projetaient sur le sol les portes du bar étaient souvent voilés par l’ombre de gens qui entraient ou sortaient.{206}
Il devina que tous commentaient l’événement du jour en prenant fait et cause soit pour l’ingénieur, soit pour l’entrepreneur.
Quand il arriva chez Hélène, Sébastienne le reçut au sommet du perron. La métisse elle-même était préoccupée par les incidents de l’après-midi.
Elle regarda Richard avec sévérité; sans doute, elle pensait à Celinda. «Ah! les hommes! Ce gringo qu’elle avait pris pour un bon garçon, il était tout aussi vicieux que les autres.»
Le jeune homme passa sans remarquer ce regard et trouva dans la grande salle Hélène qui semblait l’attendre.
Il voulut prendre un fauteuil, mais la marquise s’y opposa.
—Non, ici, à côté de moi. Personne ainsi ne pourra nous entendre.
Et elle l’obligea à s’asseoir sur le sofa, tout près d’elle.
Son visage était pâle, son regard dur et elle semblait encore sous l’impression désagréable des événements récents. La rixe entre Pirovani et Canterac était passée dans sa mémoire au second plan, mais l’image de Celinda, le fouet levé, la tourmentait sans cesse, et elle en frémissait encore de rage. Elle oublia sa rancune en voyant arriver ponctuellement Richard qu’elle avait prié de venir passer la soirée chez elle. Elle remarqua que Watson regardait avec inquiétude les portes de la salle et crut devoir le rassurer.
—Personne ne viendra. Mon mari est dans sa chambre, accablé par une mauvaise nouvelle qu’il a reçue d’Europe... un malheur de famille que nous attendions depuis quelque temps et qui ne me touche pas beaucoup moi-même.
Puis, changeant de ton et de visage, elle continua:
—Combien je vous remercie d’être venu!... Je{207} tremblais à la pensée qu’il me faudrait passer seule les longues heures de la soirée. Je m’ennuie tant ici!... C’est pour cela qu’aujourd’hui, en nous séparant, je vous ai supplié de ne pas m’abandonner...
Et en prononçant ces mots elle prit la main de Watson qu’elle contempla de ses yeux caressants.
Le jeune homme se sentit flatté par ce regard dans sa vanité masculine, mais immédiatement le souvenir des incidents de l’après-midi lui revint à la mémoire.
—Pourquoi ces deux hommes se sont-ils battus? Est-ce pour vous?
Elle hésita d’abord, puis, détournant les yeux, elle répondit avec détachement.
—Peut-être; mais je les méprise tous les deux. Vous seul existez pour moi, Richard.
Elle lui posa les mains sur les épaules et approcha de lui son visage; son corps souple s’étira avec une ondulation féline.
—Il me semble, murmura-t-elle, que nous sommes près de franchir les bornes d’une tranquille amitié. Vous ne savez pas comme vous m’intéressez.
Ils se sentaient enhardis par la solitude et par la force de leur désir. En quelques minutes ils allaient parcourir des étapes que dans son inexpérience le jeune homme s’attendait à voir durer fort longtemps. Hélène pensait à la jeune amazone qui avait tenté de la frapper. Outragée dans son orgueil, elle voulait une prompte vengeance, et cyniquement, elle se disait avec un rire contenu qui faisait briller son regard:
—Puisque tu es jalouse, ce ne sera pas sans motif. Je te rendrai bien ton coup de cravache.
De plus, elle songeait à ces deux hommes qui s’étaient colletés devant elle, sans qu’elle éprouvât aucune émotion véritable et, avec l’étrange logique d’un cerveau désordonné, elle arrêtait que le plus{208} sûr moyen de rétablir la paix entre eux était de se donner à un troisième, plus digne qu’elle le distinguât.
Watson, de son côté, la trouvait plus belle et plus désirable depuis que deux hommes avaient essayé de se tuer pour elle. Un sentiment d’orgueil viril, de vanité sexuelle, s’unissait aux émotions qu’excitaient en lui les paroles de la Torrebianca et le contact de son corps.
Les deux mains qu’elle avait appuyées sur les épaules de Richard se rejoignaient lentement et le jeune homme se sentit emprisonné entre deux bras adorables. Quelque chose se réveilla dans son âme, comme une fleur mourante qui renaît. Il crut voir le noble et triste visage de l’ingénieur Torrebianca et soudain il voulut rompre le charme, se rejeter en arrière et repousser Hélène... Il ne pouvait trahir son compagnon. Il ne pouvait commettre cet acte honteux sous le toit même de cet homme à peine séparé de lui par quelques cloisons. Puis il se vit lui-même marchant joyeusement dans la campagne, aux côtés de Celinda. Encore une fois il voulut secouer la tête et ses paupières battirent avec angoisse; alors même qu’il tentait de se déprendre, il était certain d’en être incapable.
«Pauvre petite Fleur du Rio Negro!» pensa-t-il.
Les bras qui entouraient son cou se resserrèrent doucement et attirèrent peu à peu sa tête vers le visage féminin qui lui tendait ses lèvres avides et hardies. Leurs bouches s’unirent enfin et Richard crut que ce baiser n’aurait plus de fin.
Il était ivre comme un homme qui, trouvant toutes portes ouvertes, s’avance de salle en salle dans un palais merveilleux, et découvre chaque fois une chambre plus admirable et des perspectives plus éblouissantes au delà. Au moment où il s’imaginait que cette bouche, il l’avait possédée toute, les lèvres{209} s’entr’ouvraient en un bâillement de fauve et le laissaient pénétrer plus avant pour lui révéler l’énervante volupté de contacts inconnus. Il croyait avoir épuisé toutes les sensations que recelaient en elles ces deux valves de chair humide et douce, et de nouveaux frissons de plaisir lui parcouraient le dos.
A ce moment, il eut la même pensée que tous les naïfs habitants de la Presa qui couraient affolés dans le sillage de la Torrebianca: «C’est elle la vraie femme. Les femmes qui ont connu l’existence élégante méritent seules qu’on les admire.»
Ses mains s’égarèrent sur les rondeurs de ce corps adorable, essayèrent d’écarter les vêtements importuns.
Soudain tous deux se repoussèrent sous le coup d’une violente surprise et se hâtèrent de réparer le désordre de leur aspect. Sébastienne venait de frapper à la porte et demandait la permission d’entrer.
La métisse était trop bien stylée pour ouvrir une porte sans autorisation; mais avant de la solliciter elle jugeait toujours bon de jeter un coup d’œil par le trou de la serrure.
Sa tête parut enfin dans l’entre-bâillement et elle dit, en voilant son regard malicieux:
—Mon ancien patron, don Pirovani, demande à voir Madame. Il dit que c’est très pressé.
Richard se leva pour partir; Hélène le supplia de rester, lui promettant de congédier l’intrus au plus tôt. Mais le jeune homme avait repris son sang-froid et s’était rendu compte du danger qu’il venait de courir; il saisit l’occasion qui se présentait et se retira, désireux de ne pas rester seul avec elle à nouveau. Sur le seuil il heurta presque l’entrepreneur qui entrait, saluant de très loin «Madame la Marquise».
Il lui serra la main et disparut incontinent.
Hélène ne chercha pas à dissimuler l’irritation{210} que lui causait cette visite inopportune; elle reçut l’Italien avec une visible mauvaise humeur.
Elle resta debout pour lui faire comprendre que leur entrevue devait être brève; mais l’autre, préoccupé, lui demanda la permission de s’asseoir et prit un fauteuil avant même qu’elle eût répondu. La Torrebianca se contenta de s’appuyer au bord d’une table.
—Mon mari est indisposé, dit-elle, et a besoin de mes soins. Ce n’est pas bien grave: l’émotion que lui a causée un malheur de famille. Mais parlons de vous: quel sujet vous amène ici à une heure pareille?
Pirovani resta un moment sans répondre, pour donner ainsi plus de solennité aux paroles qu’il allait prononcer.
—Monsieur de Canterac estime qu’après l’incident de ce soir nous devons nous mesurer dans un duel à mort.
Hélène, qui ne pensait qu’à Watson et qui supportait mal la présence de celui qui l’avait mis en fuite, eut un mouvement qui marquait que la nouvelle l’intéressait peu. Puis elle essaya de dissimuler son indifférence et dit:
—Cette proposition n’a rien d’extraordinaire. Si j’étais un homme j’agirais de même.
Pirovani, qui avait hésité jusqu’alors parce qu’il trouvait stupide le défi de Canterac, se leva de son fauteuil d’un air décidé.
—Eh bien, dit-il, puisque vous l’approuvez, c’est dit. Je me battrai contre le Français; je me battrai s’il le faut contre la moitié du monde pour vous prouver que je suis digne de votre estime.
En parlant ainsi il avait saisi une main d’Hélène, mais cette main lui sembla si molle et si froide qu’il la lâcha avec découragement. Elle se tourna d’un air las vers les pièces intérieures de la maison,{211} où se trouvait son mari. Pirovani comprit qu’il devait se retirer, et il se hâta d’obéir, mais en se dirigeant vers la porte il n’épargna pas à la marquise les déclarations et les gestes d’un amoureux qui veut faire admirer son héroïsme.
Restée seule enfin, Hélène appela Sébastienne à grands cris. La métisse ne se hâta pas d’accourir. Elle avait dû accompagner jusqu’à la porte de la rue son ancien patron.
—Essaie de rejoindre M. Watson, ordonna-t-elle vivement. Il ne doit pas être loin, dis-lui de revenir.
La métisse sourit, baissa les yeux et dit avec une feinte naïveté:
—Ce serait difficile de le rattraper! Il est parti comme une bombe, ou comme s’il avait le diable à ses trousses.
En sortant de son ancienne maison, Pirovani se rendit chez Robledo. L’Espagnol lisait un livre qu’il tenait appuyé contre la lampe à pétrole posée au centre de la table. En voyant entrer l’entrepreneur il l’accueillit avec des exclamations et des gestes de reproche.
—Eh bien! qu’est-ce qui vous a donc pris?... Un homme de votre âge et de votre caractère... Mais vous êtes pire qu’un gamin de quinze ans qui se bat pour sa fillette.
L’Italien, l’air hautain, n’accepta pas cette réprimande trop tardive et secrètement fier de ce qu’il annonçait, il dit avec solennité:
—Je dois avoir un duel à mort avec le capitaine Canterac. Je suis venu vous trouver pour vous prier d’être mon témoin avec Moreno.
Robledo poussa des clameurs indignées en levant les bras au ciel pour donner plus de vigueur à sa protestation.
—Et vous croyez que je vais appuyer ces extra-{212}vagances et me montrer aussi fou que vous ou que l’autre?
Il continua de s’élever contre l’absurde demande de Pirovani, mais l’Italien secouait la tête avec obstination. Depuis son entretien avec Hélène, il était résolu à tout.
—Je suis de naissance modeste, dit-il, je n’ai jamais su que travailler, mais je veux montrer à ce monsieur que je ne le crains pas, quelque habitué qu’il soit à manier les armes.
Robledo haussa les épaules en entendant ces mots qui lui semblaient stupides. Il se lassa enfin de protester sans résultat:
—Je vois qu’il est inutile d’essayer de vous rendre le bon sens... C’est bien, je consens à parler en votre nom, mais à la condition que vous me laisserez arranger les choses raisonnablement en évitant ce duel.
L’entrepreneur parut offensé et prit une attitude de dignité chevaleresque.
—Non; je veux le duel à mort. Je ne suis pas un lâche et je ne cherche pas des accommodements.
Puis il laissa voir sa vraie pensée:
—Je n’ai pas reçu une brillante éducation, mais je sais comment on doit se comporter dans des circonstances comme celle-ci. En outre, des personnes haut placées m’ont dit leur opinion. Je dois me battre, je me battrai.
Il prononça ces mots avec une telle conviction que Robledo devina qu’Hélène était la «personne haut placée» qui l’avait conseillé. Il le regarda avec pitié, puis déclara qu’il se refusait de façon formelle à lui servir de témoin.
Pirovani, convaincu qu’il n’obtiendrait plus rien de lui, prit congé et se dirigea vers la maison de Moreno.
Le jour suivant, don Carlos Rojas reçut une visite{213} fort matinale. Il se trouvait devant la porte du corps de logis de son estancia quand il vit arriver, monté sur un bidet qui le fit sourire, un cavalier en costume de ville.
C’était le secrétaire Moreno.
—Où courez-vous, monté sur cette rosse?... Descendez; que diriez-vous d’un peu de maté, camarade?
Tous deux entrèrent dans la pièce qui servait de salon et de bureau à don Carlos, et, tandis qu’une petite servante préparait le maté, Moreno aperçut par une porte entre-bâillée la fille de Rojas assise, triste et pensive, dans un fauteuil d’osier. Elle portait un costume féminin et semblait avoir dépouillé avec ses habits d’homme son audace joyeuse de garçon turbulent.
Moreno la salua, de son côté de la porte, et elle répondit mélancoliquement à son salut.
—Regardez-la, dit le père, elle n’est plus la même. Est-ce qu’on ne la croirait pas malade; la jeunesse est ainsi.
Celinda sourit d’un air las et secoua la tête: Non, elle n’était pas malade. Bientôt, elle quitta la pièce où elle se trouvait, trop voisine du salon, pour permettre aux deux hommes de parler librement.
Quand ils eurent pris la première tasse de maté, Rojas offrit à Moreno un cigare, alluma le sien et se prépara à écouter.
—Quel bon vent vous amène en ces lieux, mon cher rond-de-cuir? Vous n’êtes pas homme de cheval, et ce n’est pas pour rien que vous avez poussé un galop jusqu’ici.
Le rond-de-cuir continua de fumer avec le calme d’un Oriental qui aime exciter la curiosité de son interlocuteur avant d’entrer en matière.
—Dans votre jeunesse, don Carlos, dit-il enfin, vous avez su manier les armes. Je me suis laissé{214} dire que lorsque vous habitiez Buenos-Ayres vous avez eu plus d’un duel, pour histoires de femmes.
Rojas regarda de côté et d’autre pour s’assurer que sa fille était loin et ne pouvait entendre. Puis il sourit avec la vanité d’un homme mûr qui évoque les aventures de sa jeunesse ardente, et il dit, faussement modeste:
—Bah! tout cela est oublié! Péchés de jeunesse! C’était l’habitude d’autrefois!
Moreno crut devoir rester silencieux un long moment, puis il ajouta:
—L’ingénieur Canterac et l’entrepreneur Pirovani se battront en duel demain... C’est un duel à mort.
—Quoi, ces choses-là ne sont pas encore passées de mode? Et ici, en plein désert?
Moreno fit oui de la tête sans dire un mot. L’estanciero resta muet lui aussi et il regarda son hôte avec des yeux interrogateurs. En quoi cela le regardait-il? Il avait donc fait ce voyage pour le plaisir de lui annoncer cette nouvelle?
—Canterac, dit l’employé, a comme témoin le marquis de Torrebianca et le gringo Watson. Comme ils sont tous deux ingénieurs, ils ne peuvent refuser un service aussi important à un collègue.
Rojas trouva la chose fort naturelle. Mais, que lui importait, à lui, que les témoins fussent celui-ci ou celui-là.
—Pirovani n’a pu trouver que moi, continua Moreno, et je viens vous prier, don Carlos, vous qui connaissez les armes, de me tirer d’affaire en acceptant d’être le second témoin de l’Italien.
L’estanciero protesta avec véhémence.
—Assez de blagues, hein?... Pourquoi irais-je me mêler des zizanies entre les gens de la Presa, qui d’ailleurs sont tous mes amis? Et puis, je suis{215} trop vieux pour m’embarquer dans ces affaires et je ne tiens pas à jouer au matamore.
Moreno insista et la discussion des deux hommes dura quelques minutes. Don Carlos enfin parut mollir, séduit par le mystère que cachait ce duel inattendu. Son rôle de témoin lui permettrait peut-être de découvrir des choses fort drôles et fort intéressantes.
—Bon, ce sera comme vous voudrez. Qu’est-ce que vous ne me feriez pas faire, rond-de-cuir maudit!
Il sourit ensuite d’un air égrillard, et, frappant la cuisse de l’employé, il lui demanda en baissant le ton:
—Et pourquoi veulent-ils se tuer? Histoire de femme encore? Cette marquise qui les a tous rendus fous, elle est bien pour quelque chose dans l’aventure?
Moreno prit une attitude pleine de réserve et porta un doigt à ses lèvres pour lui imposer silence.
—Soyez prudent, don Carlos. Songez que nous aurons affaire au marquis de Torrebianca, qui est témoin et qui dirigera sans doute le combat, car il est expert en cette matière.
L’estanciero se mit à rire en appliquant de nouvelles claques sur les cuisses de son ami. Il riait de si bon cœur qu’il portait de temps en temps sa main à sa gorge comme s’il eût craint d’étouffer.
—Ah! elle est bien bonne!... C’est le mari qui sera directeur du duel... Et c’est pour sa femme que les deux autres se battent!... Ces gringos sont vraiment délicieux! Je serai bien content de voir ça... c’est formidable!
Puis il reprit, calmé:
—Eh bien, oui, j’accepte d’être témoin. C’est plus fort qu’une place de théâtre à Buenos-Ayres,{216} ou que ces histoires de cinéma dont ma fillette raffole.
Vers le milieu de l’après-midi, Moreno, qui avait déjeuné à l’estancia de Rojas, regagna la Presa et mit pied à terre devant l’ancienne maison de Pirovani.
Torrebianca marchait de long en large dans la pièce qui lui servait de bureau. Il était vêtu de noir et paraissait plus triste et plus découragé que les jours précédents. Il s’arrêtait parfois près de sa table sur laquelle était posée une boîte de pistolets ouverte. Il avait passé une partie de l’après-midi à nettoyer ces armes et à les contempler mélancoliquement, comme si leur vue eût évoqué pour lui de lointains souvenirs. S’il oubliait un instant les pistolets, c’était pour regarder une photographie placée aussi sur la table: la photographie de sa mère. Ses yeux se mouillaient quand il la contemplait.
Moreno le salua, se hâta de l’informer qu’il avait trouvé un autre témoin, et qu’il avait pleins pouvoirs pour discuter avec lui les préparatifs du combat. Le marquis s’inclina avec un salut cérémonieux, puis lui fit voir les pistolets.
—Je les ai apportés d’Europe; ils ont servi plus d’une fois en des circonstances aussi graves que celle qui nous occupe. Examinez-les avec soin; nous n’en avons pas d’autres, les deux parties doivent donc les accepter.
L’employé répondit qu’il jugeait inutile de les vérifier et qu’il acceptait toutes les décisions du marquis.
Torrebianca continua de parler avec une noble dignité qui impressionnait vivement Moreno.
«Le pauvre homme, pensait-il, ignore sa véritable situation. C’est un homme de cœur et d’honneur: un vrai gentilhomme qui ne sait rien des{217} actes de sa femme et du triste rôle qu’il va jouer.»
Tandis que l’Argentin le regardait avec une sympathie apitoyée, le marquis ajouta:
—Aucun des deux adversaires ne veut faire d’excuses et les injures sont extrêmement graves; nous devons donc décider que le duel sera un duel à mort. N’est-ce pas votre avis, Monsieur?
L’employé s’était rendu compte de l’importance de cette conversation. Très grave, il approuva silencieusement de la tête.
—Mon client, continua le marquis, n’admet pas moins de trois balles échangées à vingt pas avec faculté de viser pendant cinq secondes.
Moreno battit des paupières, consterné, et parut sur le point de rejeter des conditions pareilles; mais il se souvint d’un dernier entretien qu’il avait eu avec Pirovani le matin même avant de partir pour l’estancia de Rojas.
L’Italien avait paru transfiguré par un enthousiasme belliqueux. Il se félicitait qu’une occasion lui fût donnée de prendre devant «Madame la Marquise» la figure d’un héros de roman. «Acceptez toutes les conditions, avait-il dit à Moreno, aussi terribles soient-elles. Je veux montrer que si j’ai débuté comme simple ouvrier, j’ai plus de bravoure et de vraie noblesse que ce capitaine.»
L’employé se résigna donc à faire de la tête un nouveau signe affirmatif.
—Ce soir, continua le marquis, les quatre témoins se réuniront chez Watson pour arrêter les conditions par écrit, et la rencontre aura lieu demain à la première heure.
Le témoin de Pirovani fit savoir que don Carlos Rojas ne pourrait assister à la réunion, car il était allé à Fort Sarmiento chercher un médecin qui assisterait au combat; mais lui-même signerait en{218} son nom tous les documents utiles. Et les deux témoins se séparèrent.
En sortant de la maison, Moreno aperçut près du perron le commissaire de police qui semblait l’attendre. Don Roque l’interpella avec indignation:
—Vous vous figurez sans doute que vous pouvez faire ici tout ce qu’il vous plaît, et que dans ce pays il n’y a ni autorité ni loi ni règle, comme au temps des Indiens. Je suis commissaire de police, sachez-le bien, et j’ai le devoir d’empêcher les gens de faire des folies. Dites-moi à quel moment aura lieu le duel... J’ai besoin de le savoir.
Moreno refusa de le dire, et devant son entêtement le commissaire prit un ton plus aimable.
—Dites-le moi, et ne faites pas le malin. Songez qu’il n’est pas convenable que des choses pareilles se passent ici, moi présent. Dites-moi l’heure de l’affaire pour que je puisse m’éloigner avant.
Le témoin lui parla à l’oreille, et don Roque lui serra la main pour le remercier de sa confidence. Ensuite, il alla prendre son cheval qui se trouvait à proximité et, le pied déjà dans l’étrier, il dit à voix basse:
—Je vais passer la nuit à Fort Sarmiento, et je ne serai pas de retour avant demain soir... Faites ce que vous voudrez... Je ne sais rien.{219}
Les clients les plus attardés du bar commençaient à se retirer quand Robledo arriva devant la maison où logeait Hélène.
Il gravit à pas silencieux le perron et après un moment d’hésitation il frappa discrètement. La porte s’ouvrit bientôt et Sébastienne parut; cet appel l’avait surprise au moment où elle allait se coucher. Ses cheveux raides étaient divisés en une infinité de tresses, nouées chacune d’un petit lacet, et elle s’efforçait de dissimuler sous la masse énorme de ses bras une partie de sa gorge cuivrée et puissante, que son corsage dégrafé laissait à découvert. Ses yeux furibonds prédisaient à l’importun une avalanche d’insultes, mais ils s’adoucirent à la vue de Robledo, et elle dit aimablement avant même qu’il eût prononcé un mot:
—La patronne est dans sa chambre et le marquis est parti avec sa maudite boîte de pistolets. Je croyais qu’il était avec vous... Entrez, don Robledo; je vais prévenir Madame.{220}
L’ingénieur n’ignorait pas que Torrebianca se trouvait chez lui avec les autres témoins; mais il avait besoin de parler immédiatement à Hélène. Pourtant, il recula en voyant Sébastienne ouvrir la porte toute grande pour l’inviter à entrer. Il eut peur de se trouver seul avec la marquise dans la salle. Il fallait que leur entrevue fût courte. D’ailleurs le mari pouvait arriver et il lui serait difficile d’expliquer sa présence dans la maison, alors qu’il venait de le voir et de lui parler dans sa propre demeure.
—Je n’ai pas grand’chose à dire à ta patronne... Il vaut mieux qu’elle vienne à la fenêtre de sa chambre.
La métisse ferma la porte et Robledo, avançant sur la galerie extérieure, passa devant plusieurs fenêtres. Un instant après, l’une d’elles s’ouvrit et la marquise s’y montra, les cheveux dénoués; un peignoir négligemment jeté sur ses épaules laissait à découvert une grande partie de ses bras et de sa gorge.
Elle s’était habillée précipitamment, et semblait effrayée; avant même que Robledo l’eût saluée elle demanda d’une voix angoissée:
—Un malheur est arrivé à Watson? Pourquoi venez-vous ici à pareille heure?
Robledo sourit ironiquement avant de répondre.
—Watson est en bonne santé, et si je viens à pareille heure, c’est pour vous parler d’un autre homme.
Puis il fixa sur elle un regard sévère et continua lentement:
—Au lever du soleil deux hommes vont s’entretuer. Cette tragique folie m’ôte le sommeil, et je suis venu vous dire: «Hélène, empêchez ce malheur.»{221}
Sûre maintenant que Watson était sauf, elle répondit avec humeur:
—Que voulez-vous que j’y fasse? Ils peuvent bien se battre si cela leur plaît... C’est le fait des hommes.
Robledo fut consterné de cette cruauté.
—Je ne suis qu’une femme, continua-t-elle, mais ces combats ne m’effraient pas. Frédéric s’est battu une fois pour moi peu de temps après notre mariage. Là-bas, dans mon pays, plus d’un homme a risqué sa vie pour m’être agréable, et je n’ai jamais essayé de l’empêcher.
Elle eut une moue de mépris et ajouta:
—Vous voudriez que j’aille prier ces deux messieurs de ne pas risquer leur précieuse vie, pour qu’ensuite chacun d’entre eux vienne me réclamer quelque faveur en échange de son obéissance?... D’ailleurs, si j’intervenais dans cette affaire ils croiraient tous deux qu’ils m’inspirent beaucoup d’intérêt, et je me moque de l’un et de l’autre... S’il s’agissait d’un autre homme, peut-être céderais-je à votre prière.
L’Espagnol hocha la tête en entendant ces mots: «autre homme», et un instant l’image de son associé lui apparut. Hélène le regardait maintenant avec pitié.
—Dormez tranquille, Robledo, comme je vais dormir moi-même. Laissez ces deux orgueilleux annoncer qu’ils vont se tuer. Il n’arrivera rien de grave, vous verrez.
Elle s’écarta un peu de la fenêtre, par peur des jejenes et de tous les insectes sanguinaires qui, attirés par sa chair appétissante, commençaient à bourdonner autour de ses épaules et l’obligeaient à les chasser de la main tout en parlant.
—Si vous voyez Watson, dites-lui que je l’ai attendu toute la journée. Avec cette histoire de duel{222} on ne peut plus lui parler... A demain, passez une nuit bien tranquille.
Elle ferma la fenêtre en simulant une peur enfantine des moustiques et Robledo découragé dut se retirer.
A cette heure même, l’ingénieur Canterac écrivait sur sa table de travail et terminait une longue lettre par ces mots «telle est ma dernière volonté; je compte sur vous pour l’exécuter. Adieu, chère femme! adieu mes enfants! Pardonnez-moi.»
Il plia le papier pour l’introduire dans l’enveloppe qu’il plaça ensuite dans la poche intérieure d’une redingote suspendue à côté de lui.
«Si je tombe demain, pensa-t-il, on trouvera cette lettre sur ma poitrine. Je chargerai Watson, avant le duel, de l’envoyer à ma famille au cas où je mourrais.»
Une heure après, son adversaire entrait chez Moreno. L’employé revenait de la réunion où il avait rencontré les témoins de Canterac. Pirovani lui parla d’une voix lente en s’efforçant de cacher son émotion.
Il venait de déposer sur la table de Moreno deux lettres dont l’une, très volumineuse, était sous enveloppe ouverte. Il avait écrit pendant une partie de la nuit dans son logement pour résumer dans ces deux lettres l’état de ses affaires. Il montra la plus mince et dit:
—Celle-ci est pour ma fille. Vous la lui enverrez si je meurs.
L’Argentin s’efforça de rire pour montrer qu’il ne croyait pas à la possibilité de sa mort et que de telles paroles méritaient seulement qu’on s’en amusât. Mais il ne persista guère dans sa gaîté factice car la voix de l’entrepreneur restait grave.
—Dans l’enveloppe la plus épaisse vous trouverez une procuration en règle qui vous permettra de tou{223}cher sans difficulté ce que le gouvernement me doit, et les sommes que j’ai en dépôt dans les banques. Vous êtes habile et vous n’aurez pas de peine à vous rendre compte, en examinant ces papiers, de l’état de mes affaires et à trouver le meilleur moyen de les liquider. J’ai fait aussi un testament qui vous nomme tuteur de ma fille. Vous êtes le seul homme en qui j’aie confiance. Sans doute vous avez penché plus d’une fois du côté de mon adversaire plutôt que du mien, mais cela importe peu. Je sais que vous êtes un honnête homme et je vous confie ma fille et ma fortune; tout ce que je possède au monde.
Moreno fut si touché par cette marque de confiance qu’il dut porter une main à ses yeux. Puis il se leva, serra avec force la main de l’Italien et d’une voix entrecoupée il lui promit d’exécuter fidèlement toutes ses recommandations. Il jura de protéger la fille et la fortune de son ami, si celui-ci venait à mourir le lendemain.
—Mais vous ne mourrez pas, ajouta-t-il en se frappant la poitrine. Mon cœur me le dit.
Peu après le lever du soleil quelques hommes s’assemblaient dans une prairie couverte d’une herbe maigre, au bord du fleuve. Elle était bornée par quelques vieux saules aux racines mi-découvertes qui se penchaient, moribonds, au-dessus de l’eau comme si, d’un moment à l’autre, ils dussent s’écrouler dans le courant.
L’endroit était triste. A cette heure où la lumière arrivait horizontalement, presque au ras du sol, les ombres des êtres et des arbres s’étiraient en un allongement bizarre.
Pirovani arriva le premier, escorté de Moreno et de don Carlos; tous étaient vêtus de noir, mais une redingote neuve et solennelle distinguait l’entrepreneur de ses compagnons. Il l’avait reçue de Buenos-Ayres la semaine précédente; elle sortait de chez un{224} tailleur fameux à qui il avait commandé une garde-robe complète aussi riche que celle des millionnaires les plus élégants de la ville.
Derrière ce groupe s’avança un long et maigre vieillard; il avait le nez violacé et bourgeonné des alcooliques et portait une trousse de chirurgien sous le bras. C’était le médecin que Rojas était allé chercher à l’agglomération voisine la veille au soir.
Quelques minutes après, Canterac, Torrebianca et Watson arrivèrent dans la prairie. Le capitaine et le marquis portaient de longues redingotes, moins resplendissantes que celle de Pirovani, et des cravates noires: on eût dit qu’ils allaient assister à un enterrement. Watson portait seulement un costume sombre.
Après avoir fait de loin un salut cérémonieux à son adversaire et à ses témoins, Canterac commença d’aller et de venir au bord du fleuve. Il feignait de s’amuser à suivre des yeux le vol capricieux des oiseaux du matin, ou à lancer des pierres dans le courant. L’entrepreneur, qui tenait à ne pas paraître inférieur, imitait tous ses gestes et se mit aussi à marcher près des saules en regardant le fleuve. Tous deux continuèrent ainsi à se déplacer d’un pas d’automate chacun dans la partie de la rive qui lui était assignée.
Torrebianca, que son expérience en ces matières désignait pour le premier rôle, commença les préparatifs du combat. Il demanda à Watson deux cannes que celui-ci avait eu la précaution d’emporter, et en planta une dans le sol. Puis, une main sur les yeux, il regarda dans la direction du soleil pour s’assurer exactement de quel côté venait la lumière, et il se mit à marcher en comptant ses pas.
—Vingt, dit-il, en plantant dans le sol la seconde canne.
Il rejoignit à nouveau les témoins, prit une pièce{225} de monnaie et, après avoir interrogé Moreno, il la lança en l’air. Quand la pièce retomba, l’employé dit à Rojas.
—Nous avons gagné, don Carlos; c’est à nous de choisir la place.
Le marquis, qui avait apporté sous son bras sa fameuse boîte de pistolets, la laissa ouverte sur l’herbe. Il chargea les deux armes avec lenteur et minutie puis reprit la même pièce de monnaie pour laisser le hasard décider encore. Quand la rondelle de métal fut retombée, l’employé se pencha pour la voir et dit à l’estanciero:
—La chance est pour nous. Nous pouvons choisir aussi le pistolet.
Les témoins de Pirovani allèrent ensuite chercher leur client et le placèrent à côté de la canne qui marquait l’emplacement choisi par eux. Le marquis et Watson conduisirent leur ami à côté de la seconde canne.
Cependant, le médecin, quelque peu affairé, se préparait de son côté. C’était la première fois qu’il assistait à un duel. Il avait ouvert sa trousse de chirurgien et, un genou en terre, il s’était mis à dérouler des bandages, à ouvrir des fioles et à vérifier le fonctionnement de ses appareils.
Les deux adversaires restèrent face à face. Canterac se tenait raide, avec le visage grave et sans expression du soldat qui attend un commandement. Pirovani avait les yeux ardents, le regard haineux, le visage furieux. Quand Moreno s’approcha pour lui remettre le pistolet, il lui dit à voix basse:
—Je vais le tuer, vous allez voir. C’est mon cœur qui me le dit.
Mais il oublia un instant son optimisme cruel pour ajouter avec une certaine anxiété:
—Je veux qu’on m’explique bien de combien de temps je dispose pour viser. Je ne veux pas me trom{226}per pour qu’on ne dise pas ensuite que je suis un rustre incapable de comprendre ces choses.
Les deux ennemis prirent leurs pistolets, le canon levé. Moreno prit soin de boutonner la redingote de Pirovani qui était dégrafée. Puis il lui releva le col pour cacher le blanc de la chemise. Torrebianca, de son côté, examina Canterac. Il était correctement boutonné comme un militaire, mais son témoin lui releva aussi le col de la redingote. Tous deux avant de prendre leur arme avaient quitté leur chapeau et l’avaient remis à un de leurs témoins.
Le marquis se plaça entre les deux adversaires, sortit un papier de sa poche et se mit à lire avec lenteur et gravité.
«Deuxièmement. Le directeur du combat frappera trois coups dans ses mains et les adversaires pourront viser et faire feu à volonté entre le premier et le troisième coup.
»Troisièmement. Si l’un des deux adversaires faisait feu après le troisième coup, il serait déclaré félon et disqualifié immédiatement.»
Pirovani, le pistolet levé, avançait la tête, les yeux à demi fermés pour mieux entendre, et approuvait du menton chacune des paroles de Torrebianca. Canterac demeurait impassible; il semblait connaître depuis longtemps ce qu’il venait d’entendre.
Le marquis continua sa lecture, puis, repliant son papier, il adressa la parole aux deux adversaires:
—Mon devoir est de faire un dernier appel à la concorde. Peut-on espérer encore la réconciliation de deux hommes d’honneur? L’un d’entre vous consent-il à présenter ses excuses à l’autre?
Pirovani secoua violemment la tête. L’ingénieur demeura immobile et pas une ligne de son visage durci ne bougea.
Le marquis reprit la parole, ôtant son chapeau avec une courtoisie attristée.{227}
—Alors, que le combat commence et que chacun se comporte en galant homme.
Il recula de quelques pas sans perdre de vue les combattants. Puis il leva la main et leur demanda s’ils étaient prêts. Pirovani fit un signe affirmatif. Son adversaire restait immobile et muet. Le marquis sépara ses deux mains pour frapper le premier coup. La lenteur de ses mouvements leur communiquait comme une solennité tragique.
Les autres témoins placés à quelque distance de lui regardaient avec une émotion mal dissimulée. Le médecin, toujours agenouillé à côté de sa trousse, leva la tête et ouvrit de grands yeux.
Torrebianca rapprocha ses mains et dit lentement:
—Feu!... Un...
Les deux adversaires abaissèrent ensemble leur pistolet.
Pirovani, qui à ce moment était surtout préoccupé de ne pas faire feu après le troisième coup, se hâta de tirer. Son ennemi cligna légèrement un œil et contracta un peu la joue du même côté, comme s’il eût senti le vent du projectile. Mais il recouvra immédiatement son impassibilité farouche et continua de viser.
Le marquis frappa un second coup dans ses mains, et dit lentement: «Deux».
Pirovani restait désarmé devant un adversaire indemne. Le frisson de la peur passa sur son visage comme un nuage rapide; mais ce ne fut qu’un instant. Aussitôt après, il regarda Canterac qui le visait encore, se croisa les bras, appuya contre sa poitrine le pistolet inutile et présenta tout son corps de face avec une folle jactance, comme pour défier la mort.
Moreno, que son angoisse forçait à chercher un appui, saisit l’épaule de Rojas. L’estanciero avait les lèvres serrées.
—Il va le tuer, pucha!... dit-il entre ses dents.{228}
Le directeur du combat frappa le troisième coup: «Trois». Canterac venait de faire feu. Tous coururent dans la même direction, sauf le capitaine qui demeura immobile, le bras pendant, le pistolet encore fumant à la main.
L’entrepreneur gisait, face contre terre, comme une masse inerte. Ceux qui couraient vers lui virent d’abord le sommet de sa tête d’où sortait un filet de sang qui serpentait dans l’herbe. Brusquement, cette tête ne fut plus visible car tous les assistants venaient de se masser autour du corps étendu, et se penchaient pour écouter le médecin qui l’examinait, un genou en terre.
Quelques instants après, le docteur releva la tête et, tout ému, balbutia:
—Il n’y a rien à faire!... Il est mort!
Torrebianca vit Canterac s’approcher du groupe pour s’informer de ce qui venait d’arriver; il vint à sa rencontre et lui barra le passage. Le marquis n’avait prononcé aucune parole, mais son visage révéla à l’ingénieur la vérité.
Il fallait l’éloigner de cet endroit et son témoin l’invita impérieusement à le suivre. Derrière les dunes attendait la voiture qui avait mené Hélène à la fête.
Quand ce véhicule les eut laissés devant l’ancienne maison du mort, tous deux s’arrêtèrent, hésitants. Torrebianca ne pouvait inviter Canterac à entrer dans un logis qui appartenait à Pirovani, et l’autre n’osait, lui non plus, avancer.
Tous deux demeuraient immobiles, sans trouver rien à se dire, quand Robledo parut. Depuis longtemps il devait rôder autour de la maison pour apprendre plus tôt les nouvelles. Reconnaissant Canterac, il le regarda d’un air interrogateur:
—Et l’autre?
Canterac courba la tête et l’expression doulou{229}reuse qu’eut le visage du marquis indiqua à Robledo ce qui était arrivé.
Tous trois demeurèrent silencieux. Puis le Français dit à voix basse:
—Ma carrière est brisée, j’ai perdu ma famille... Et le plus terrible, c’est qu’en pensant à ce malheureux, je n’éprouve aucun sentiment de haine. Que vais-je devenir?
Seul des trois, Robledo était capable en ce moment de prendre une résolution énergique.
—D’abord il faut fuir, Canterac. L’affaire fera grand bruit, et on ne pourra pas l’étouffer, comme une rixe de cabaret. Passez les Andes au plus tôt; de l’autre côté il y a le Chili, et là-bas vous pourrez attendre... Tout s’arrange dans le monde; bien ou mal sans doute, mais tout s’arrange.
Le Français répondit d’un ton découragé. Il n’avait pas d’argent, il avait tout dépensé pour cette fête qui maintenant lui paraissait stupide. Comment vivrait-il au Chili où il ne connaissait personne?
L’Espagnol lui prit le bras et l’entraîna affectueusement.
—Avant tout, il faut fuir, dit-il encore. Je vous donnerai les moyens de le faire. Allons nous-en.
Canterac se refusait à obéir, et il regardait Torrebianca.
—Je voudrais, avant de partir, murmura-t-il, faire mes adieux à la marquise.
Il formula cette demande sur un ton si suppliant que Robledo ne put retenir un sourire de pitié. Puis il l’entraîna avec une paternelle énergie.
—Ne perdons pas de temps, dit-il. Ne vous occupez que de vous-même. La marquise a bien autre chose à penser.
Et il le conduisit chez lui.
Pendant toute la journée l’événement mit le village en ébullition. Beaucoup d’ouvriers en profitèrent{230} pour abandonner le travail. Dans la rue centrale des groupes nombreux d’hommes et de femmes discutaient avec animation, tout en regardant avec colère l’ancienne maison de Pirovani. Le nom de Torrebianca et celui de sa femme revenaient souvent, mêlés à ceux des deux adversaires.
Quelques gauchos amis de Manos Duras passèrent au milieu des habitants du village comme si l’événement récent avait entièrement éteint la haine qui les divisait.
Vers le milieu de l’après-midi Manos Duras lui-même traversa la rue centrale et regarda avec curiosité vers la maison. Quelques métisses lui adressèrent la parole, s’emportant contre cette grande dame qui faisait perdre l’esprit aux hommes. Mais le fameux gaucho haussa les épaules, sourit avec mépris et continua son chemin.
Au cabaret, l’attendaient trois de ses amis qui vivaient pendant la plus grande partie de l’année au pied des Andes et qui étaient venus passer quelques jours dans son rancho. A tout autre moment don Roque se fût alarmé de cette visite. Peut-être préparaient-ils quelque vol important de bétail, et se disposaient-ils à faire passer la Cordillère aux animaux pour aller les vendre au Chili. Mais pour l’instant les notables de la Presa donnaient plus de travail au commissaire que les voleurs de bœufs.
Quand Manos Duras pénétra dans le magasin du Gallego, il s’aperçut que le public était plus nombreux que les autres jours de travail, et qu’on parlait dans tous les groupes de la mort de l’entrepreneur. Tout en buvant, debout devant le comptoir, il écouta les commentaires des clients.
—C’est cette femelle qui est cause de tout, criait l’un d’eux. Ah! la p.....!
Manos Duras se rappela le jour où il avait rencontré la marquise pour la première fois et regarda{231} d’un air provocant celui qui venait de parler, comme s’il avait reçu lui-même l’outrage.
—Deux hommes se sont battus à mort pour cette femme; eh bien, quoi?... Moi aussi je suis prêt à sortir mon couteau et à me battre contre le premier qui l’insultera. Voyons s’il se trouvera un homme assez courageux pour mettre le pied sur mon poncho.
Inviter les gens à mettre le pied sur son poncho, c’était une façon de lancer un défi en vrai gaucho. Après un court silence, les clients se mirent à parler d’autre chose.
Torrebianca parut vers le soir à une fenêtre de sa maison et vit avec étonnement les groupes assemblées dans la rue. Leur nombre avait augmenté. Le commissaire de police qui venait d’arriver de Fort Sarmiento marchait au milieu d’eux et exhortait les uns et les autres à se retirer. Apercevant le marquis à sa fenêtre, il ôta son chapeau pour le saluer.
Hommes et femmes se mirent à regarder fixement le mari d’Hélène, avec une curiosité hostile, mais nul n’osa manifester contre lui.
Torrebianca ne laissa pas que d’être surpris par les regards inquiétants que lançaient tous ces yeux fixés sur lui. Il dut supposer une impopularité dont il ne s’expliquait pas la cause, et il ferma ses fenêtres avec une dignité hautaine et triste.
Au bout de quelques minutes, Sébastienne ouvrit la porte de la maison et vint s’appuyer à la balustrade de la galerie extérieure. Ces groupes nombreux, où elle reconnaissait plusieurs de ses vieilles amies, l’attiraient. Mais, dès que les femmes assemblées dans la rue l’aperçurent, elles se mirent à gesticuler et à lui crier des injures.
Piquée de cet étrange accueil, elle finit par répondre sur le même ton; mais elle dut bientôt battre en retraite, écrasée par la supériorité numérique de{232} ses adversaires, que beaucoup d’hommes soutenaient à grand renfort de rires et de mots crus. En réfléchissant dans sa cuisine, elle entrevit la vérité; toutes les femmes du village, même ses meilleures commères, seraient contre elle tant qu’elle resterait au service de la marquise.
La nuit tombait quand Watson entra dans le village. Après le terrible événement du matin, il avait dû s’occuper du cadavre de Pirovani et il était parti avec les témoins de l’Italien et le médecin. Ils l’avaient d’abord déposé dans un rancho en ruines, près du fleuve. Puis ils s’étaient décidés à le transporter à Fort Sarmiento, puisqu’en fin de compte on devait l’enterrer au cimetière de là-bas. Ils éviteraient ainsi les manifestations qui auraient pu se produire à la Presa si on y avait transporté le cadavre.
Watson revenait donc de Fort Sarmiento et il avait déjà dépassé les premières maisons du campement quand il rencontra Canterac.
Le Français, à cheval lui aussi, avait pris le chapeau et le poncho des cavaliers du pays; il portait sur le devant de sa selle un sac plein de hardes et de vivres.
Le jeune homme le reconnut et s’arrêta pour lui serrer la main. Il devina qu’il ne le reverrait plus car son équipement était celui du voyageur qui se prépare à traverser la plaine déserte de Patagonie.
Canterac répondit à ses questions en lui montrant l’horizon où commençaient à briller les premières étoiles, du côté des Andes invisibles. Puis il lui confia son projet de passer la nuit dans une estancia près de Fort Sarmiento et de se remettre en marche au point du jour.
—Adieu, Watson, dit-il. Il aurait mieux valu pour nous tous que cette femme ne fût jamais venue{233} dans le pays. Je vois maintenant les choses sous un autre jour, mais il est trop tard, hélas!
Indécis, il regarda quelques instants Richard, puis il ajouta résolument:
—Ecoutez le conseil que vous donne un malheureux, et ne vous fâchez pas si je vous le donne sans que vous me l’ayez demandé. Ne vous séparez jamais de Robledo, c’est un noble cœur. C’est grâce à sa bonté que je peux partir... Tout ce que j’emporte lui appartient... Ne croyez pas ceux qui vous diront du mal de lui...
Ses yeux tristes se fixèrent avec intention sur le jeune homme tandis qu’il prononçait ces derniers mots. Avant de s’éloigner il osa encore lui donner un nouveau conseil.
—Et que nulle autre femme ne vous fasse oublier cette jeune fille qu’on appelle «la Fleur du Rio Negro».
Il lui serra la main, lui fit un signe d’adieu, puis baissant la tête il éperonna son cheval et se perdit dans la nuit qui tombait.{234}
Lorsque Watson reprit le chemin du village, des scrupules commençaient à troubler la sérénité de sa conscience.
Il se rappelait avec remords le bref dialogue dans le parc improvisé et les mots durs qu’il avait adressés à Robledo. «Et c’est pour cette femme qui conduit les hommes à la mort, pensa-t-il, que j’ai rudoyé le meilleur de mes amis».
Ensuite, le visage triste et mouillé de larmes de Celinda remplaçait dans son imagination la face pleine de bonté de Robledo.
«Pauvre Fleur du Rio Negro», se dit-il encore. J’irai demain implorer son pardon si elle veut bien m’entendre».
Il était tout absorbé en arrivant à la Presa, et se laissait guider par l’instinct de sa monture; soudain, il sentit que son cheval avait envie de s’arrêter: il leva la tête et se rendit compte qu’il se trouvait devant la maison de Torrebianca.
Le commissaire de police à l’aide de deux de ses{235} hommes refoulait doucement le dernier groupe de badauds et les accompagnait avec des exhortations paternelles.
Don Roque s’éloigna et Richard se préparait à se remettre en marche quand il vit s’entr’ouvrir une fenêtre de la maison et une main de femme lui faire signe d’approcher. Watson resta insensible à cet appel et la fenêtre s’ouvrit toute grande laissant voir Hélène vêtue de noir; elle semblait en deuil, mais elle portait ces funèbres vêtements avec une certaine coquetterie.
Richard dut s’approcher de la maison et ôta son chapeau pour répondre aux gestes affectueux de la marquise.
—Nous sommes restés bien longtemps sans nous voir!... Entrez tout de suite.
Il secoua la tête et la regarda d’un air sévère.
—Vous ne me demandez pas de qui je porte le deuil? continua-t-elle. La mère de mon mari est morte et je l’aimais beaucoup. Je suis triste... Si vous saviez quel besoin j’éprouve en ce moment de causer avec un véritable ami.
Elle essayait de donner à ses paroles un accent douloureux, tout en l’invitant avec des gestes séducteurs à entrer dans la maison. Mais Richard continua de secouer la tête et dit enfin:
—Je viendrai vous rendre visite quand vous habiterez une autre maison et quand votre mari sera là. Maintenant, je ne puis.
Et il s’éloigna sans tourner la tête tandis qu’elle passait de la surprise à la colère et qu’elle se décidait à refermer violemment sa fenêtre.
Après le repas, Watson voulut s’excuser auprès de Robledo et le pria de lui pardonner sa brutalité; mais l’Espagnol lui imposa silence:
—Ne parlons plus du passé; notre amitié reste entière, notre petit heurt est sans importance. Ce{236} qui est terrible c’est le sort de Pirovani et la situation où se trouve Canterac... Je comprends que ses paroles vous aient fait impression. Pauvre homme! Il n’a voulu accepter que ce qui lui était strictement nécessaire pour son voyage à travers la Cordillère. Il m’a dit qu’il attendrait de mes nouvelles au Chili. J’essaierai d’obtenir pour lui, de mes amis de Buenos-Ayres, quelques recommandations. Quelle catastrophe! Et tout cela pour une femme!
Robledo demeura pensif, puis son optimisme reprit le dessus et il affirma:
—Je ne la crois pas foncièrement mauvaise. C’est une femme impulsive, aux passions mal asservies, et qui sème le mal le plus souvent sans s’en douter, parce que toute son attention porte sur sa propre personne qu’elle prend pour le centre de tout ce qui existe. Riche, peut-être serait-elle bonne; mais elle ignore la modestie et elle est incapable de se résigner au sacrifice. Elle désire tant de choses et elle en possède si peu!
Il sourit avec mélancolie, se tut un instant puis reprit:
—Fort heureusement, toutes les femmes ne se ressemblent pas. Elle-même m’a dit un jour qu’à notre époque la femme qui pense un peu se croit malheureuse et déteste ce qui l’entoure si elle ne possède pas le collier de perles qui est comme l’uniforme de la femme moderne... Il est un être, mon cher Watson, plus redoutable encore que la femme qui veut à tout prix acquérir son collier de perles, c’est celle qui l’a possédé, qui l’a perdu et qui veut à tout prix le regagner.
Dans sa mémoire passa le souvenir de Gualicho ce démon sournois dont les ruses harcèlent les Indiens et qui les force à monter à cheval pour le chasser à coups de lance et de boléadoras. Si Hélène était demeurée dans l’ancien monde, elle n’eût été qu’une{237} d’entre ces femmes dont le charme redoutable s’atténue et se neutralise par le voisinage d’autres femmes pareilles. Ici, entourée d’hommes qui l’admiraient, dans ce milieu primitif qui la faisait ressortir comme un être d’essence supérieure, elle avait exercé sans le vouloir une influence aussi désastreuse que celle du démon rouge que redoutaient jadis les cavaliers errants de la Pampa.
Elle même avait été victime de l’isolement quand elle s’était éprise de Watson. Elle avait cru pouvoir se jouer des hommes et les mépriser. Elle l’avait confié à Robledo un soir, en regardant avec pitié ses poursuivants. Mais Richard était la jeunesse, la santé virile, l’objet adoré du premier amour d’une jeune fille et par cela même il représentait la tentation pour une coquette déjà mûre qui devait désirer l’enlever à une autre femme. Elle avait besoin de se prouver à elle-même qu’elle avait conservé son ancien pouvoir de séduction en bouleversant l’existence du jeune ingénieur.
Et maintenant sans doute, elle souffrait cruellement dans sa vanité en se voyant dédaignée par le seul homme qui, dans ce désert, eût réussi à l’intéresser.
Robledo finit par montrer une pitié un peu méprisante pour la femme de Torrebianca.
—Elle se croit née pour vivre sur les sommets et le malheur semble se complaire à la jeter à bas... Il est naturel qu’elle soit mauvaise puisqu’elle n’a pour se consoler, ni modestie, ni résignation.
Puis l’Espagnol envisagea non sans alarme les conséquences des malheurs de ce matin.
—L’entrepreneur mort... l’ingénieur en chef en fuite... Il faudra suspendre les travaux... La construction de la digue va subir un retard et les crues arriveront avant qu’elle soit achevée. Quelle situation!{238} Il faut nous rendre à Buenos-Ayres et provoquer des décisions rapides.
Pendant une grande partie de la nuit ses préoccupations l’empêchèrent de s’endormir.
Le lendemain matin, Watson monta à cheval, mais au lieu de se diriger vers les chantiers des canaux, il prit le chemin de l’estancia de Rojas. Tant que le gouvernement n’aurait pas envoyé un nouveau directeur chargé d’achever la construction de la digue, les travaux entrepris par Robledo seraient inutiles; il était prudent de les suspendre.
Arrivé près de l’estancia, il voulut descendre de cheval pour ouvrir une tranquera, sorte de claie formée de gros bâtons qui servait de porte à la clôture. Mais il aperçut tout contre elle un petit métis joufflu d’une dizaine d’années, aux yeux veloutés d’antilope, au teint brillant couleur chocolat clair, qui le regardait en souriant, un doigt dans le nez.
—Le patron est parti comme une bombe ce matin... dit-il, on nous a volé une vache hier au soir.
Mais Richard l’interrogea sur un point qui l’intéressait bien davantage.
—Et ta petite patronne, Cachafaz?
L’enfant qu’on appelait Cachafaz[25] à cause de ses espiègleries retira son index de la narine, où il l’avait fourré et montra la plaine.
—Elle vient de partir tout de suite, tout de suite... Vous la trouverez par là, tout près.
Et son doigt montrait toute l’étendue de l’horizon. Watson comprit que pour l’ami Cachafaz, enfant du désert, «tout de suite, tout de suite» signifiait une heure, peut-être même deux ou trois, et par «là tout près» environ deux ou trois lieues.
Mais il voulait voir Celinda, il était décidé à la{239} chercher et, se fiant à son étoile, il se lança au galop dans la plaine.
Ce que le petit métis ne dit pas c’est que la petite patronne était malade, de l’avis de sa mère, vieille Indienne qui était venue remplacer Sébastienne comme première servante de l’estancia, mais qui n’avait ni la bonne humeur ni l’activité de la métisse. Un cigare du Paraguay pendait continuellement au bout de ses lèvres bleuâtres et dégouttantes de nicotine, et quand don Carlos était absent elle se servait pour boire du maté de la calebasse ouvragée et du chalumeau d’argent du patron lui-même. Les gens de l’estancia éprouvaient pour la mère de Cachafaz un respect superstitieux. On la croyait sorcière et on supposait qu’elle entretenait des rapports cachés avec les esprits qui hurlent et tourbillonnent dans les colonnes de sable hautes comme des tours que l’ouragan soulève sur le plateau. L’Indienne, qui avait remarqué la mélancolie de Celinda et surpris plusieurs fois ses larmes, secouait la tête comme si ces constatations eussent confirmé son opinion.
—Il n’y a pas de doute, fillette, vous êtes malade et je connais votre maladie.
Un de ses ancêtres avait été un grand magicien à l’époque où les Indiens étaient seuls maîtres dans ce pays où ils campaient.
Les chefs de tribus l’appelaient quand ils se sentaient malades. Son père avait hérité de ce trésor de science, mais il ne lui en avait malheureusement transmis qu’une infime partie.
—Ce sont les ayacuyas qui vous tourmentent et il faut vous guérir des blessures de leurs flèches.
Elle connaissait bien les ayacuyas, ces génies indiens si petits que douze d’entre eux tenaient sur un ongle, génies armées d’arcs et de flèches dont les blessures sont la cause certaine de la plupart des maladies.{240}
Elle même, pauvre ignorante ne les avait jamais vus; mais son aïeul et son père, les grands machis (sorciers guérisseurs), avaient eu de fréquentes relations avec ces diables minuscules. Seuls les indigènes les plus savants arrivaient à les connaître. Des médecins gringos prétendaient les avoir vus également et les avaient appelés dans leur langage des microbes, mais que pouvaient-ils savoir!
Quand ils n’avaient plus de flèches pour blesser les hommes ils les attaquaient à coup d’ongles et de dents. L’essentiel était de savoir extraire en incisant ou en suçant les chairs du malade les éclats de flèches, les ongles ou les dents que les diables invisibles avaient laissés dans son corps.
—Je vous chercherai un machi qui vous guérira, fillette, et vous tirera du corps cette tristesse que vous ont donnée les ayacuyas. Mais que le patron n’en sache rien.
Les remèdes proposés par la mère de Cachafaz faisaient sourire Celinda. Lorsqu’elle était lasse de vivre enfermée dans l’estancia elle prenait son cheval et galopait sans but dans la plaine. Elle ne s’habillait plus en garçon; elle avait pris en horreur ce costume qui lui rappelait trop de souvenirs. Elle aimait mieux monter en amazone et elle oubliait le lasso qui était autrefois son amusement favori.
Elle avait déjà galopé pendant une heure ce matin-là à travers les terres de son père, quand elle aperçut sur une hauteur un cavalier immobile qui, rapetissé par la distance, semblait un soldat de plomb.
Elle s’arrêta en remarquant que ce cavalier minuscule, qui semblait l’avoir reconnue, descendait la pente au galop et se dirigeait vers elle. Un instant elle cessa de le voir, puis il reparut considérablement agrandi et longeant un bas-fond voisin. C’était certainement Watson. Son premier mouvement fut de fuir.{241}
Mais elle se repentit bientôt de cette dérobade qui lui parut une lâcheté et elle s’arrêta dans une attitude pleine de dédain.
Arrivé près d’elle, Richard ôta son chapeau en baissant humblement les jeux. Il voulait parler, mais il ne trouvait pas ses mots. D’ailleurs elle ne lui laissa pas le temps de s’expliquer.
—Que cherchez-vous? dit-elle durement. Votre gringa vous a donc congédié? Je n’ai que faire des déchets.
Elle fit faire demi-tour à son cheval pour s’éloigner.
Richard voulut l’attendrir et dit d’une voix suppliante:
—Celinda, je viens vous témoigner mon repentir... Je viens retrouver ma Fleur du Rio Negro.
Le ton d’humilité enfantine que prenait ce solide garçon parut l’émouvoir, mais bien vite elle redevint sévère.
—Que Dieu vous aide, mon frère, et passez votre chemin; aujourd’hui je ne fais pas l’aumône.
Elle se remit en marche, mais elle s’arrêta encore une fois pour ajouter, avec une cruauté d’enfant gâtée:
—Je n’aime pas les hommes qui demandent pardon. D’ailleurs j’ai juré de ne vous revoir que si vous me preniez au lasso... Et vous ne me prendrez jamais car vous n’êtes qu’un gringo, un maladroit et un ingrat.
Et piquant son cheval elle s’enfuit au grand galop non sans avoir adressé à Richard une grimace méprisante. La cruelle façon dont l’amazone l’avait quitté laissa tout honteux le jeune homme et lui enleva l’envie de la poursuivre. Mais son orgueil se révolta et il résolut de la rattraper pour lui montrer qu’il n’était pas si maladroit qu’elle le croyait.
Tous deux se mirent à évoluer dans les terres de{242} l’estancia, à se poursuivre en escaladant les hauteurs et en plongeant dans les bas-fonds. De temps en temps Celinda, qui avait toujours une grande avance sur son poursuivant, retenait la course de son cheval comme pour se laisser atteindre par Watson; mais quand il était tout proche elle repartait au grand galop et l’insultait en lui lançant les mots que les gauchos avaient autrefois inventés pour se moquer des Européens, ignorants des usages du pays et médiocres cavaliers.
—Gringo chapeton[26], cavalier de paille qui ne tient même pas à cheval!
Richard portait au pommeau de sa selle un lasso de corde que la Fleur du Rio Negro lui avait donné autrefois. Tout en galopant il le déroula et il le lançait vers elle à chaque fois qu’il pouvait l’approcher. Le lasso retombait dans le vide, bien loin de Celinda qui soulignait d’ironiques éclats de rire la maladresse de l’ingénieur; mais peu à peu son rire changea d’accent, se fit de plus en plus joyeux; le mépris qu’elle éprouvait pour son maladroit ami semblait avoir fait place à une franche gaîté. Watson riait lui aussi car il pressentait que cette joie commune les réunissait plus rapidement que l’inutile lasso.
Dans leur évolutions, ils se rapprochaient de l’estancia. Celinda fit franchir à son cheval une barrière de troncs et disparut. Watson ne put obliger le sien à sauter de même et dut faire un large détour pour entrer par la tranquera ouverte.
Il s’avança alors avec une lenteur calculée jusqu’à la maison de l’estanciero, il espérait que quelqu’un viendrait l’interroger. Celinda demeurait invisible et il n’osait se présenter à la porte, craignant d’être fort mal reçu par la fille de Rojas.{243}
Avec un à propos providentiel le petit Cachafaz surgit à nouveau contre les pattes de son cheval.
—Demande à mademoiselle Celinda si je puis entrer pour la saluer.
Le petit lutin s’éloigna en grattant sous sa chemise lâche le gros bouton qui saillait sur sa panse couleur chocolat. Il revint peu de temps après et annonça à Watson de sa petite voix chantante et mielleuse d’Indien:
—Ma petite patronne vous fait dire de partir: elle ne veut plus vous voir parce que vous êtes... parce que vous êtes trop laid.
Et Cachafaz se mit à rire de ses propres paroles tandis que Watson regardait tristement du côté de la maison. Enfin, le jeune homme fit faire demi-tour à son cheval et s’éloigna un peu rasséréné par la résolution qu’il venait de prendre.
—Je reviendrai demain, se dit-il, je reviendrai tous les jours jusqu’à ce qu’elle me pardonne.
Hélène passa la soirée seule dans la grande salle de sa maison. A plusieurs reprises elle prit un livre, mais ses yeux glissaient sur les pages sans qu’elle comprît le sens d’une seule ligne.
Elle demeura longtemps pensive sur le sopha à fumer des cigarettes. Puis elle vint se placer près d’une fenêtre et regarda à travers les vitres la rue centrale de manière à ne pas être vue de l’extérieur.
En réalité, elle risquait seulement d’être vue par les deux agents de police que don Roque avait placés près de la maison pour empêcher les rassemblements de se former comme la veille. Les gens semblaient avoir oublié pour le moment l’ancienne maison de Pirovani. Personne ne s’arrêtait plus devant elle et les précautions du commissaire étaient bien inutiles. D’ailleurs beaucoup d’ouvriers de la digue étaient allés à Fort Sarmiento pour assister aux obsèques de l’entrepreneur. Les autres se trouvaient au{244} magasin du Gallego, ou formaient aux abords du village des groupes où l’on se demandait avec vivacité si vraiment les travaux allaient être suspendus, ce qui laisserait tout le monde sans ouvrage.
Certains, les plus optimistes, se figuraient que le premier train amènerait un nouvel ingénieur en chef, comme s’il eût été impossible au gouvernement de Buenos-Ayres de vivre un jour de plus si les travaux n’étaient immédiatement repris. Le Gallego et d’autres Espagnols engageaient des paris et soutenaient que leur compatriote don Manuel Robledo, qu’ils honoraient comme une gloire nationale, serait le nouveau directeur désigné.
De vieux journaliers qui avaient prêté leurs bras à toutes les entreprises de l’Etat haussaient les épaules avec résignation.
—La charrette est embourbée, vous verrez le temps qu’il faudra pour la faire rouler à nouveau.
Cependant, Hélène, debout près de la fenêtre contemplait la rue déserte et repassait dans son esprit toutes les difficultés de la situation. Pirovani mort; l’autre en fuite; la maison qu’elle occupait sans propriétaire certain. Elle pensa aussi à ce que devait dire Robledo et au brusque éloignement de Watson, l’homme qui lui inspirait le seul sentiment qui donnât quelque intérêt à l’existence monotone qu’elle menait ici. Peut-être, à cette heure même, Richard était-il à la recherche de cette petite fille qui avait tenté de la frapper de sa cravache.
Jamais, au cours de son existence si diverse qu’elle était seule à connaître entièrement, elle ne s’était vue dans une situation aussi difficile. Jusqu’à cette multitude hétérogène, où plus d’un individu avait laissé en Europe un passé chargé de crimes, qui osait lui adresser des réprimandes et forçait les autorités de la Presa à la faire garder par ces deux hommes qu’elle voyait de sa fenêtre appuyés sur leurs{245} sabres. C’est pour se trouver dans cette situation qu’elle avait passé l’Océan et qu’elle était venue s’installer dans ce pays presque sauvage!
Dans les moments les plus angoissants de son existence elle avait toujours trouvé un remède; mais comment continuer à vivre à la Presa? Pirovani mort, il lui faudrait abandonner cette maison, et personne ne viendrait plus l’admirer, ni s’efforcer de lui être agréable. Il ne restait que Robledo, un ennemi. Il restait bien aussi Watson, mais il avait tant changé!
Elle se rappela l’idée qu’elle avait caressée pendant ces derniers jours, alors que le jeune homme était le compagnon de ses promenades. Elle abandonnerait Torrebianca, ce naufragé incapable de regagner la rive, et s’en irait par le monde avec Watson. Mais ce fut pour se convaincre que cette solution était désormais impossible, et une fièvre de haine la saisit.
Richard s’était écarté d’elle pour toujours. Elle n’en pouvait plus douter depuis qu’elle lui avait parlé de sa fenêtre la veille. Peut-être pourrait-elle le reprendre facilement si seulement elle le voyait en tête à tête; mais l’autre semblait pressentir le danger, il lui avait dit d’un ton qui ne laissait aucun doute sur sa résolution, qu’il ne la reverrait que dans une autre maison et en présence de son mari. Hélène ignorant l’entrevue de Watson et de Canterac ne pouvait attribuer ce brusque revirement qu’à l’influence de Celinda.
«Elle me l’a repris, pensa-t-elle. Cette fille sauvage m’a barré la seule route qui me fût encore ouverte. Oh! comme je la hais!»
Tandis que se continuaient ses réflexions, elle se sentait agitée par deux ordres contraires de pensées, qui semblaient partager sa conscience en deux personnalités distinctes.{246}
L’image de Watson la réconfortait encore pendant ces moments d’angoisse. C’était lui l’homme jeune, le maître irrésistible qui s’impose à l’heure du crépuscule aux femmes habituées à se jouer cruellement et froidement du désir des hommes. Les hommes, elle les avait recherchés autrefois par ambition ou par cupidité; mais maintenant elle ne pouvait se passer de Watson. Elle ne le désirait plus seulement parce qu’il était capable de la faire sortir de cette situation critique, elle le désirait pour lui-même; parce qu’il était la jeunesse et la force naïve, tout ce qui peut servir de soutien à une existence lassée. En outre, la jalousie la torturait, une jalousie de femme orgueilleuse et vieillie qui se voit arracher le dernier espoir d’être heureuse par une rivale qui pourrait presque être sa fille.
Et tout en subissant cette torture il lui fallait se préoccuper de la tragique situation où l’avait mise la rivalité d’amour de deux hommes qui l’avaient désirée, et se défendre aussi de la haine de tout un village.
«Que faire? pensa-t-elle. Ah! où me suis-je laissée prendre?»
De petits coups frappés à la porte de la salle la troublèrent dans ses pensées. Sébastienne entra d’un air timide et embarrassé, en tournant dans ses doigts un bout de son tablier. En même temps elle souriait en regardant sa maîtresse et semblait chercher des mots pour donner corps à la demande qu’elle était venue présenter.
Hélène l’encouragea à parler et la métisse dit alors résolument:
—J’étais au service du feu don Pirovani et comme il n’est plus là, pour le motif que nous savons tous, il faut que je parte.
Hélène s’étonna fort de cette décision. Elle pouvait rester; sa maîtresse était satisfaite de son service.{247} La mort de l’Italien ne l’obligeait nullement à partir. Il fallait bien qu’elle servît quelque part et Hélène préférait que ce fût chez elle. Mais la métisse s’obstina et secoua la tête:
—Il faut que je parte. Si je reste, j’ai des amies capables de m’arracher les yeux. Merci bien! Je tiens à vivre en paix avec les miens... et, pourquoi ne pas le dire? Madame ne compte pas beaucoup de sympathies dans le pays.
Après ces mots, Hélène ne jugea pas prudent de continuer la conversation et elle se contenta d’approuver avec tristesse.
—Si vous avez peur de rester ici!
Cette tristesse émut Sébastienne.
—Je resterais bien volontiers; Madame me plaît beaucoup et ne m’a jamais fait de mal... Mais les gens sont comme ils sont et moi, pauvre femme, je ne vais pas me battre avec toutes celles de la Presa. Si je puis servir madame en quelque autre chose, qu’elle me le dise...
Elle se retira enfin après avoir insisté sur son désir d’être utile à Hélène et sur le chagrin qu’elle éprouvait de quitter son service. Elle était près de la porte quand, pour répondre à la marquise qui lui demandait où était son mari, elle se retourna.
—Je ne sais pas. Il est sorti ce matin et n’est pas encore rentré; peut-être est-il allé à Fort-Sarmiento avec don Moreno pour l’enterrement de mon pauvre patron.
Restée seule, Hélène commença à s’inquiéter de son mari, cette figure oubliée prit à ses yeux une importance nouvelle. Elle était habituée à le considérer comme un être sans volonté, toujours prêt à accepter toutes ses idées et à croire ce qu’elle voulait qu’il crût. Mais le dernier épisode de sa vie n’était pas sans relief!
Dans une grande capitale il aurait eu de moin{248}dres proportions, mais, ici, dans ce village, où les événements extraordinaires étaient rares, et face à cette foule d’aventuriers toujours prêts à insulter les gens d’une classe plus élevée!
Son inquiétude s’accrut lorsqu’elle pensa que Torrebianca découvrirait peut-être la vraie raison du combat à mort qu’il avait lui-même dirigé.
Elle repassa dans son esprit tout ce qu’elle avait pu remarquer chez son époux depuis la veille. Rentré chez lui, Frédéric lui avait raconté la triste fin du duel, mais avec certains ménagements, comme s’il eût redouté de lui causer une émotion en lui apprenant la nouvelle. Puis, le soir, il n’avait plus semblé le même homme.
Il avait évité de lui parler, ne lui avait répondu que par monosyllabes; par deux fois elle avait surpris son regard fixé sur elle avec une expression qu’elle ne lui avait jamais vue. Agacé par la curiosité de la foule, Torrebianca avait fermé la fenêtre puis s’était réfugié dans sa chambre pour n’en sortir que le lendemain matin de très bonne heure, avant qu’elle-même fût éveillée. Le jour touchait à sa fin et il n’était pas encore de retour. Que devait-elle penser de tout cela?
Mais son inquiétude ne tarda pas à s’évanouir. Elle était si habituée à dominer complètement son mari qu’elle finit par trouver absurdes ses soupçons et ses craintes. D’ailleurs, même si ces inquiétudes étaient pleinement justifiées, elle réussirait bien à le calmer et à le convaincre comme tant d’autres fois.
L’apparition d’un passant qui marchait lentement le long de la maison en regardant les fenêtres lui fit oublier son mari. C’était Manos Duras. Une heure auparavant, alors qu’elle était comme maintenant debout devant la fenêtre, elle avait cru par deux fois voir le gaucho au coin d’une ruelle voisine. Le rude cavalier passait à pied, à travers le village, comme{249} un travailleur un jour de repos. Il distingua la forme de la marquise derrière les rideaux et la salua en ôtant son chapeau, tandis qu’un sourire découvrait ses dents de loup.
C’était le premier salut souriant qu’eût reçu Hélène depuis la mort de Pirovani. Elle devina que cet homme était le seul admirateur qui lui restât, et cela lui parut si comique qu’elle en rit presque.
Dorénavant elle n’aurait plus d’autre amoureux qu’un gaucho aux trois-quarts bandit.
Pensive, le front contre les vitres, elle regarda l’avenue déserte. Manos Duras avait disparu dans la ruelle voisine et les deux policiers eux-mêmes, jugeant leur faction inutile, s’étaient éloignés dans la direction du bar.
De nouveau coups discrets de Sébastienne se firent entendre à la porte de la salle. Elle entra avec plus de résolution que tout à l’heure, mais elle parla à voix basse avec un sourire confidentiel.
—Monsieur est-il rentré? demanda Hélène.
—Non, c’est pour autre chose... J’étais dans la basse-cour il n’y a qu’un instant quand ce gaucho qu’on appelle Manos Duras s’est présenté à la porte de derrière et m’a dit:
Elle réfléchissait pour se rappeler exactement les paroles de Manos Duras.
—Va dire à ta patronne que je ne lui tourne pas le dos comme beaucoup d’autres et qu’elle sera toujours la même pour moi, parce que je suis de ceux qui se brisent mais ne plient pas.
Voilà ce que m’a dit Manos Duras pour que je le répète à Madame.
Hélène sourit en entendant ces déclarations. Pauvre homme! Et on le traitait de bandit!... Pour elle il était en ce moment la figure la plus séduisante du pays, le seul homme d’honneur qui osât lui offrir son aide et faire front contre la populace.{250}
Quand la métisse fut sortie, Hélène resta à la fenêtre pour voir défiler les passants dont le nombre augmentait avec la chute du jour. Elle s’éloigna des vitres quand survinrent quelques groupes d’ouvriers à cheval; d’autres suivirent dans des voitures louées à Fort Sarmiento. Ils revenaient certainement de l’enterrement de l’entrepreneur. Avant de disparaître, tous regardaient furtivement la maison.
Il faisait presque nuit quand elle vit passer, seul, un cavalier qui baissait obstinément la tête. C’était Richard Watson. Elle comprit à son costume couvert de poussière et à l’aspect de son cheval qu’il ne revenait pas comme les autres de l’enterrement. Il avait sans doute passé la journée dans les champs, à l’estancia de Rojas peut-être, et il avait erré près du fleuve en compagnie de l’écuyère à la cravache.
«Et moi, je suis là, pensa-t-elle, enfermée comme une bête féroce pour échapper aux insultes d’une populace injuste!... Et l’on s’étonne que les femmes deviennent mauvaises!»
Elle demeura immobile, les yeux mi-clos, tandis que les ombres du crépuscule surgissant des coins de la pièce venaient peu à peu se rejoindre au centre et l’enténébrer toute. Seule une faible clarté extérieure donnait une légère fluorescence bleue aux vitres sur lesquelles se détachait la silhouette immobile d’Hélène.
Il faisait nuit noire quand elle se décida à appeler Sébastienne qui, devinant son désir, répondit:
—J’apporte la lampe!
Elle entra portant une grande lampe à pétrole qu’elle posa sur la table au milieu de la salle.
Elle allait se retirer, croyant n’avoir plus rien à faire, quand la maîtresse la retint.
—Savez-vous où peut se trouver en ce moment ce Manos Duras dont vous m’avez parlé tout à l’heure?
La métisse, toujours prête au bavardage, entama,{251} avant de répondre avec précision, un long préambule. Manos Duras vagabondait partout en ce moment avec ses amis de la Cordillère qu’il avait logés dans son rancho, des gens peu recommandables qui ne craignaient même pas Dieu. Qui savait ce qu’ils pouvaient bien manigancer!... Il lui avait dit aussi, pendant leur entretien à la porte de la basse-cour, qu’il allait peut-être partir pour un long voyage; «c’est pourquoi il s’était permis de venir déranger Madame pour savoir si elle n’avait rien à lui ordonner».
—Je crois, termina-t-elle, que s’il n’est pas encore rentré à son rancho, je mettrai la main dessus chez le Gallego.
—Allez le chercher, dit Hélène, et prévenez-le de ma part de se trouver à dix heures précises devant la maison... C’est tout. Mais avertissez-le habilement, sans que personne s’en aperçoive.
Sébastienne, qui avait eu l’air de ne pas bien comprendre les premiers mots tant elle avait éprouvé de surprise, cessa de s’étonner quand sa maîtresse lui eut recommandé d’être discrète, et affirma avec énergie que la patronne pouvait dormir sur ses deux oreilles, qu’elle ferait la commission avec sa prudence habituelle.
Elle sortit de la maison et se hâta vers le cabaret. Si elle n’y trouvait pas le gaucho c’est qu’il aurait quitté le village.
Devant la porte de l’établissement elle s’arrêta pour jeter un coup d’œil à l’intérieur. C’était l’heure du dîner, la pratique était rare. La plupart des clients étaient chez eux, assis à leur table, et ce n’était que dans une heure qu’ils reviendraient se grouper autour du comptoir. Un vieux gaucho raclait une guitare en regardant la panse d’un des caïmans suspendus au plafond.
Les trois hôtes de Manos Duras écoutaient avec attention. Ce dernier, assis sur un crâne de cheval,{252} le dos au mur, fumait d’un air pensif. Comme le patron du bar était absent, Fritérini imitait derrière le comptoir les allures du propriétaire, et lisait avec ravissement un vieux journal italien tout crasseux.
Averti par une toux discrète, Manos Duras leva les yeux et vit à la porte la métisse lui faire signe de sortir. Derrière le cabaret, Sébastienne lui fit sa commission d’une voix mystérieuse, et, tout en parlant, elle porta à plusieurs reprises son doigt à ses lèvres. En outre elle cligna de l’œil pour que l’autre «ne la prît pas pour une bête» et pour lui laisser entendre qu’elle savait très bien pourquoi on l’avait envoyée l’avertir.
Quand la métisse fut partie, Manos Duras ne rentra pas tout de suite dans le bar. Il préféra demeurer seul dans l’ombre pour mieux savourer sa satisfaction. Sa joie était mêlée d’un étonnement profond. Comment aurait-il pu s’imaginer, tandis qu’il rôdait autour de la demeure de la belle dame, que celle-ci allait le prier de venir la voir seule ce soir même?
En proposant ses services à Sébastienne dans la cour de la maison, il avait suivi l’élan d’une façon de générosité. Il voulait apparaître à la marquise comme différent des autres habitants de la Presa, et il avait offert sa protection sans espoir de la voir accepter... Et quelques heures après, elle l’envoyait chercher. Que voulait-elle lui demander?
Mais il chassa bientôt les incertitudes qui commençaient à troubler sa joie et il se raffermit dans son orgueil viril. Il n’était qu’un sauvage, mais il était un homme autant que les autres, mieux que les autres même puisque tous le redoutaient... et ces gringas venues de l’autre monde ont parfois de telles fantaisies!... Il finit par sourire avec fatuité.{253}
—C’est bien ce que je disais, pensa-t-il, l’une vaut l’autre!... Toutes les mêmes!
Et il revint s’asseoir au cabaret au milieu de ses amis, attendant l’heure.
Cependant Robledo et Watson achevaient leur repas; ils entendirent frapper à leur porte.
L’Espagnol s’étonna un peu de voir entrer Torrebianca en costume de ville noir et cravate de deuil, mais si couvert de poussière que ses vêtements semblaient gris et sa tête et ses moustaches complètement blanches.
—Je viens d’enterrer le pauvre Pirovani à Fort Sarmiento... Moreno m’a ramené dans sa voiture.
Robledo l’invita à s’asseoir à table.
—Tu peux dîner ici si tu ne veux pas rentrer tout de suite chez toi.
Torrebianca secoua la tête.
—Je ne rentrerai pas chez moi.
Il prononça ces mots avec une telle énergie que Robledo se mit à le regarder fixement. Il était en proie à une excitation qui faisait trembler ses mains et brouillait ses mots.
—J’ai mangé un peu avec Moreno avant de partir... Mais je dînerai de nouveau... Ah! la mort! Pauvre Pirovani! Je voudrais aussi boire un peu.
Bien qu’il prétendît avoir faim, il toucha à peine aux divers plats que lui présenta la servante. Par contre il but beaucoup de vin, machinalement, sans savoir au juste ce qu’il buvait.
L’Espagnol avait cru percevoir, depuis l’entrée de son ami, une odeur de genièvre. Moreno et lui avaient sans doute bu quelques verres de liqueur avant de prendre le chemin du retour. C’était pour cela peut-être que Torrebianca se montrait nerveux, car il n’avait pas l’habitude des boissons alcooliques.
Watson, qui avait fini de dîner, remarqua que le{254} nouveau venu le regardait avec insistance comme pour lui faire entendre que sa présence le gênait.
—Moreno est resté chez lui? demanda-t-il.
Et il partit en prétextant qu’il avait besoin de parler à l’employé et d’apprendre ce qu’il avait l’intention d’écrire au Gouvernement pour lui exposer la nécessité de reprendre des travaux.
Quand Robledo et Torrebianca furent seuls, le marquis sembla devenu un autre homme. Son excitation tomba, il abaissa son regard et l’Espagnol crut le voir s’affaisser sur son siège comme une masse molle qui s’écroule faute de soutien. Toute l’énergie factice qu’il devait à l’alcool était brusquement tombée et le Torrebianca que Robledo avait devant lui n’était plus comparable qu’à une enveloppe de baudruche subitement dégonflée.
—Il faut que tu m’écoutes, dit-il en levant sur son ami des yeux humiliés et suppliants. Tu es le seul appui qui me reste au monde, le seul être qui m’aime... et c’est pour cela que tu me dois la vérité. Aujourd’hui, pendant l’enterrement du malheureux Pirovani, je n’ai pensé qu’à une chose: «Il faut que je voie Robledo; il me dira ce que je dois penser de tout cela». Mais je ne t’ai pas dit encore ce qu’est «tout cela»: c’est ce que je remarque autour de moi depuis hier, les regards des gens, les gestes hostiles, les injures que je crois deviner et que je ne peux croire ensuite avoir devinées... Ah! tout cela est si affreux!
Toujours plus découragé et plus lamentable, Torrebianca appuya son front dans ses mains; Robledo voulut lui dire quelques mots pour lui rendre un peu d’énergie, mais il l’interrompit.
—Tu parleras tout à l’heure. Je veux que tu écoutes d’abord des choses que tu ne sais pas ou que tu as oubliées, depuis que je te les ai dites. Mais{255} avant tout, il faut que je te pose une question. Crois-tu que ma femme me trompe?
Ces mots prirent au dépourvu l’Espagnol qui demeura quelques secondes sans tenter de répondre. Son ami sembla soudain craindre qu’il ne répondît et pour l’en empêcher il se mit à raconter sa propre histoire depuis le jour de sa rencontre avec Hélène.
Robledo l’avait entendue en partie lors de son séjour à Paris; ils s’étaient connus à Londres, elle était d’une noble famille russe et son mari avait occupé une haute dignité à la cour des tsars. Mais le ton du narrateur était maintenant tout différent et Torrebianca semblait douter de ce passé qu’il avait toujours admis sincèrement jusque-là et qu’il étalait avec fierté.
En outre, ne se bornant plus aux traits généraux de cette histoire, il révélait à son ami de nouveaux épisodes. Les choses du passé semblaient avoir pris pour lui un relief nouveau et il remarquait des détails qu’il avait négligés autrefois. Il avait toujours reçu dans sa maison un ami intime, un ami favori de sa femme à qui elle montrait la plus grande confiance et qu’elle affirmait avoir connu au temps où elle vivait dans sa noble famille avant son premier mariage. Deux fois le marquis s’était battu en duel pour sa femme que des gens habitués jusque-là à fréquenter ses salons s’étaient mis brusquement à calomnier. Il ne pouvait se rappeler sans remords un de ses amis qu’il avait gravement blessé au cours d’un de ces combats.
—Je t’ai raconté, continua-t-il, toute notre histoire, tout ce que je sais de certain sur la vie de cette femme. Tout le reste, c’est elle qui me l’a dit et je ne sais plus si je dois la croire... J’ai même des doutes sur sa nationalité et son nom. Je lui ai confié avec franchise tout mon passé et peut-être en échange ne m’a-t-elle raconté que des mensonges.{256}
De nouveau, il regarda Robledo avec angoisse, espérant encore que son ami lui conseillerait d’ajouter foi aux récits de sa femme. On eût dit un naufragé cherchant un objet solide pour s’y cramponner. Mais Robledo eut un geste ambigu et baissa la tête.
—Depuis quelques heures, ajouta Torrebianca, il me semble que je vois les choses avec d’autres yeux. Oh! les regards cruels de cette pauvre engeance, quand hier j’ai ouvert ma fenêtre!... Et aujourd’hui pendant l’enterrement, quel supplice! Moi qui n’ai jamais craint personne, je n’ai pu soutenir le regard hostile ou moqueur de tous ces ouvriers... Le pauvre Moreno m’a entraîné à l’écart plusieurs fois ou s’est mis à parler très fort pour m’empêcher d’entendre les commentaires qu’on faisait derrière moi. Il ignore que j’ai deviné les efforts qu’il faisait pour m’éviter des ennuis... Je me suis senti si abandonné qu’après avoir pensé à toi, j’ai pensé à ma mère, comme un enfant. Elle qui s’est privée de tout pour que son fils pût conserver intact l’honneur de ses ancêtres!... Et à la fin, son fils est devenu la risée d’un campement d’émigrants, dans un coin sauvage de la terre... Quelle honte!
Il porta ses mains à ses yeux comme pour les préserver de visions trop cruelles et il demeura dans cette position quelque temps. Puis il releva la tête et demanda anxieusement:
—Toi, qui es mon seul ami, toi qui as vu de près mon existence à Paris, dis-moi si tu crois que Fontenoy était l’amant de ma femme?
L’Espagnol eut un nouveau geste d’incertitude; comment répondre? Torrebianca, d’une voix que l’agonie serrait de plus en plus, demanda encore:
—Et ces deux hommes, crois-tu que c’est pour Hélène qu’ils se sont battus hier?
Robledo ne fit même pas le geste vague de tout à l’heure; il se contenta de baisser les yeux. Ce silence{257} parut au marquis une réponse affirmative et désespéré, il dit en cachant à nouveau son visage entre ses mains:
—Et c’est moi, le mari, qui ai dirigé le combat où ils s’entre-tuaient!
Il y eut un long silence. Le marquis cachait toujours son visage entre ses mains, tandis que Robledo le regardait avec pitié. Soudain, il se dressa et dit lentement en se frottant les paupières:
—Je ne puis rester ici, je ne pourrais pas affronter sans honte le regard de tous ces gens... Je ne puis non plus partir avec elle, elle ne me prendrait plus à de nouveaux mensonges. Je la regarderai bien en face, je verrai la fausseté de ses yeux et de son sourire et je la tuerai... Je suis sûr que je la tuerai.
Son ami crut le moment venu de lui donner un conseil.
—Oublie cette femme et pour le moment essaye de trouver le repos. Demain nous chercherons le meilleur moyen de te délivrer d’elle. Tu vas commencer par passer la nuit ici. Je réfléchirai à ce que nous avons à faire. Elle s’en ira, je ne sais pas encore comment nous réussirons à l’éloigner; mais elle s’en ira et tu resteras avec moi.
Il passa son bras derrière le dos de Torrebianca et le caressa paternellement; le marquis cachait toujours son visage.
Il détestait maintenant sa femme, mais il éprouvait en même temps un inexplicable malaise à la pensée qu’il allait se séparer d’elle sans retour.{258}
Tourmentée par sa curiosité de femme, la métisse attendit avec impatience l’heure du rendez-vous.
Elle se trouvait dans la cuisine de la maison, située dans un hangar ouvert sur la cour. Elle avait sur sa table un réveille-matin et plusieurs fois, elle en approcha la lampe pour savoir l’heure. Un peu avant dix heures elle quitta ses souliers, traversa la cour pieds nus et s’engagea finalement sur une des galeries extérieures.
Elle parvint ainsi en étouffant le bruit de ses pas à l’angle du bâtiment le plus voisin de la fenêtre de la chambre d’Hélène. Puis elle s’assit sur le plancher et se tapit pour écouter sans être vue.
Au bout d’un instant elle aperçut dans l’ombre Manos Duras qui s’approchait de la maison. Elle le vit quitter ses éperons, les serrer dans sa ceinture et monter avec précaution les marches du perron. Presque aussitôt, la fenêtre de la chambre s’ouvrit; Hélène parut et fit signe au nouveau venu de parler à voix basse. Sébastienne tendit l’oreille, mais la{259} fenêtre était si loin qu’elle ne put, en concentrant son attention, que saisir quelques mots isolés.
Encore étaient-ils prononcés d’une voix si faible qu’elle ne put être certaine de les avoir exactement perçus. Elle crut entendre «Celinda» et «Fleur du Rio Negro». Mais elle pensa bientôt qu’elle était le jouet d’une illusion de ses sens. Comment sa petite patronne d’autrefois serait-elle mêlée aux affaires de ces gens-là?
En avançant la tête au coin de la maison elle parvenait à voir Manos Duras et la marquise. Le gaucho l’écoutait avec des signes approbateurs ou bien, s’il parlait, c’était en phrases brèves, en appuyant sur les mots avec des gestes affirmatifs. A un certain moment, il essaya même de prendre la main d’Hélène, mais elle se rejeta en arrière avec une brusquerie qui laissait voir à la fois sa répugnance et son orgueil. Immédiatement elle sembla se repentir et dit à voix plus haute sur un ton de promesse:
—Nous reparlerons de cela demain ou un autre jour; quand vous aurez accompli la mission que je vous ai donnée. Vous connaissez nos conventions.
Et elle se sépara de lui avec des mines coquettes tout en prenant bien soin de se maintenir hors de la portée de ses mains.
Le gaucho voyant la fenêtre se fermer descendit l’escalier et, arrivé dans la rue, s’arrêta:
Sébastienne qui s’était levée pour mieux le voir crut l’entendre murmurer avec un accent joyeux:
—Au lieu d’une, j’en aurai deux.
Mais cette fois encore, elle n’était pas sûre d’avoir bien entendu. Elle finit par regagner à travers la cour le réduit où elle avait son grabat, quelque peu déçue par les maigres résultats de sa surveillance.
Une chose cependant s’était fixée dans sa mémoire et l’empêchait de trouver le sommeil. Les deux inter{260}locuteurs avaient-ils vraiment prononcé le nom de mademoiselle Rojas?
A plusieurs reprises, elle se demanda encore: «Qu’est-ce que ces gens pouvaient bien dire de ma fillette?»
Robledo lui aussi passa une nuit agitée. Il avait installé Torrebianca dans la chambre qu’il avait déjà occupée avec sa femme lors de son arrivée à la Presa. Epuisé par les émotions de la journée, le marquis avait enfin consenti à rester chez son ami.
Deux fois, l’Espagnol s’éveilla au cours de la nuit et prêta l’oreille pour mieux entendre. De la chambre voisine, où se trouvait son ami, lui parvenaient des gémissements et des mots prononcés à demi.
—Frédéric, as-tu besoin de quelque chose?
Son ami lui répondait alors d’une voix faible et accablée puis s’efforçait de demeurer silencieux.
Quand Robledo s’éveilla pour la troisième fois, la lumière du jour marquait de lignes claires les fentes de sa fenêtre. Un bruit l’avait tiré de son sommeil et l’avait forcé à sauter du lit.
Il entra dans la salle commune qui servait aussi de salle à manger et y trouva Watson penché sur une chaise, en train de chausser ses éperons. La chaise était tombée et c’est ce bruit qui avait réveillé Robledo. Et apercevant son associé, l’Espagnol lui dit avec gaîté:
—Comme vous êtes matinal!... Je vous ai pourtant entendu rentrer bien tard hier.
Watson, qui semblait triste, se borna à répondre:
—Comme nous ne travaillons pas aujourd’hui, je vais galoper un peu dans la campagne.
Quand le jeune homme fut parti, Robledo acheva de s’habiller et se mit à marcher de long en large dans la salle à manger. A chaque fois qu’il passait devant la porte de la chambre occupée par Torre{261}bianca, il était tenté d’entrer. Il voulait voir son ami. Un vague pressentiment le tourmentait.
«Allons voir comment il a passé la nuit», se dit-il.
Il ouvrit la porte, regarda à l’intérieur de la pièce et fit un geste d’étonnement. Il n’y avait personne; le lit, avec ses couvertures en désordre, était vide. L’Espagnol demeura tout pensif. Il s’imagina d’abord que Frédéric n’ayant pu dormir de la nuit était sorti à l’aube pour marcher un peu.
Instinctivement, il se mit à regarder autour de lui et à examiner la chambre. Sur la table étaient dispersés des papiers et sur chacun il reconnut une ou deux lignes de l’écriture de Torrebianca: des lettres commencées que le marquis avait jugé inutile de continuer.
Il prit un des papiers: «Je te suis reconnaissant des efforts que tu as faits, mais je ne peux plus...» Sur un autre il lut: «La seule femme qui m’ait véritablement aimée, ma mère, est morte. Ah! si j’étais sûr de la retrouver!»
Robledo continua l’examen des autres feuilles. Il n’y trouva que quelques lignes raturées ou des mots inintelligibles. Torrebianca avait essayé d’écrire mais il avait finalement renoncé à cet effort. Il crut voir son ami, au milieu de la nuit, jeter sa plume, qu’il venait de trouver sur le plancher, et dire avec l’indifférence de celui qui déjà croit s’être dégagé des soucis d’ici-bas: «A quoi bon!»
Il demeura pensif, les feuillets à la main. Puis une pensée optimiste lui rendit l’espoir. Son ami errait peut-être aux environs du village. Ces lettres inachevées étaient la preuve que sa volonté n’était pas bien ferme.
Il examina le sol devant la maison et eut un geste de satisfaction en distinguant parmi les empreintes fraîches laissées par les sabots du cheval de Watson{262} le contour d’un pied humain, celui de son camarade sans doute.
Il avait été à l’école des chercheurs de pistes qui tirent profit des moindres traces perdues dans le désert. Les pas de Torrebianca le conduisirent dans une ruelle ouverte entre sa maison et la maison voisine et qui donnait sur la campagne. Mais à la sortie du village il perdit la piste au milieu des nombreuses empreintes laissées là par les gens qui étaient partis à l’aube.
Instinctivement il marcha vers le fleuve et se mit à le suivre vers l’amont. Les eaux glissaient d’un mouvement uniforme sans que le moindre objet flottant vînt altérer leur surface. Il finit par se lasser de ces recherches que seul un pressentiment guidait et justifiait.
«Frédéric, se dit-il, m’a troublé par le récit de ses malheurs. Pourquoi vais-je penser des choses absurdes?... Rentrons à la maison. Mon cœur me dit que je l’y trouverai en arrivant. Il doit être allé se promener de l’autre côté du village.»
Et il revint à la Presa: mais une angoisse vague l’obligeait à presser le pas.
A la même heure, près de l’estancia de Rojas, Manos Duras, à l’abri de quelques buissons causait avec ses trois compères venus de la Cordillère.
Ils avaient mis pied à terre et ils tenaient leurs chevaux par la bride. L’un des trois hommes ne portait pas le même costume que ses compagnons et ressemblait plutôt à un ouvrier de la Presa qu’à un cavalier des champs. Manos Duras lui donnait des explications qu’il écoutait en silence avec de légers clignements d’yeux approbateurs. Puis, cet homme se mit en selle; le bandit et ses deux compagnons le suivirent des yeux jusqu’à ce qu’il eût disparu au milieu des bouquets de plantes sauvages.
—Le petit vieux va savoir ce qu’il en coûte de{263} me menacer, dit le gaucho avec un sourire haineux.
Un des hommes de la Cordillère qui portait le surnom de Piola[27] et qui, grâce à son âge et à ses façons autoritaires, semblait exercer une certaine influence sur ses deux compagnons, secoua la tête d’un air de doute. Le plan de Manos Duras lui paraissait excellent, mais il ne comprenait pas qu’on restât dans le pays un jour ou deux après le coup. Il valait mieux battre en retraite tous ensemble et sans délai vers la Cordillère.
—Laisse-moi faire, compère; je m’y connais, répondit le gaucho. Il faut auparavant que j’aille recevoir quelque chose qu’on m’a promis. J’irai ce soir peut-être et demain je vous rejoindrai.
Il comptait sur son cheval dont il fit de grands éloges. Avec cette bête il se faisait fort de rattraper ses camarades en route. D’ailleurs, seul, il irait d’un meilleur train que ses amis dont les bagages retarderaient la marche.
Cependant, l’envoyé de Manos Duras galopait vers l’estancia de Rojas. Il arriva devant une barrière, l’ouvrit et continua sa course à travers les domaines de don Carlos.
Arrivé près du bâtiment principal, il vit venir à sa rencontre Cachafaz, averti par les aboiements de quelques chiens qui sautaient devant les pattes du cheval et tentaient de le mordre. Le petit cria pour les chasser, puis écouta avec la gravité d’une grande personne les paroles de l’envoyé.
Le message lui causa une joie telle qu’oubliant le cavalier, il courut vers l’estancia. Don Carlos buvait dans la salle à manger le dixième maté de la matinée. Celinda, en costume féminin, était assise dans un fauteuil de jonc et semblait en proie à de mélancoliques pensées. Le métis entra en criant.{264}
—Patron, le commissaire vous fait dire de vous rendre tout de suite au village. On a arrêté celui qui a volé votre vache.
L’estanciero, tout heureux de la nouvelle, suivit Cachafaz sans lâcher toutefois la calebasse à maté et sans cesser tout en marchant d’aspirer le breuvage avec son chalumeau d’argent.
Il voulait obtenir du courrier qui venait d’arriver au triple galop de son cheval de nouveaux détails sur l’événement. Arrivé devant la maison il demeura perplexe: le cavalier avait disparu. Cachafaz parcourut le champ voisin et les enclos, appela, mais ne put découvrir l’homme. Finalement, Rojas haussa les épaules et, tout à la joie de la nouvelle, il trouva une explication à cette disparition. Don Roque, pour qu’il fût plus vite averti, lui avait envoyé un avis par un voyageur quelconque qui avait dû faire un large détour et qui n’avait pas voulu perdre plus de temps. Lui aussi était pressé, et comme il jugeait utile d’aller à la Presa pour parler au commissaire, il monta à cheval en promettant à Celinda d’être de retour avant le repas de midi.
Allongés sur le sol, Manos Duras et ses trois amis le virent passer dans le lointain, en route vers le village. La face collée contre les racines des buissons, ils causaient et riaient avec un calme cynique.
—Il va chercher la vache que nous avons mangée hier, dit Piola.
Et Manos Duras ajouta, en accompagnant ses paroles d’une grimace obscène:
—Nous verrons bien ce qu’il dira quand nous aurons pris sa génisse.
Richard Watson, qui galopait dans la campagne, avait bonne envie de s’approcher de l’estancia, mais il craignait que sa présence n’irritât Celinda; il vit lui aussi dans le lointain don Carlos Rojas passer{265} dans la direction de la Presa. Cela parut lui donner de l’audace. Celinda était seule chez elle et il lui était facile de trouver un prétexte quelconque pour lui rendre visite. Mais bientôt il eut peur de nouveau. S’il se montrait près de l’estancia, le seul Cachafaz ne viendrait-il pas le recevoir? Il valait mieux errer dans la campagne. Peut-être la fille de Rojas, lasse d’être seule, se déciderait-elle à monter à cheval.
Il était résolu à attendre jusqu’à la chute du soleil. Il avait eu la précaution d’emporter quelques vivres dans une des sacoches de sa selle et d’ailleurs, comme tous les amoureux, il ignorait que l’homme est, de naissance, affecté d’une maladie mortelle, la faim, et qu’il ne peut vivre qu’en l’apaisant deux fois par jour. Pour l’instant, des choses qu’il jugeait beaucoup plus importantes l’occupaient.
Cependant, son ami Robledo errait la tête basse dans la rue centrale de la Presa. Il revenait de chez lui et Torrebianca ne s’y trouvait pas. La servante qui avait préparé le déjeuner l’avait attendu en vain. Où le trouver?
Au milieu de la rue il entendit des voix amies et leva la tête. Rojas parlait avec animation au commissaire du village qui lui répondait d’un air étonné. Tous deux saluèrent Robledo qui s’approcha.
—Un courrier est arrivé à mon estancia, dit don Carlos, pour me prévenir que le commissaire avait retrouvé la vache qu’on m’a volée... Or don Roque n’a envoyé personne et ne sait de quoi il s’agit. C’est une plaisanterie que je trouve fort mauvaise. Quel est le maudit imbécile qui a voulu me jouer ce tour?
Robledo resta quelques minutes à l’écouter en feignant de s’intéresser à l’affaire, puis il se remit en marche. Il s’inquiétait uniquement de décou{266}vrir la cachette de Torrebianca et croyait le reconnaître dans tous les hommes qu’il apercevait au loin.
«Dommage que Richard soit sorti de si bonne heure, pensa-t-il. Il m’aurait aidé à le chercher.»
Watson, ballotté entre ses craintes et le désir de voir Celinda, s’était peu à peu rapproché de l’estancia; mais quand il arrivait auprès d’une des claires-voies qui servaient de portes à l’enceinte de fils barbelés il demeurait indécis. La Fleur du Rio Negro lui avait dans sa rancune ordonné de ne plus reparaître; comment expliquerait-il sa présence dans la propriété de Rojas?
A la vue d’une barrière ouverte, il reprit courage. «Elle dira ce qu’elle voudra, en avant! pensa-t-il. Il faut que je la voie quand elle devrait ne m’adresser que des injures!»
Et il avança lentement sur un des chemins qui menaient à l’estancia. Soudain son cheval parut inquiet, pressa le pas puis s’arrêta net, prêt à se cabrer.
Le jeune homme aperçut les corps de deux dogues, tués tout récemment sans doute, car leurs têtes brisées baignaient dans une flaque de sang. Il continua d’avancer et à quelques pas de la maison il trouva un homme étendu au milieu du chemin.
Il était mort lui aussi. C’était un péon de Rojas, un métis qu’il crut reconnaître pour l’avoir vu plusieurs fois, bien qu’il fût maintenant défiguré par des coups de feu. Une de ses orbites était restée vide et quelques débris de la masse cérébrale s’échappaient du crâne par ce trou. Autour de lui la terre buvait avidement le sang et se couvrait de mouches.
Il sauta à bas de son cheval et, revolver au poing, il s’avança vers la maison. Arrivé devant la porte il s’aperçut qu’il n’y avait personne dans la vaste pièce qui servait à la fois de salon et de salle à man{267}ger et il se mit à lancer des appels de tous côtés.
Un fauteuil de jonc, le siège préféré de Celinda, était par terre, renversé. Il remarqua aussi que le tapis de la grande table semblait avoir été violemment tiré, car il était lui aussi tombé à terre. Il avait entraîné dans sa chute tous les objets qui se trouvaient d’ordinaire sur la table et qu’on voyait froissés ou brisés sur le sol.
Il poussa de tels cris et répéta tant de fois son nom pour rassurer tout le monde que des pas se firent entendre enfin à l’intérieur du bâtiment et que le visage cuivré et ridé de la mère de Cachafaz parut dans l’entre-bâillement d’une petite porte. D’autres servantes et des péons de l’estancia, tous métis, surgirent peu à peu de leurs cachettes; ils bredouillaient des explications inintelligibles et gardaient un silence plein d’horreur.
Watson sortit de la maison juste au moment où le petit Cachafaz revenait de l’enclos en regardant avec inquiétude de côté et d’autre. Brusquement tous en même temps voulurent raconter l’événement à l’ingénieur, mais le petit métis les devança avec une espèce d’autorité. Il se trouvait près de la petite patronne et il avait tout vu. Trois hommes étaient arrivés au grand galop. Cachafaz était sorti de la maison, attiré par les aboiements des chiens, et il avait entendu les coups de feu qui les avaient tués. Puis il avait vu un péon courir vers les cavaliers pour leur demander sans doute pourquoi ils envahissaient l’estancia. Tous trois avaient tiré des coups de revolver sur lui et il avait roulé à terre.
—Je me suis réfugié en courant dans la maison, continua l’enfant. Ma petite patronne est sortie pour voir ce qui se passait; mais les trois méchants hommes sont arrivés et lui ont jeté un poncho sur la tête. Je me suis caché sous une table; puis j’ai risqué un œil et je les ai vus monter à cheval en{268} emportant la petite patronne, qui agitait ses bras... comme ça... sous le poncho. Voilà tout ce que je sais.
Les autres auraient bien voulu raconter aussi leurs impressions bien qu’ils n’eussent en vérité pas vu grand’chose puisqu’ils s’étaient cachés dès que le péon était tombé et ne s’étaient montrés qu’à l’arrivée de Watson.
Celui-ci, tout en cherchant à se débarrasser de tous ces gens qui lui parlaient à la fois, pensait avec remords au temps qu’il avait perdu par son indécision en errant le long des clôtures barbelées de l’estancia. Pourquoi n’était-il pas entré une demi-heure plus tôt; il aurait été aux côtés de Celinda pour la défendre!
Il lut dans les yeux d’antilope de Cachafaz que le petit n’avait pas tout dit et qu’il voulait bien parler, mais à lui tout seul. L’enfant souriait avec mépris en entendant les autres donner des renseignements contradictoires sur l’extérieur des assaillants. Tous croyaient les connaître et tous les avaient vus sous un aspect différent. Watson l’entraîna à l’écart et Cachafaz, dressé sur la pointe des pieds, lui dit à voix basse:
—C’est Manos Duras qui a enlevé la petite patronne. Je sais où il la tient.
Pressé de questions par Richard, il s’expliqua. Manos Duras ne figurait pas parmi les trois hommes qui avaient emmené Celinda. Mais le petit, sorti de sa cachette, s’était glissé dans un enclos voisin et avait grimpé au sommet d’une pyramide de luzerne séchée que l’on conservait pour nourrir les vaches pendant l’hiver. La cime était un poste d’observation d’où le regard embrassait une énorme étendue de terrain. Invisible dans son beffroi, il avait vu les trois cavaliers en rejoindre au loin un quatrième qui semblait les attendre et qui était sans aucun{269} doute Manos Duras. Puis les quatre hommes avaient pris au galop la même direction; l’un d’eux portait la prisonnière devant lui sur sa selle.
Il avait vu aussi du haut de la montagne de luzerne Watson arriver, mais il était si méfiant qu’il n’avait pas voulu descendre avant de s’être assuré de son identité.
Ce récit troubla si profondément Richard qu’il resta quelque temps sans pouvoir coordonner ses idées. Il pensa avant tout qu’il était urgent de partir à la recherche de Celinda pour la délivrer et ne voulut pas considérer l’énorme disproportion de forces qui existait entre lui et les bandits. Il avait pour l’aider le petit Cachafaz qui connaissait l’endroit où il cachait la jeune fille. C’était là le point important. A lui maintenant de l’arracher à ses ravisseurs. Et, avec l’absurde témérité des amoureux qui refusent d’apprécier les obstacles à leur valeur, il monta à cheval et fit signe au petit de l’accompagner.
Cachafaz se jucha d’un bond sur la croupe et se cramponna aux vêtements de Watson qui piqua des deux et mit son cheval au galop. Richard croyait avoir deviné la pensée de l’enfant et dès qu’il eut dépassé la clôture de fils de fer barbelés de l’estancia il prit la direction du rancho de Manos Duras, que souvent il avait aperçu de loin.
—Vous vous trompez de chemin, patron, dit Cachafaz.
Et, montrant le point le plus élevé qui bordait le fleuve du côté de la pampa, il ajouta:
—Allons par là, au rancho de la India muerta.
Ce rancho en ruines, dit de la India muerta, était bien connu dans la région et cependant peu de gens s’y étaient rendus car il servait uniquement de refuge aux vagabonds soucieux de continuer leur voyage sans être vus des gens du pays.{270}
—Nous les trouverons là-bas, répéta le petit métis, s’ils n’ont pas filé plus loin.
Quand Robledo rentra chez lui, fatigué d’avoir inutilement cherché son ami, il fut aussi désagréablement surpris que l’avait été Watson à peu près à la même heure en arrivant à l’estancia de Rojas.
Il trouva assise sur le seuil Sébastienne qui semblait l’attendre, à en juger du moins par l’air satisfait qu’elle prit pour le recevoir. De son côté, il fut tout heureux de la retrouver car il s’imagina que Frédéric la lui envoyait pour lui expliquer sa fuite. Peut-être cet homme faible était-il revenu aux côtés de sa femme convaincu une fois de plus par ses arguments mensongers.
—C’est votre patron qui vous envoie?... M’apportez-vous une lettre de lui?
Sébastienne écouta ses questions avec une surprise qui élargissait ses yeux bridés.
—Quel patron? Le marquis?... Je n’ai pas de nouvelles de lui. Je le croyais ici. Je viens pour autre chose.
Avec des soupirs de lassitude elle avait remis son corps massif dans la position verticale; baissant le ton elle dit:
—Je n’ai pu dormir de toute la nuit et je suis venue vous voir, don Manuel, pour vous demander de répondre à une petite question.
L’ingénieur se résigna à cette consultation avec une patience non exempte d’ironie; mais dès que la métisse eut commencé son visage se transforma et il écouta chacune de ses paroles avec une attention concentrée.
Quand elle eut fini de raconter ce qu’elle avait vu et entendu la nuit précédente, elle ajouta:
—Pourquoi la belle madame et Manos Duras ont-ils parlé de ma petite patronne d’autrefois? Qu’est-ce que ma colombe innocente peut avoir de{271} commun avec eux?... Comme je ne suis qu’une bête et que je n’arrive pas à comprendre grand’chose, je me suis dit: «Je vais aller trouver don Robledo, l’ingénieur, lui qui sait tout. Il me dira bien...»
Mais Robledo ne l’écoutait plus. Il paraissait absorbé et brusquement il eut un geste de stupeur et d’inquiétude, comme s’il se fût subitement trouvé en face d’une redoutable réalité. Il tourna le dos à Sébastienne et courut rapidement vers l’endroit d’où il était venu.
La métisse fut étonnée de voir l’ingénieur partir si vite et précipiter sa course comme si ce qu’elle venait de lui dire lui eût fait craindre d’arriver trop tard. De loin, Robledo se mit à gesticuler et à pousser des cris pour attirer l’attention de don Carlos et du commissaire qui continuaient à causer à la même place. Tous les deux se regardèrent stupéfaits en l’entendant crier d’une voix haletante:
—A cheval! L’histoire du messager et de la vache n’est qu’une ruse de Manos Duras pour vous éloigner de l’estancia. J’ai peur qu’un malheur ne menace Celinda; il faut partir sans tarder. Pourvu que nous n’arrivions pas trop tard!
Quand le premier moment de stupeur fut passé, les paroles de l’ingénieur semèrent l’alarme.
Don Roque courut à sa maison pour prendre ses armes et monter à cheval. Ses quatre hommes, prévenus par lui, firent l’impossible pour le suivre; mais trois d’entre eux seulement purent trouver un cheval prêt et des armes à feu, prêtées par des voisins, pour remplacer les sabres inutiles qu’ils venaient d’abandonner.
Cependant, Robledo, rentré chez lui, pressait son domestique espagnol de seller un cheval tandis que lui-même bouclait le ceinturon garni de cartouches qui soutenait son revolver. Il fit avertir les contre{272}maîtres de ses chantiers qui habitaient non loin de là et qui possédaient des armes et demanda en outre au patron du bar le magnifique rifle américain qu’il dissimulait sous son comptoir.
Robledo craignait aussi à ce moment qu’on laissât don Carlos Rojas s’échapper. Il l’avait obligé à venir jusque chez lui et lui avait recommandé d’être prudent.
—Ce n’est pas parce que vous arriverez là-bas une demi-heure plus tôt que vous empêcherez ce qui a pu arriver; par contre, si vous partez seul, vous risquez de vous trouver à la merci de ces bandits. Un peu de patience. Nous partirons tous ensemble.
L’estanciero écoutait ces conseils avec des grognements impatients; il tremblait tout à la fois de colère et d’anxiété. Robledo s’éloigna un instant de la porte de sa maison pour marcher à la rencontre de quelques hommes qu’il avait mandés et leur expliqua ce qu’il attendait d’eux. Le cabaretier parut à son tour portant le rifle américain qu’il remit à son compatriote aussi solennellement que s’il lui eut confié toute sa famille.
Don Carlos profita de l’éloignement momentané de Robledo pour sauter sur son cheval et partir au grand galop sans s’inquiéter des cris qui l’accompagnaient dans sa fuite.
Après cet acte de l’impatient Rojas, l’expédition s’organisa; l’ingénieur et le commissaire se trouvèrent à la tête d’une douzaine d’hommes, tous à cheval et armés de carabines.
La nouvelle s’était répandue dans le village et des groupes de femmes et d’enfants accouraient pour assister au départ de la troupe de cavaliers. Quand le peloton passa devant l’ancienne maison de Pirovani, Robledo en regarda les fenêtres avec quelque inquiétude.
«Qui sait, se dit-il, si nous ne contemplerons pas{273} là-bas un nouveau malheur causé par cette femme!»
A la même heure, Watson abandonnait son cheval et, suivi de Cachafaz, commençait à ramper au milieu des âpres buissons. Le petit métis l’avait conduit jusqu’à une colline sablonneuse, sur le rebord du plateau, d’où l’on avait une vue presque verticale sur le rancho de la India muerta.
Il connaissait l’endroit de réputation. Vingt années auparavant la maison avait des habitants qui faisaient paître leurs moutons dans les champs voisins. Mais les ouragans capricieux avaient brusquement recouvert le sol d’une épaisse couche de sable. De plus, le puits du rancho, qui fournissait autrefois une eau relativement douce, ne contenait plus qu’un liquide salé. Les hommes avaient fui, les constructions de briques crues étaient rapidement tombées en ruines; seuls les vagabonds recherchaient l’abri de leurs toits crevés.
Watson s’étonna de pouvoir avancer en rampant au milieu des arbustes de la colline de sable sans que l’aboiement d’un chien vînt déceler sa présence. Cela lui fit craindre que Cachafaz ne se fût trompé dans ses déductions et que la masure ne fût vide. Mais le petit métis, qui ouvrait la marche, s’arrêta entre deux touffes de buissons et, tournant vers lui son visage, lui fit signe d’approcher.
Il passa lui-même la tête entre les tiges et il put voir, à vingt mètres au-dessous de lui, une esplanade de sable au centre de laquelle s’élevaient les ruines du rancho. Deux chevaux erraient à pas lents, en quête de l’herbe maigre qu’ils mâchonnaient, et un homme était assis par terre, un fusil en travers des genoux.
Cachafaz lui souffla à l’oreille:
—C’est un de ceux qui ont enlevé la petite patronne.{274}
Watson eut beau tendre le cou pour regarder, il ne put voir aucune autre personne. Abandonnant son observatoire, il recula en rampant et, revenu au pied de la colline, il tira de sa poche un crayon et une lettre oubliée dont il déchira un feuillet. Cachafaz le regardait écrire de ses yeux de petit animal rusé, comme s’il devinait ce qu’on attendait de lui. Richard lui remit le papier puis lui montra l’endroit où il avait laissé son cheval.
—Cours au village et remets cette lettre à M. Robledo, l’ingénieur, ou au commissaire... au premier des deux que tu rencontreras.
Il voulut ajouter d’autres explications, mais le lutin à peau cuivrée n’était plus là pour les entendre. Il s’était lancé sur la pente et un instant après il sautait sur le cheval et disparaissait au galop. Richard recommença l’ascension du coteau sablonneux pour aller observer ce qui se passait dans le rancho. Il aperçut cette fois deux hommes: celui qu’il avait déjà vu et qui était toujours assis par terre, sa carabine en travers des genoux, et devant lui, debout, armé des seules armes qu’il portait à sa ceinture, un gaucho qu’il reconnut immédiatement: c’était Manos Duras. Tous deux causaient, mais il ne put entendre leurs paroles à cause de la grande distance qui le séparait d’eux. Son observation était donc inutile pour le moment. Il ne put songer non plus à les attaquer même en profitant de la surprise, car il ne voyait que deux de ses ennemis; les autres étaient certainement à l’intérieur des ruines, en train de dormir peut-être.
«Où peuvent-ils garder Celinda?» pensa le jeune homme.
Toujours se traînant au milieu des buissons il commença de suivre le contour de la colline sablonneuse pour tâcher d’examiner les ruines du côté opposé. Les deux bandits continuèrent à parler sans{275} se douter qu’au haut de la pente voisine un homme rampait pour les espionner.
Le compagnon de Manos Duras, celui qu’on appelait Piola, se mit à lui parler sur un ton de reproche.
—Tu sais très bien que je n’aime pas les affaires où les filles sont mêlées. Il est rare qu’elles finissent bien, et, de plus, elles font un fracas de tous les diables. Il aurait mieux valu aller rafler du bétail au Limay pour le vendre ensuite dans la Cordillère. Il aurait mieux valu aussi emmener les vaches du vieux Rojas et en faire du bon argent que de nous amuser comme des gamins à lui enlever sa génisse.
Manos Duras fit le geste de l’homme supérieur qui ne juge pas à propos d’expliquer l’opportunité de ses actes; Piola continua:
—Tu as peut-être des raisons pour agir ainsi. Nous t’avons aidé comme des frères, mais si on t’a payé pour enlever la demoiselle, tu devrais partager avec nous.
Le gaucho prit un air hautain.
—Il ne s’agit pas d’argent. Je t’ai expliqué que c’était une vengeance; c’est la plus terrible que je puisse tirer de ce maudit vieux qui m’a insulté... Tu connais aussi nos conventions. Vous me la réservez, puis, quand nous aurons gagné la Cordillère, elle sera pour vous.
Piola sourit avec une joie répugnante en l’entendant rappeler leur pacte.
—C’est bon; nous te la réserverons, dit-il. Tu seras le premier... si tu viens nous rejoindre au plus tard demain. Si tu tardes, tu ne la retrouveras pas entière... Mais, pourquoi ne pars-tu pas tout de suite avec nous? Pourquoi nous quittes-tu? Qu’as-tu donc à faire à la Presa ce soir?
—Je vais me faire payer, répondit Manos Duras{276} avec jovialité. Je veux laisser mes comptes en ordre avant de partir.
L’autre, qui ne pouvait comprendre l’optimisme de son compagnon, se mit à réfléchir. Peut-être en ce moment savait-on déjà au village ce qui était arrivé à l’estancia de Rojas. Et si on l’ignorait encore, on le saurait avant longtemps, c’est-à-dire dès que don Carlos serait rentré chez lui après son inutile voyage à la Presa. Manos Duras ne craignait-il pas que le commissaire et les autres habitants du village ne l’accusassent du rapt de la jeune fille?
—Cela pourrait arriver, répondit le gaucho, mais on m’a reproché tant de choses sans jamais trouver aucune preuve!... Si on me voit au village, on finira par croire que je n’ai pas été mêlé à l’affaire. Aucun des gens de l’estancia ne m’a vu. D’ailleurs, j’irai d’abord à mon rancho pour le cas où quelqu’un s’y rendrait et je n’entrerai au village que vers le soir, comme les autres fois... Je compte avoir réglé mes affaires à minuit et je pourrai partir vous rejoindre.
Piola cligna de l’œil tout en montrant du doigt le rancho voisin.
—Qu’est-ce qu’elle en dit?
—Elle croit que nous l’avons enlevée pour tirer de l’argent du vieux. Elle ne devine pas ce qui l’attend... C’est une fille qui a du nerf et elle ne semble pas avoir bien peur maintenant que la première émotion est passée. Pucha, elle m’a donné du fil à retordre quand je l’ai emportée sur mon cheval... Je lui ai laissé les mains attachées là-dedans car sans cela elle se défend et je suis obligé de la battre tout comme un homme.
Manos Duras demeura pensif, puis ajouta avec un sourire cynique:
—Je n’ai pas voulu rester là-dedans, frère, car tu comprends bien que c’est risqué de se trouver{277} seul avec une belle fille... Je t’avouerai que j’en connais une qui me plaît davantage; j’espère la voir bientôt. Mais celle-là aussi est appréciable et si on restait seul avec elle, le diable s’en mêlerait; on commencerait à faire de petites choses, seulement pour s’amuser, puis on perdrait la tête et on ne sait trop ni quand ni comment ça finirait. Nous sommes maintenant en territoire ennemi, il ne faut pas l’oublier, et nous n’avons pas de temps à perdre... Je renvoie la fête à demain. Aujourd’hui, j’ai autre chose à faire pour que les réjouissances soient complètes... Quand les camarades reviendront nous nous dirons adieu. Continuez votre route avec la génisse, moi je retourne à mon rancho et à demain s’il plaît à Dieu.
Richard rampa inutilement entre les buissons; il ne vit que les deux hommes absorbés dans leur conversation et la masure dont l’unique entrée, située du côté opposé, était obstruée par des madriers disjoints. Il se demanda si les ravisseurs de Celinda l’avaient cachée là ou si la jeune fille se trouvait dans un refuge plus difficile à découvrir, sous la garde des deux autres hommes de la Cordillère.
Lassé enfin de faire le guet inutilement, il se laissa glisser sur la pente sablonneuse et vint s’asseoir à l’endroit où Cachafaz avait pris son cheval.
Il demeura ainsi longtemps; il eût voulu voir les heures passer avec une rapidité prodigieuse pour mettre fin à la torture de cette attente impuissante et laisser paraître dans le lointain ses amis qu’il avait appelés à son aide.
Ses yeux, qui fouillaient l’horizon sans rien remarquer de nouveau, s’éclairèrent soudain en apercevant un cavalier minuscule qui grandissait à mesure que le galop continu de sa monture le rapprochait de lui. Quelques minutes après, il put le{278} reconnaître facilement car il l’avait vu le matin même. C’était don Carlos Rojas.
Bien qu’il se dirigeât vers lui, il jugea prudent de se porter à sa rencontre et il se mit à courir aussi rapidement que le lui permettait le sol sablonneux sillonné par les racines des plantes sauvages que le vent avait mises à nu et où ses pieds s’embarrassaient et butaient violemment.
En le voyant apparaître sur le bord du chemin, don Carlos fit cabrer son cheval tout en tirant son revolver de sa ceinture. Puis, reconnaissant Richard, il mit pied à terre.
Watson ne parvenait pas à comprendre l’arrivée de l’estanciero car il avait adressé sa lettre à ses amis de la Presa. De plus il arrivait seul.
—Où sont les autres? demanda-t-il. Avez-vous vu Robledo?
Don Carlos fit une réponse évasive.
L’ingénieur et le commissaire venaient peut-être derrière lui, mais peut-être aussi leur faudrait-il des heures pour arriver.
—Je n’ai pas voulu les attendre. Je les trouve un peu... flegmatiques; qui sait à quel moment ils seront ici. La patience m’a manqué, et me voici.
Il expliqua ensuite que, tandis qu’il courait dans le rancho de Manos Duras, sans passer par son estancia, il avait vu venir à sa rencontre un cavalier qui galopait à bride abattue. Il avait tiré son revolver pour l’arrêter, mais en remarquant son allure, il ne s’était pas servi de son arme.
—Il semblait un singe sur un cheval et j’ai reconnu que ce singe était Cachafaz. Il m’a raconté que vous étiez ici; il m’a montré votre papier et je lui ai dit de prévenir ceux qui viennent derrière moi de ne pas perdre leur temps à passer par l’estancia; il doit les conduire ici directement... {279}Que se passe-t-il?
Tous deux marchèrent au milieu des buissons en suivant les traces laissées par Watson quand il était venu au-devant de Rojas. Don Carlos, qui menait son cheval par la bride, le laissa à l’endroit même où Richard avait laissé le sien un moment auparavant. Puis ils gravirent sur les genoux, en s’aidant de leurs mains, la colline sablonneuse du sommet de laquelle ils pouvaient voir le rancho de la India muerta.
Avançant la tête au milieu des feuilles, ils virent Piola assis par terre comme tout à l’heure; mais il était seul. Manos Duras avait disparu.
L’homme fumait et regardait autour de lui avec inquiétude comme si ses sens, aiguisés par la vie aventureuse du désert, l’eussent averti de l’approche d’un ennemi caché.
De temps en temps il tendait le cou et regardait au loin, comme attendant l’arrivée de quelqu’un.
—Attaquons-le, dit don Carlos à voix basse.
Il lui importait peu que l’homme de la Cordillère eût sa carabine toute prête en travers des genoux. Lui et Watson avaient leur revolver.
—N’oublions pas l’autre qui est caché, répondit l’ingénieur.
—Eh bien quoi? Ils seront deux, et nous sommes deux aussi... Je vais abattre ce bandit.
Il prit son revolver, décidé à tirer de l’endroit où il se trouvait sans tenir compte de la distance; mais Watson le retint de la main et lui murmura à l’oreille:
—Il y a deux autres hommes et je ne sais pas où ils sont. Attendons l’arrivée de nos compagnons.
Ils demeurèrent dans cet état de douloureuse incertitude, ballottés entre les voix de la prudence qui leur ordonnait d’attendre et le désir de tenter cette folie d’attaquer des ennemis dont ils ignoraient le nombre exact.{280}
Watson ne tarda pas à savoir où s’étaient cachés les deux autres compagnons du gaucho. Au loin éclatèrent de furieux aboiements de chiens. Piola appela et Manos Duras, sortant du rancho, parut à l’angle du bâtiment de briques, visible un instant pour les deux hommes qui guettaient étendus au milieu des buissons.
C’étaient les gens de la Cordillère qui arrivaient; après le rapt ils avaient couru au rancho de Manos Duras afin de ramener le peloton de chevaux qui devait les suivre dans leur voyage vers les Andes pour porter les vivres et les autres objets indispensables à une aussi longue expédition. Les chiens avaient grossi le peloton.
Un moment après firent leur entrée sur l’esplanade de sable deux cavaliers armés de carabines et six chevaux en liberté qui formaient un groupe compact et portaient sur leur dos des sacs et des paquets assujettis avec des cordes. Les trois chiens de Manos Duras bondirent d’abord autour des ruines en saluant de leurs aboiements joyeux leur maître invisible, puis ils parurent inquiets et se mirent à flairer autour d’eux. Soudain, ils éclatèrent en hurlements féroces. Bavant de rage, les crocs menaçants, ils essayaient de gravir la pente sablonneuse, puis revenaient en arrière pour avertir les gauchos de la présence d’un ennemi caché.
Les deux cavaliers, qui n’avaient pas encore mis pied à terre, les sifflèrent d’abord inutilement, puis partagèrent leur inquiétude et regardèrent avec des yeux méfiants les buissons de la colline voisine.
—Ils nous ont découverts, murmura l’estanciero. Tant mieux! nous en finirons une fois pour toutes.
Watson se rendit compte qu’il était impossible d’attendre plus longtemps et le suivit vers la base du mamelon jusqu’à l’endroit où se trouvait le cheval. Don Carlos se mit en selle après s’être assuré{281} que son revolver jouait facilement dans sa gaine. Richard marchait à pied, appuyé sur une des jambes de Rojas. Tous deux se dirigèrent franchement vers le rancho.
Quand ils y arrivèrent, précédés par les chiens qui reculaient sans cesser de montrer leurs crocs et d’aboyer avec fureur, ils aperçurent les deux hommes de la Cordillère, encore à cheval, et Piola avec sa carabine appuyée contre la poitrine, prêt à faire feu. Don Carlos s’adressa à lui comme s’il eût été le chef.
—Où est ma fille? demanda-t-il violemment.
Le gaucho andin l’écouta avec un visage impassible et feignit de ne pas comprendre.
—Pas de mots inutiles, continua l’estanciero. Si c’est de l’argent que vous voulez, causons; nous nous entendrons peut-être.
Piola garda le silence. Pendant ce temps, obéissant peut-être à un signe de lui, les deux cavaliers s’éloignèrent pour examiner l’horizon. L’un d’entre eux revint seul et, mettant pied à terre, prononça quelques mots à voix basse. On ne voyait personne aux environs. Les chiens aboyaient toujours et rôdaient inquiets, mais c’était le résultat de la première alerte. Ces deux hommes étaient certainement venus seuls.
Rojas fit de nouvelles offres et, donnant à sa voix un ton de douceur exagérée, il s’efforça de contenir son indignation.
—Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur, répondit enfin Piola. Vous vous trompez, je n’ai jamais vu cette demoiselle.
—Oseriez-vous prétendre que vous n’êtes pas des amis de Manos Duras?
Tandis que les deux hommes parlaient, Richard, s’écartant un peu, essaya de faire le tour du rancho pour gagner la porte; mais{282} l’autre gaucho, devinant son intention, lui barra la route et leva sa carabine, prêt à le viser. Finalement Piola tourna le dos à Rojas sans lui avoir fait aucune réponse précise et marcha vers l’angle du bâtiment détruit derrière lequel il disparut.
Don Carlos voulut le suivre, mais il se heurta au même homme qui avait arrêté Watson. Cette fois il dirigeait franchement son rifle vers eux pour les empêcher de passer et ils durent s’arrêter, partagés entre la crainte de cette menace et le désir qu’ils avaient de se jeter sur le bandit.
D’un coup de pied, Piola écarta les poutres disjointes qui fermaient l’entrée du rancho. La présence de l’homme de la Cordillère mit fin à la lutte entre Celinda et Manos Duras. La jeune fille, les mains attachées, se défendait des assauts lubriques de son ravisseur. Elle l’avait égratigné, elle l’avait mordu tout en le repoussant à coups de pieds. Le gaucho portait au visage et aux mains des écorchures d’où le sang coulait, mais son excitation était telle qu’il ne paraissait pas s’en rendre compte.
En voyant son camarade il fit un effort pour retrouver son calme et dit avec une gaieté féroce:
—Je te l’avais bien dit, frère. On commence par plaisanter puis on prend goût au jeu. On ne peut pas rester calme à côté d’une belle fille.
Mais il se tut en s’apercevant que Piola le regardait avec reproche.
—Tu t’amuses ici comme un gamin, tandis que dehors il se passe des choses.
Du geste il l’invita à sortir, puis quand il eut passé la porte il ajouta en baissant le ton:
—Le vieux de l’estancia est là avec un de ces gringos qui travaillent aux chantiers du fleuve. Que faisons-nous?
Manos Duras, malgré tout son cynisme, fut étonné d’apprendre que don Carlos était là, derrière le mur{283} de briques. Comment avait-il pu arriver si tôt... Qui avait pu lui révéler que sa fille se trouvait dans ce rancho lointain?... Mais sa férocité naturelle et le souvenir de l’outrage que lui avait fait Rojas lui inspirèrent une solution.
—Le mieux, c’est de le tuer.
—Et le gringo aussi? demanda ironiquement Piola. Tu as vite fait de trouver un remède à tout.
L’homme de la Cordillère était inquiet; son instinct semblait lui révéler la proximité d’un danger. Il était maintenant persuadé que ces deux hommes n’étaient pas venus seuls. D’autres allaient sans doute arriver pour leur prêter main forte. Ce que Manos Duras avait de mieux à faire, si vraiment il tenait à pousser à fond cette mauvaise affaire que représentait le rapt de Celinda, c’était de monter à cheval sans perdre de temps et d’emporter la belle jusqu’à un certain endroit, au bord du Rio Limay, où ils avaient décidé de se retrouver le lendemain. Il ferait bien de renoncer à retourner au village ce soir-là. Il importait maintenant que l’ordre de marche fût changé. Pendant qu’il s’éloignerait en emportant la petite, ils resteraient là avec les chevaux. Piola se chargerait de convaincre le vieux de l’inanité de ses soupçons. Et si d’autres gens du village arrivaient, ils seraient obligés de convenir, puisqu’ils les trouveraient sans la moindre femme avec eux et sans Manos Duras, qu’ils étaient de pacifiques voyageurs arrêtés en cet endroit.
Le gaucho l’écouta avec impatience. Il avait pris goût à l’aventure et il n’admettait aucune modification. Il voulait garder Celinda, mais il ne voulait pas renoncer à rentrer au village à la nuit tombante pour aller se faire acquitter sa mystérieuse dette.
—Tu pourrais aussi faire autre chose, continua{284} Piola. Le père offre de payer si nous lui rendons sa fille, et...
Mais il ne put continuer. Tout près d’eux, derrière l’angle du bâtiment de briques, retentit un coup de feu, suivi d’un cri. L’ami de Manos Duras lança un juron.
—Voilà le bal qui commence, dit-il en armant sa carabine et en courant vers l’endroit d’où venait la détonation.
Rojas venait de décharger son revolver sur l’homme qui lui barrait la route. Ce dernier avait surtout surveillé Watson qui était le plus jeune et lui inspirait plus de méfiance; il avait tourné son fusil vers lui et don Carlos avait profité de cette négligence pour tirer doucement son revolver, viser la poitrine du gaucho, et faire feu.
Dès que l’ennemi fut à terre, Watson se pencha sur lui pour s’emparer de son arme.
Quand Piola arriva au coin du rancho, Rojas avait déjà le pied à l’étrier; par un sentiment atavique de centaure champêtre, il se croyait plus fort et plus sûr à cheval qu’à pied. Watson, qui luttait avec le blessé, venait de lui arracher son rifle et se préparait à se redresser; mais il vit le bandit andin le viser, car il était le plus près de lui; instinctivement il se courba au moment même où le coup partait. Grâce à ce mouvement, le projectile, au lieu de lui traverser la poitrine, lui entama seulement l’épaule gauche, ne lui faisant qu’une blessure superficielle. La douleur l’obligea à lâcher la carabine et il demeura accroupi, tenant son épaule dans sa main.
Son agresseur fit quelques pas vers lui pour assurer son coup au moment même ou Manos Duras, attiré par le bruit de la lutte, avançait la tête à l’angle du bâtiment. Il vit don Carlos, déjà à cheval, braquer son revolver sur Piola. Il prit lui aussi le sien dans{285} sa ceinture pour tirer sur l’estanciero, mais il n’en eut pas le temps. Entre eux deux s’interposait l’autre cavalier andin qui était jusque-là resté en observation.
—Voilà du monde!... beaucoup de monde!...
Les chiens arrivèrent derrière lui; ils bondissaient en avant puis reculaient en aboyant vers les ennemis invisibles.
A partir de ce moment, les événements semblèrent se précipiter et se superposer avec une incroyable rapidité.
Manos Duras fut le premier à agir, il courut à son cheval qui continuait à brouter l’herbe sans s’effrayer des coups de feu qu’il s’était dès longtemps accoutumé à entendre. Puis il disparut derrière le rancho.
Piola parut oublier Watson pour penser à sa propre sécurité. C’était aussi un homme de cheval qui se sentait plus sûr de lui et plus fort en selle qu’à pied. Il monta à cheval, tenant toujours sa carabine à la main droite, et rejoignit son camarade. Tous deux allèrent se placer à côté du peloton de chevaux et se disposèrent à défendre jusqu’à la mort le chargement de sacs et de ballots qui représentait la fortune de la communauté.
Rojas sembla oublier leur existence et s’approcha de Watson pour lui demander avec une ingénuité émue:
—Qu’avez-vous, gringuito?... Ils vous ont tué?
La blouse du jeune homme était marquée à l’épaule d’une tache noire qui allait s’élargissant; mais il se releva et répondit avec un pâle sourire:
—Ce n’est rien: une égratignure seulement.
Don Carlos ne put s’occuper de lui plus longtemps. Il voulait savoir ce qui se passait de l’autre côté du rancho et, poussant son cheval, il dépassa l’angle du bâtiment.{286}
Il ne trouva personne; la porte rustique, complètement ouverte, laissait voir l’intérieur vide. Mais détournant son regard des ruines, il vit s’éloigner au galop un cavalier qui portait sur le devant de sa selle une espèce de long rouleau qu’il soutenait d’un bras et qui s’agitait violemment comme un être vivant.
Son instinct plutôt que ses sens avertit l’estanciero.
—Ah! voleur de gaucho!
Le paquet qu’il avait d’abord pris pour un rouleau de vêtements contenait une vie et refusait de se laisser emmener.
Ses oreilles perçurent une voix de femme; était-ce une erreur de ses sens troublés par l’émotion? Cependant, il eut au même instant la certitude que Celinda l’avait reconnu et l’appelait en une plainte désespérée.
—Papa! papa!...{287}
Quand Hélène s’éveilla, tard dans la matinée, elle s’aperçut avec surprise que la métisse ne répondait pas à ses appels répétés.
Elle vit arriver enfin une de ces fillettes qu’on appelait chinitas[28] et qui travaillaient dans la maison sous les ordres de Sébastienne; la jeune fille lui déclara que la respectable métisse était sortie à la première heure et n’était pas rentrée.
—On dit qu’il y a eu du grabuge à l’estancia de don Carlos Rojas. Le commissaire est parti avec beaucoup d’hommes.
D’après la fillette on avait vu Sébastienne aux environs du village, à cheval, et accompagnée du domestique de M. Robledo.
—Elle a dû aller voir s’il n’est rien arrivé à sa petite patronne d’autrefois. Chacun raconte son{288} histoire... Mais ce qui est sûr c’est qu’on a tué quelqu’un à l’estancia.
La servante cessa de parler en voyant que sa patronne ne paraissait pas curieuse d’en savoir davantage. Elle s’était contentée de pousser une exclamation de surprise aux premiers mots de ce rapport. Puis elle avait gardé le silence comme si le récit ne l’intéressait pas.
Après avoir déjeuné, elle demeura toute la matinée dans le salon de sa maison. Elle pensait aux longues heures qui allaient s’écouler avant que la nuit vînt et elle s’impatientait. Elle était décidée à faire appeler Robledo; mais, d’après la petite servante, Robledo était parti avec le commissaire pour l’estancia de Rojas et il ne devait revenir que le soir.
Elle ne vivrait pas plus longtemps dans ce village. Son mari pouvait bien rester et travailler à la construction des canaux. Pour elle, elle pensait demander à Robledo les moyens de regagner Paris, ou tout au moins l’argent nécessaire pour se rendre à Buenos-Ayres. Une fois dans la grande ville elle saurait bien se défendre. Au temps de sa jeunesse elle s’était trouvée dans des situations aussi graves sinon pires et elle savait par expérience qu’une femme énergique peut se tirer d’un mauvais pas plus facilement qu’un homme.
Songeant à ce qu’elle allait dire à l’Espagnol, elle appelait la nuit, mais en même temps elle s’effrayait de la fuite rapide des heures, car le moment approchait où un homme était en droit de se présenter à sa fenêtre pour exiger d’elle l’accomplissement d’une promesse faite la nuit précédente.
Elle avait besoin d’un effort de pensée pour se convaincre qu’elle n’avait pas rêvé cette entrevue avec Manos Duras.{289}
«Quelle sottise! pensa-t-elle. Ai-je pu vraiment agir ainsi?»
Bien souvent dans sa vie elle s’était pareillement étonnée de ses propres actes; il semblait qu’il y eût en elle deux personnalités ennemies dont l’une avait horreur de l’autre.
«Et peut-être cet homme viendra-t-il dès ce soir!» pensait-elle.
Pour se tranquilliser elle se dit que le gaucho avait peut-être oublié ses promesses. Mais il lui revint immédiatement que sa petite servante lui avait vaguement parlé des événements terribles survenus à l’estancia de Rojas.
Cependant comme elle avait tendance à croire que les événements devaient toujours s’ajuster à sa convenance, elle retrouva sa confiance et son optimisme.
«Il ne viendra pas, se dit-elle. Quelle extravagance! Cet homme-là pouvait-il prendre au sérieux une promesse aussi absurde?...»
Après les bruits qui avaient circulé dans le village, il n’oserait pas revenir. D’ailleurs si ce sauvage était redoutable en rase campagne, elle saurait s’en défendre ici en tenant étroitement closes les fenêtres et les portes de la maison.
Elle cessa donc de penser au gaucho, mais le souvenir de la dernière nuit ne sortit pas de sa mémoire. Quelque chose s’était passé au lever du jour, au moment où la lumière avait commencé d’apparaître aux fentes de sa fenêtre; elle s’en était rendu compte confusément, comme on perçoit les événements extérieurs quand les yeux hésitent à s’ouvrir et quand la pensée oscille encore entre le sommeil et la veille.
Complètement éveillée maintenant elle médita sur ce qu’elle avait entr’aperçu plusieurs heures auparavant, et elle se convainquit qu’un homme s’était{290} arrêté devant sa fenêtre au lever du jour. Elle se souvint qu’un bruit de pas étouffés avait couru sur la galerie extérieure, et que la cloison de bois avait légèrement craqué sous le poids du corps appuyé contre elle. Elle aurait même juré qu’elle avait entendu comme un soupir douloureux ou un râle de désespoir. Et son instinct lui disait que cet être mystérieux qui avait vécu quelques instants auprès d’elle, derrière la cloison de planches, n’était autre que son mari.
Par deux fois elle s’approcha de la fenêtre et l’ouvrit pour l’examiner à l’intérieur et à l’extérieur avec l’espoir de trouver une lettre ou un indice quelconque du passage de l’invisible visiteur que l’aube avait amené et que le soleil levant avait chassé.
«C’est Frédéric, répéta-t-elle: ce ne peut-être que lui... Robledo doit savoir où il se trouve. Comme je voudrais qu’il revînt au village pour lui parler.»
Un peu après midi, tandis qu’elle fumait sa vingtième cigarette, on frappa à la porte. Un moment de silence s’écoula, puis les coups se firent entendre à nouveau. Hélène comprit que, profitant de l’absence de Sébastienne, les deux chinitas avaient quitté la maison pour aller vagabonder dans le village, en quête de nouvelles.
Elle se décida à aller ouvrir elle-même, et fut toute surprise en reconnaissant le visiteur: c’était Moreno. La présence de l’employé n’avait en elle-même rien d’extraordinaire, et cependant Hélène ne put retenir un geste d’étonnement, car depuis bien longtemps elle ne pensait plus à lui. Pendant ces dernières heures, c’était l’image d’autres hommes qui avait accaparé sa pensée.
Rougissant de son oubli, elle l’invita avec une amabilité exagérée à pénétrer dans la maison. Un heureux hasard lui envoyait cet imbécile pour la dis{291}traire pendant cette interminable soirée qui sans cette visite eût coulé monotone et solitaire.
En entrant dans la grande salle, Moreno caressa les meubles d’un regard tendre et protecteur, comme des meubles à lui. Puis il prit place, avec une aisance dont il n’avait jamais fait preuve lors de ses précédentes visites, dans le fauteuil qu’elle lui offrit.
—Je pars pour Buenos-Ayres par le train de ce soir, madame la marquise, dit-il avec la vanité d’un homme conscient de ses propres mérites. Il faut que j’aille informer le Gouvernement de ce qui s’est passé ici et m’entretenir avec le ministre des Travaux Publics sur les mesures à prendre pour continuer les travaux.
Hélène approuva de la tête ces paroles tandis que ses yeux semblaient sourire avec malice. Ce brave père de famille s’exagérait un peu son importance.
—Mais, avant de partir, j’ai cru devoir venir vous trouver pour traiter d’une question qui a certains rapports avec mes entreprises futures.
Il continua de parler et bientôt l’étincelle de joyeuse ironie qui dansait dans les pupilles de la Torrebianca s’éteignit. Ses yeux n’exprimèrent plus qu’un intérêt passionné et sans cesse grandissant.
Moreno lui exposait comment Pirovani lui avait confié toute sa fortune et l’avait nommé tuteur de sa fille unique qui vivait en Italie.
—L’infortuné, continua-t-il, à ce que j’ai pu voir en examinant rapidement ses papiers, était plus riche que je ne pensais. Cette suprême mission que mon malheureux ami m’a confiée va me donner beaucoup d’ouvrage et m’obliger peut-être à quitter mon emploi; qui sait même si je pourrai revenir ici!... Je crains que nous ne nous revoyons pas avant bien longtemps.
Malgré l’air satisfait et assuré qu’il affectait depuis{292} la veille l’employé s’attristait en pensant à l’éventualité de cette longue absence.
—Comme cette maison, reprit-il, appartenait au pauvre Pirovani qui m’a confié la gestion de ses biens, je viens vous dire madame la marquise, en vertu de mes pouvoirs, que vous pouvez y demeurer sans payer un centime, aussi longtemps que vous le jugerez utile. Considérez-la comme vôtre. Que ne ferais-je pas pour vous!
Elle fixait sur lui un regard curieux. Elle avait peine à cacher l’étonnement que cette révélation lui avait causée. Moreno, dépositaire de l’héritage de l’entrepreneur; Moreno, pliant sous le poids de l’énorme fortune qui tombait entre ses mains et retournant vers les villes populeuses pour y refaire sa vie!
Des pensées nouvelles se firent jour peu à peu à travers sa surprise, semblables à des îlots informes et bouillonnants encore, en plein travail de formation. Son être se dédoublait et, auprès de la femme frivole, éprise de luxe et de vanité, surgissait celle dont l’énergie redoutable dans les moments difficiles était capable de résolutions extrêmes, et qui ne craignait pas de faire souffrir. Et cette femme en s’éveillant donnait à sa compagne cet impérieux conseil: «Ne le laisse pas partir, c’est le destin qui te l’envoie.»
Moreno, qui contemplait «madame la marquise» avec des yeux plus hardis depuis qu’il se voyait riche et puissant, vit soudain comme l’ombre d’un nuage invisible sur ses traits; sa bouche se contracta douloureusement, et elle enfouit son visage dans ses mains pour cacher ses larmes.
L’employé se leva de son fauteuil pour la consoler. Il avait compris sa douleur; ne portait-elle pas le deuil de la mère de son mari? Et puis, la{293} triste fin de Pirovani, la fuite de Canterac, tant d’événements accumulés en si peu de temps!
—Tout ce qui arrive est bien triste, madame la marquise, mais il ne faut pas que cela vous fasse pleurer.
Et il se hasarda à lui prendre les mains et à les serrer doucement avant de les écarter de ses yeux mouillés de larmes.
—Ce n’est pas ce que vous croyez qui me fait pleurer, soupira-t-elle; je pleure sur moi-même, sur mon malheur que rien ne peut réparer. Je suis seule au monde. Mon mari n’est pas rentré depuis deux jours... et ne rentrera plus peut-être. Quelles calomnies a-t-on pu lui rapporter! Il me restait mes amis, mes fidèles amis, l’un est mort, l’autre est en fuite. Je n’avais plus que vous... et vous partez pour toujours!
L’employé, tout ému, balbutia:
—Mon admiration vous restera toujours, madame la marquise... Je pars, mais en réalité, je ne pars pas... A Buenos-Ayres, je serai à votre disposition.
Il cessa de parler car l’émotion commençait à lui troubler les idées. Hélène avait séché ses larmes et le regardait avec intérêt.
—Personne n’a jamais pu me comprendre, dit-elle. Les hommes sont ainsi faits: ils se précipitent tous ensemble vers la femme qui leur plaît, l’assomment de leurs assiduités et se disputent la première place de telle façon que la malheureuse toute désorientée ne sait pas bien connaître celui qu’elle préfère. Maintenant que vous partez et que je vous perds pour toujours, je me rends compte que les deux amis qui nous ont quittés, se mettaient en avant avec tant d’autorité qu’ils avaient réussi à me cacher l’homme qui aurait dû m’intéresser le plus.
A ces mots, Moreno fut si bouleversé qu’il prit la main d’Hélène dans les siennes.{294}
—Oh! marquise, que dites-vous!
Elle se laissa caresser la main et pressa même une des siennes entre ses doigts, puis elle ajouta avec l’accent de la vérité, comme pour lui confier ses pensées les plus intimes:
—Je vous ai toujours apprécié pour votre modestie, cette modestie qui cache de grandes qualités que vous ne soupçonnez pas vous-même. J’aime les hommes dont le cœur est plein de bonté et libre d’orgueil. Souvent, dans ma solitude, je pensais aux grandes choses qu’aurait pu réaliser en Europe un homme tel que vous, guidé dans son œuvre par une femme inspiratrice de nobles ambitions.
Moreno garda le silence. Il la regardait avec un certain étonnement et semblait l’admirer davantage après les mots qu’il venait d’entendre. Cette femme avait les mêmes pensées qu’il avait eues bien souvent lui-même sans oser y croire tout à fait.
Hélène ajouta, accablée:
—Mais il est trop tard; laissons cela! Vous avez une famille, je n’ai plus d’illusion ni d’espoir. Je suis seule et pauvre, et je ne sais comment s’achèvera ma vie.
L’employé demeurait pensif, les sourcils froncés, et semblait tourmenté d’une vision pénible. Il revoyait dans une petite maison près de Buenos-Ayres, aux pièces modestes et propres, une femme et des enfants. Mais cette image ne tarda pas à s’effacer et Moreno reprit l’air assuré et autoritaire qu’il avait montré dans les premiers moments de sa visite.
—Moi aussi, dit-il, je réfléchis plus souvent qu’autrefois. Cette nuit je n’ai pas pu dormir: je me suis levé trop tard pour aller voir ce qui s’est passé à l’estancia de Rojas... Et hier, justement, j’ai pensé qu’il vaudrait mieux peut-être que je parte pour l’Europe. Je veillerais sur la fille de Pirovani et je gérerais ses biens plus commodément qu’à Buenos-{295}Ayres. Qui sait? peut-être augmenterais-je considérablement cette fortune en me lançant dans les affaires! Je ne suis pas sûr de posséder les qualités que vous m’attribuez, madame la marquise; mais j’ai l’habitude des chiffres, j’ai de l’ordre et je suis peut-être capable de réussir dans les affaires tout comme un autre. Pourquoi pas?
Il y eut un long silence et l’employé, troublé d’avance par ce qu’il allait dire, osa enfin balbutier timidement.
—Peut-être pourriez-vous venir avec moi en Europe... pour me donner des conseils. Vous me croyez très intelligent, mais là-bas je ne serai qu’un ignorant.
Hélène eut un mouvement de surprise et repoussa avec hauteur cette proposition.
—C’est impossible! Quelle folie!... De quel fardeau allez-vous vous charger, mon ami!... Vous oubliez d’ailleurs que je suis mariée, que je suis du monde et que les gens en nous voyant ensemble feraient les suppositions les plus outrageantes.
Mais tout en protestant, elle prit dans les siennes les mains de Moreno, approcha du sien son visage, l’enveloppa du parfum qui émanait de sa chair tentatrice, et dit enfin avec enthousiasme:
—Que votre cœur est grand!... Comment vous prouver ma reconnaissance pour votre intention généreuse?
Moreno se remit à parler d’un ton suppliant. Que leur importait les propos des gens?... En Europe, personne ne les connaissait. Ils vivraient à Paris, dans la cité merveilleuse qu’il avait si souvent admirée à travers les romans et qu’il n’aurait jamais pu voir si Pirovani n’était pas mort. C’est lui que devrait remercier la marquise, si elle daignait être sa compagne et son inspiratrice.{296}
—Et votre famille? demanda la Torrebianca d’un ton grave que ses regards démentaient.
Il répondit avec l’optimisme cynique de l’homme qui sait le pouvoir de l’argent et qui compte, grâce à lui, résoudre toutes les difficultés.
—Ma famille restera à Buenos-Ayres où elle sera mieux installée que jamais. Avec beaucoup d’argent on arrange tout et chacun est heureux... J’aurai beaucoup d’argent, car il est bien juste que je me récompense moi-même des peines que m’imposera mon rôle de tuteur. Et j’en gagnerai aussi dans les affaires.
Elle résistait encore, mais toujours plus faiblement, et Moreno jugea bon de l’émouvoir en lui décrivant les délices de ce Paris qu’il n’avait jamais vu et dont l’autre était déjà lassée.
—C’est une folie, interrompit Hélène; je n’ai pas le courage d’aller au-devant d’un pareil scandale. Que dira-t-on si nous fuyons ensemble?
Puis elle ajouta avec une expression de pudeur craintive:
—Je ne suis pas telle que vous croyez. Les hommes acceptent avec une étonnante facilité tout ce qu’on leur raconte des femmes, et qui sait ce qu’on a pu vous dire de moi!... J’avoue que mon mariage n’a pas été heureux; mon mari est bon, mais il n’a jamais su me comprendre. Mais, de là à provoquer un scandale en fuyant avec un autre homme!
L’employé eut recours à toutes les phrases qu’il avait emmagasinées dans sa mémoire au cours de ses lectures. Qu’était-ce que le mariage et que l’opinion du monde! Elle avait le droit de connaître le véritable amour, si elle le trouvait sur sa route. Elle avait aussi le droit de «vivre sa vie» aux côtés d’un homme qui saurait l’embellir pour elle autant qu’elle le méritait.
Il continuait à réciter des fragments de ses lectures{297} romanesques et la marquise, qui devait connaître aussi bien que lui la valeur de tels arguments, finit pourtant par se laisser attendrir et troubler par cette amoureuse éloquence.
La Torrebianca jugeait maintenant qu’elle avait suffisamment prolongé son simulacre de résistance et croyait le moment venu de céder pour permettre à Moreno de passer à des questions d’un intérêt immédiat.
Elle feignit de n’avoir plus entière conscience de ses actes; passant ses mains sur les épaules de Moreno elle parla tout près de son visage d’une voix faible comme un souffle, et les yeux au ciel, elle semblait se perdre dans ses souvenirs.
—Oh! Paris! Vous ne le connaissez que par les livres, mais vous ne savez pas vraiment ce qu’est cette vie. Une existence bien douce nous attend là-bas.
L’employé considéra ces mots comme une acceptation et se crut en droit de la prendre dans ses bras.
—Vous acceptez n’est-ce pas? Oh! merci... merci!
Mais Hélène le repoussa pour couper court à ces effusions et avec le sérieux de la femme qui sait mener une affaire, elle reprit la parole.
—Si je disais «J’accepte» ce serait à la condition que nous partirions aujourd’hui même. Sans cela je pourrais me repentir... D’ailleurs, pourquoi rester plus longtemps dans cet endroit odieux? Je n’y ai que des ennemis. Mon mari lui-même m’abandonne... Je ne sais ce qu’il est devenu.
Moreno approuva de la tête. Il fallait profiter du train de ce soir. S’ils attendaient le prochain, en deux jours, de nouveaux incidents se produiraient peut-être. Le malheureux employé croyait de bonne foi que la marquise était capable de regretter sa déci{298}sion et jugeait nécessaire de profiter de ce moment favorable.
Hélène lui posa plusieurs questions pour fixer en quelque sorte, avant de le suivre, les articles du contrat verbal qui les lierait. Moreno lui exposa tout ce que Pirovani lui avait confié en remettant ses papiers entre ses mains et toutes les recommandations orales qu’il avait ajoutées. Sa fortune était solidement établie. Avant le duel il lui avait également remis tout l’argent qu’il avait chez lui. L’employé pouvait payer les frais du voyage et du long séjour qu’ils auraient à faire dans un luxueux hôtel de Buenos-Ayres.
—Une fois dans la capitale, continua-t-il, je réaliserai tous les fonds qui sont déposés au nom de Pirovani et je ferai le nécessaire pour que le gouvernement me verse également ce qu’il lui doit pour ses entreprises... Je connais beaucoup de personnes haut placées qui m’aideront... Vous verrez que si bien des gens me croient sot, je sais me retourner quand il s’agit de finances... Dès que les affaires seront en ordre nous nous embarquerons pour l’Europe.
Enhardi par ses propres paroles et certain maintenant qu’Hélène acceptait, il tenta de porter la main sur elle; mais elle l’écarta.
—Non, dit-elle avec sévérité, tout en fermant à demi ses yeux malicieux. Tant que nous ne serons pas arrivés à Paris je ne serai pour vous qu’une compagne de voyage. Les hommes sont ingrats quand leur désir est satisfait trop vite; ils abusent de la tendresse des femmes et oublient vite leurs serments.
Elle eut un sourire plein de promesses et dit à voix basse en fermant à demi ses paupières.
—Mais, dès que nous serons à Paris....
Moreno fut agréablement troublé de l’expression qui accompagna ces quelques mots.{299}
«Paris!...» Cette exclamation mentale fit surgir dans l’imagination de l’employé la vision des mille épisodes de la vie joyeuse menée par les étrangers dans la grande ville, ainsi que la décrivaient les romans.
Il vit un élégant restaurant de Montmartre comme il les imaginait et comme il avait pu les admirer sur les toiles des cinématographes. Il crut entendre la musique sautillante et heurtée d’un jazz-band. Il suivit des yeux le tournoiement des couples qui dansaient dans un large espace rectangulaire, entouré de petites tables brillamment servies.
Puis la marquise faisait son entrée, vêtue avec un luxe éblouissant, appuyée sur son bras. Lui-même était en habit, et une perle énorme luisait sur son plastron. Le gérant de l’établissement le saluait avec le respect mêlé de familiarité qu’on doit aux clients bien connus; les femmes admiraient de loin les bijoux d’Hélène; un groom aussi petit qu’un gnôme emportait le somptueux manteau de fourrure de la dame, d’où émanait un parfum de jardin enchanté.
Il examinait la carte des vins, et commandait un champagne si cher que le sommelier exprimait par une révérence son admiration.
La vision s’évanouit et Moreno se trouva dans l’ancienne maison de Pirovani, en face de cette femme qu’il avait désirée avec la ferveur qu’inspire l’irréalisable, et qui, en ce moment, le dévorait des yeux.
—Oh! Paris, dit-il. Comme j’ai hâte de m’y trouver avec vous... Hélène!... Car vous me permettrez maintenant de vous appeler Hélène, n’est-ce pas?{300}
Pour Watson, les faits se succédèrent avec la rapidité vertigineuse et l’illogisme des tableaux d’un cauchemar qui se déroule par delà le temps et l’espace.
Il entendit des coups de feu; puis des cavaliers passèrent devant lui ventre à terre tandis que d’autres s’arrêtaient net et faisaient feu sur les deux andins. En vain Piola criait en levant les bras.
—Ne tirez pas, frères, nous sommes des gens pacifiques et nous nous rendons!
Les nouveaux venus ne voulaient rien entendre et continuaient à décharger leurs carabines sans obéir aux ordres de Robledo.
Le camarade de Piola, blessé, tomba et l’autre jugea bon de sauter à terre et de se mettre à l’abri derrière son cheval.
Bientôt le groupe entier des gens de la Presa se trouva réuni sur l’esplanade du rancho. Watson ne fit pas attention aux exclamations de Robledo qui s’étonnait de le trouver là, ni aux saluts du commissaire. Tous deux l’oublièrent à leur tour pour{301} marcher vers Piola et le sommer, le revolver sur la poitrine, de leur dire où était Celinda. Quelques hommes de la troupe mirent pied à terre pour examiner l’individu qui venait d’être blessé et celui que don Carlos avait abattu.
L’attention du jeune homme fut attirée enfin par la vue de son propre cheval sur lequel le petit Cachafaz se dressait d’un air important, en montrant les trois vaincus d’un doigt accusateur.
—Voilà les brigands qui ont enlevé ma petite patronne. Je les ai vus, moi...
Mais il n’eut pas le loisir de continuer car il se sentit pris par la taille et, brusquement dépourvu de sa dignité de cavalier, il se retrouva à terre.
Richard domptant la douleur qu’un tel mouvement causait à son épaule blessée l’avait saisi de son bras valide. Son cheval sembla le reconnaître quand il se fut remis en selle et prit, au grand galop, dès qu’il eut senti les éperons, la direction qu’avait suivie Rojas.
L’estanciero poursuivait Manos Duras depuis plusieurs minutes et ne perdait pas l’espoir de l’atteindre. Il était difficile de galoper d’une façon continue sur ces pentes sablonneuses. De plus le cheval du gaucho portait le poids de deux personnes et son cavalier était forcé de maintenir Celinda tout en pressant la marche de sa monture. Rojas était moins gêné dans sa poursuite et surtout il avait les mains libres.
Tout en fuyant, le bandit tourna plusieurs fois la tête vers Rojas et tendit son bras droit armé d’un revolver. Deux balles sifflèrent tout près de don Carlos qui riposta mais cessa bientôt de tirer. Il n’avait plus que trois cartouches. Le matin, en quittant l’estancia il avait bouclé son ceinturon porte-revolver mais n’avait pas garni de munitions nouvelles les gaines de la cartouchière. Il ne pouvait{302} plus compter que sur les trois coups qui lui restaient à tirer et sur le couteau qu’il portait à sa ceinture pour les besoins de sa vie aux champs. Il craignait aussi de blesser sa fille.
Le gaucho, mieux approvisionné, continua à prodiguer ses balles tout en fuyant.
L’estanciero comprit ce que voulait Manos Duras et son indignation s’accrut encore.
—Oh! le bandit! Il essaie maintenant de tuer mon cheval!
Et le centaure argentin ressentit à cette pensée la même rage qu’il avait éprouvée en voyant sa fille en danger.
Un instant après, Rojas, qui paraissait toujours soudé à sa monture et qui faisait corps avec elle, sentit sous ses jambes un tressaillement mortel. Il déchaussa vivement les étriers et sauta à terre au moment même où la pauvre bête roulait sur le sol; du poitrail sortait un jet de sang semblable au flot pourpré qui jaillit d’un tonneau qu’on défonce.
L’estanciero se trouvait à pied et l’autre s’enfuyait emportant sa fille sur l’arçon de sa selle. Il concentra toute sa volonté dans la main qui tenait le revolver et dirigea l’arme vers son ennemi en fuite. Il fallait tuer le cheval.
Rojas qui ne craignait pas de combattre les bêtes féroces ou les hommes, trembla d’émotion. Tuer un cheval! Il était excellent tireur et cependant il pressa la détente une fois, puis une autre sans que la monture du gaucho cessât de galoper. Il allait tirer la dernière cartouche quand le cheval de Manos Duras tituba, ralentit son élan, puis fit panache en soulevant de ses ruades d’agonie un nuage de sable.
Rojas reprit sa course, mais avant d’avoir atteint le lieu de la chute il vit le gaucho se relever et tirer un second revolver de sa ceinture, sans cesser de maintenir Celinda du bras gauche. L’air mena{303}çant, il attendit dans cette posture que son ennemi approchât.
Don Carlos avança encore de quelques pas, mais Manos Duras fit feu sur lui et la balle passa si près de son visage qu’un instant il se crut atteint. Rojas se jeta alors à terre pour offrir une moindre cible aux balles et se mit à ramper le revolver à la main. Le gaucho ne pouvait deviner qu’il n’avait plus qu’une cartouche, et, croyant qu’il rampait vers lui pour le viser de plus près, il continua son feu.
De plus, il maintenait Celinda devant sa poitrine comme un bouclier. Mais la jeune fille se débattait pour échapper au bras robuste qui la retenait prisonnière et ses mouvements firent plusieurs fois dévier les balles.
—Si tu tires une fois de plus, vieux, je tue ta fille.
A cette menace, don Carlos, qui avait d’ailleurs conscience de son impuissance, n’osa pas tirer et se contenta de ramper lentement sur le sable.
Manos Duras parut soudain s’inquiéter d’un nouveau danger qu’il sentait tout proche et il commença de jeter de côté et d’autre des regards avides. Mais comme il avait d’abord à redouter son ennemi le plus rapproché, l’estanciero, il ne voulut pas égarer son attention et continua de tirer.
L’autre ennemi encore invisible était Watson, qui entendant les détonations avait mis pied à terre pour se rapprocher du lieu de combat et s’avançait le corps ployé au milieu des plantes rudes qui montaient du sol sablonneux.
Il eut un moment la pensée d’attaquer Manos Duras avec son revolver, mais il craignit de blesser Celinda qui se débattait toujours pour échapper à son ravisseur.
Il revint alors vers son cheval et détacha de la selle le lasso que lui avait offert la fille de Rojas.{304} Il le prit dans sa main droite et par un détour au milieu des buissons il parvint à se placer derrière le gaucho.
Cette courte marche le fit beaucoup souffrir. Des branches épineuses s’accrochèrent plusieurs fois à son épaule blessée; de plus la crainte d’échouer lui donnait un tremblement intérieur. Saurait-il bien se servir de cette arme primitive?
Il se rappelait les rires dont la Fleur du Rio Negro soulignait sa maladresse; mais cette évocation des joyeuses promenades qu’il avait faites en compagnie de celle qui maintenant était aux prises avec un si terrible danger lui rendit son énergie et sa volonté. Les enseignements qu’il avait reçus dans sa jeunesse, l’esprit méthodique et pratique de sa race lui donnèrent du courage. «Ce qu’un homme fait, un autre peut bien le faire.» Il se recommanda aux puissances mystérieuses et impondérables qui mènent notre existence et nous protègent parfois d’un inexplicable amour et il lâcha le lasso presque sans regarder, se fiant au hasard et à son instinct. Puis bondissant en arrière au plus épais des buissons il tira sur la corde d’un effort joyeux et puissant, car la résistance lui indiquait que le lasso avait saisi sa proie. Sa joie fut si sauvage qu’il tira des deux mains bien que la déchirure de son épaule lui arrachât des rugissements de douleur.
Le lasso avait en effet emprisonné le groupe formé par Manos Duras et Celinda, s’enroulant autour de leurs corps. Sous la rude traction tous deux tombèrent à la renverse.
Le gaucho lâcha Celinda pour recouvrer l’usage de ses deux mains; encore allongé sur le sol il tira son couteau de sa ceinture et trancha la corde qui le liait. Watson qui avait deviné son intention s’approcha en courant et à plusieurs reprises le frappa sur la tête et au visage avec la crosse de son revolver.{305} Mais Rojas en quelques bonds arrivait lui aussi auprès du groupe jeté à bas. Il avait lâché son revolver inutile et saisi son couteau.
—Laisse-le moi, gringo!... ordonna-t-il d’une voix haletante, c’est à moi seul de le tuer... Il est à moi!
Il repoussa Watson qui, s’occupant désormais de Celinda seule, l’enleva de terre et l’emporta derrière les buissons les plus proches. La jeune fille, encore étourdie par sa chute, se frotta les yeux sans reconnaître l’Américain. Elle avait au visage et au bras des écorchures d’où le sang coulait goutte à goutte. Cependant, don Carlos aidait presque Manos Duras à se relever.
—Debout, fils de chienne... tu ne pourras pas dire que je te tue en traître! Sors ton couteau et à nous deux!
Le gaucho avait déjà le couteau à la main; Rojas ne s’en était pas aperçu, tout à la joie féroce d’avoir enfin cet homme à portée de son poing.
A peine debout, le bandit lui lança traîtreusement sa pointe vers le ventre, mais il était encore étourdi par les coups que Watson lui avait assénés; son attaque fut molle et l’estanciero eut le temps de parer d’un revers de la main gauche.
A son tour, il le frappa en pleine poitrine, puis le cribla de coups si pressés que Manos Duras s’écroula en perdant son sang par vingt blessures.
—Le voilà mort, le puma!
Don Carlos poussa ce cri en brandissant son couteau rouge de sang au-dessus de sa tête tandis que le blessé se tordait à ses pieds en roulant d’un côté sur l’autre avec des râles d’agonie.
Watson avait emporté Celinda à l’écart pour l’empêcher de voir le combat, mais en prenant soin de ne pas perdre de vue l’estanciero qui pouvait avoir besoin de son aide.{306}
Les deux hommes se retrouvèrent et portèrent la jeune fille jusqu’à l’endroit où l’ingénieur avait laissé son cheval. Ils voulaient cacher à Celinda la vue de l’agonisant. Brisée par tant d’émotions elle les regardait avec des yeux dilatés et vagues et semblait ne pas les reconnaître. Enfin elle se jeta au cou de son père et fondit en larmes. Puis, oubliant les préjugés ordinaires, elle se blottit dans les bras de Watson et le couvrit de baisers.
Le grand garçon que troublaient ces caresses et qu’effrayaient les blessures superficielles du visage de la jeune fille, demandait anxieusement:
—Vous ai-je fait mal, miss Rojas?... N’est-ce pas que j’ai lancé le lasso moins mal que d’autres fois?
Tous deux l’aidèrent à se mettre en selle et, marchant à côté de son cheval, reprirent la direction du rancho de la India muerta.
Robledo et le commissaire s’avancèrent à leur rencontre et manifestèrent leur joie de retrouver Celinda. Les autres hommes de l’expédition étaient arrêtés devant les ruines. Après avoir pansé à leur manière les deux blessés, ils les surveillaient ainsi que Piola, et parlaient de les conduire dès le lendemain à la prison de la capitale du territoire.
Celinda, en se retrouvant au milieu d’amis qui se félicitaient joyeusement de sa délivrance reprit vite sa gaieté et sa pétulance. Elle essayait de cacher à Watson les écorchures qui gâtaient son visage, mais quand ses yeux se fixaient sur lui, ils étaient pleins de tendresse.
—Vous ai-je fait mal, miss Rojas?... répéta le jeune homme, d’un ton suppliant, comme si son trouble ne lui eût pas permis de poser d’autres questions. N’est-ce pas que je n’ai pas trop mal lancé le lasso?
Elle regarda de côté et d’autre pour s’assurer que{307} son père était loin et dit à voix basse en imitant l’accent de Richard:
—Gringo chapeton, fieffé maladroit!... Oui, tu m’as fait mal et tu lances le lasso terriblement mal... Mais enfin tu m’as attrapée et comme j’ai juré qu’à cette condition, je te reviendrais, eh bien me voici!
Elle avança les lèvres comme pour le caresser de leur petit cercle rose; c’était une avance sur ce qu’elle lui donnerait tout à l’heure, quand ils seraient seuls.
L’expédition rentra à la Presa à la tombée de la nuit après avoir pris quelque repos à l’estancia de Rojas, où Sébastienne guettait. La métisse poussa des clameurs de joie en voyant revenir sa petite patronne, mais les blessures que Celinda avait au visage lui arrachèrent aussitôt après des cris d’indignation. Au milieu d’un flot de paroles furieuses elle laissa échapper le nom de la marquise malgré les recommandations prudentes que Robledo lui faisait à voix basse. Elle finit par raconter à Rojas tout ce qu’elle savait de l’entretien de la «grande dame» et de Manos Duras, et lui fit part des soupçons que lui avait suggérés leur entente.
Sébastienne, sans consulter son ancien patron, décida de rester à l’estancia auprès de Celinda.
Don Carlos lui-même avait demandé à Watson de rester lui aussi jusqu’au lendemain, en attendant son retour.
—J’ai une petite course urgente à faire à la Presa; quelques mots à dire à certaine personne.
La voix mielleuse et l’accent doucereux de l’Argentin avaient quelque chose d’effrayant. Robledo essaya de le faire renoncer à ce voyage car il devinait son intention. Rojas fut plus explicite avec lui.
—Laissez, don Manuel, il faut que je voie cette garce qui a voulu faire du mal à ma fillette. Je me contenterai de lui trousser les jupes et de lui appli{308}quer cinquante coups de ce rebenque, comme ceci...
Et il faisait siffler la terrible lanière de cuir de son fouet court.
L’Espagnol dut accepter sa compagnie jusqu’au village; il comprenait qu’il était inutile de tenter de s’opposer à ses desseins. Rojas était encore possédé de la rage homicide qu’avait suscitée en lui son combat avec Manos Duras, mais Robledo espérait le calmer au bout de quelques heures.
Quand ils arrivèrent dans la rue centrale les gens de l’expédition trouvèrent rassemblée presque toute la population de la Presa. Les premiers cavaliers donnaient en passant les nouvelles qui couraient promptement d’un groupe à l’autre. Tout le monde se félicitait de la mort de Manos Duras comme si le village eût été délivré d’un terrible fléau.
Les plus craintifs déploraient que le commissaire gardât les trois prisonniers dans un rancho voisin du village pour les envoyer le lendemain à la prison du territoire. La foule, avec cette férocité collective qui se fait jour dès que survient la délivrance longtemps attendue, aurait voulu les mettre en pièces pour se venger de la terreur que le gaucho, maintenant disparu, lui avait longtemps inspirée.
Mais la dernière nouvelle que lancèrent les cavaliers bavards de l’avant-garde allait permettre à tous de satisfaire leur rage. En un instant chacun eut connaissance des révélations de Sébastienne. La «grande dame» avait préparé, d’accord avec Manos Duras, une terrible vengeance comme en contaient les grands lecteurs de romans ou comme la plupart en avaient vu s’accomplir sous leurs yeux au cinématographe. L’étrangère blonde avait voulu tuer la pauvre fille de l’estancia, une enfant du pays, par envie ou pour toute autre raison.
Robledo qui passait à cheval au milieu des groupes comprit à quelques mots surpris au vol que la{309} colère commençait à s’emparer des habitants. Les hommes de l’expédition défilaient justement devant l’ancienne maison de Pirovani. Les femmes, qui se montraient les plus enflammées, poussèrent les premières des cris hostiles en regardant les fenêtres de l’édifice.
—Mort à la gueule peinte, mort à la grande p....
Et elles lâchaient franchement la plus grande injure qui se peut adresser à une femme. Robledo pressentant ce qui allait arriver tourna bride et vint placer son cheval devant les premières marches du perron de bois.
Mais les fidèles mêmes qui l’avaient suivi dans son expédition refusaient de lui obéir.
Négligeant ses conseils et ses ordres, les femmes et les gamins commencèrent à passer sous le ventre de son cheval ou à se glisser le long de ses flancs... Et derrière ces premiers assaillants, les hommes envahirent l’entrée de la maison. Ils saluaient vaguement et s’excusaient du geste en passant devant l’ingénieur.
L’assaut fut foudroyant et les obstacles cédèrent avec cette facilité qui centuple bientôt l’ardeur des attaques populaires aux jours de révolution triomphante. La porte brisée s’abattit, la vague humaine eut un remous sur le seuil puis s’engouffra tumultueusement dans l’intérieur de la maison. Les vitres des fenêtres volèrent en éclats, puis les meubles, le linge, toute sorte d’objets jaillirent au dehors comme des projectiles. En vain quelques-uns, plus prudents et plus calmes, protestaient contre cet absurde pillage.
—Mais cela ne lui appartient pas... Tout appartenait à don Enrique l’Italien.
La multitude n’écoutait plus rien; pour elle tout était la propriété de la grande dame; elle pouvait{310} ainsi sans scrupules satisfaire sa rage. Et elle ne cessait de pousser des clameurs où revenait souvant l’infamante épithète.
Enfin, Robledo, qui gesticulait sur son cheval et criait des ordres inutiles, réussit à se faire entendre. Les assaillants semblaient fatigués. D’ailleurs ils n’avaient pu découvrir la femme détestée et la déception avait calmé leur fureur destructrice. Mais la cause principale du silence relatif qui permit à Robledo de reprendre quelque influence fut l’arrivée d’un vieil ouvrier espagnol qui avait cessé de travailler aux canaux pour s’employer à porter l’eau du fleuve jusqu’aux maisons du village à l’aide d’une charrette attelée d’une rosse lamentable.
L’homme obtint l’attention de tous plus vite que l’ingénieur. Les assaillants descendirent peu à peu dans la rue pour écouter de plus près.
—Que faites-vous là, criait-il. Elle est partie... Je l’ai vue dans une voiture avec Monsieur Moreno, l’homme du Gouvernement. Ils s’en vont à la station prendre le train de Buenos-Ayres.
Immédiatement des cavaliers de bonne volonté s’offrirent à l’arrêter dans sa fuite. Elle avait pris une grande avance, mais peut-être en crevant leurs chevaux pourraient-ils la rattraper à Fort Sarmiento.
D’autres doutaient du succès de cette poursuite. Le train passerait dans une heure à peine. Il n’avait jamais de retard car il partait de la station précédente, celle du Neuquen.
Les femmes, qui étaient toujours les plus acharnées, conseillaient aux cavaliers de tenter de toute façon l’aventure; ils ramèneraient la «grande dame» en la traînant par les cheveux. Des hommes pleins de sens et d’imagination proposaient dans la même intention pieuse de se placer simplement le long de la voie et de faire au passage du train une décharge nourrie sur la voiture où avait pris place la grande p....{311} Et ils s’étonnaient quand Robledo essayait de leur faire comprendre qu’il pouvait se trouver d’autres voyageurs dans le même wagon et que d’ailleurs il était impossible, parmi toutes les voitures qui formaient le train, de reconnaître la sienne.
Quand tous furent enroués à force de crier et convaincus qu’ils n’arriveraient pas à rattraper la «grande dame», ils se turent et l’ingénieur put se faire entendre.
—Laissez-la partir. C’est Gualicho qui nous quitte après avoir jeté le désordre partout... Tout ce qu’il faut souhaiter c’est que ce démon ne revienne plus. Que n’est-il parti plus tôt!
Quand la nuit fut enfin venue la foule s’apaisa. C’était l’heure du dîner et les plus exaltés préférèrent poursuivre leur conversation à la table de famille et au magasin du Gallego.
Rojas demeurait sombre et semblait avoir oublié tous les événements de la journée pour ne plus penser qu’à la fuite d’Hélène.
—Croyez bien que je le regrette, don Manuel. J’aurais bien voulu lui retrousser les jupes, puis avec mon rebenque...
D’une main il faisait le geste de soulever les jupes d’Hélène et il expliquait la vengeance qu’il lui eût plu d’exercer.
A partir de ce jour le village où le seul personnage important était Robledo connut une existence monotone et bientôt angoissée. Les ouvriers, voyant les travaux suspendus, commencèrent à se débander. Les groupes d’oisifs passaient leur temps à prédire la reprise des travaux par ordre du gouvernement dans le courant de la semaine suivante; mais l’ordre n’arrivait pas. Là-bas, à Buenos-Ayres, on étudiait posément la question, et les ouvriers perdant patience jetaient sur leur dos leur sac plein de hardes et s’en allaient à pied ou en chemin de{312} fer bien loin de ce lieu où l’argent n’arrivait plus et où la pauvreté grandissait chaque jour.
Le magasin, redevenu boutique, avait pris un aspect funèbre. Seuls quelques vieux clients, de solvabilité reconnue, venaient boire debout devant le comptoir. Don Antonio le Gallego avait rudement refusé tout crédit à la plus grande partie des consommateurs et, pour appuyer la décision qu’il avait prise, avait placé un revolver dans chacun des tiroirs de la banque, et le beau rifle américain sous son siège. Quand son public n’avait pas d’argent ces précautions n’étaient pas superflues.
—Il faut que vous alliez à Buenos-Ayres, don Manuel, disait-il à Robledo avec son solide optimisme. Vous êtes le seul qu’on écoutera là-bas.
Mais la tristesse et le découragement extérieurs avaient fini par gagner Robledo. Seule l’ardeur nouvelle de son associé Watson parvenait à lui arracher un sourire mélancolique. Richard paraissait heureux et nullement inquiet de ses canaux. Il ne s’intéressait plus qu’à l’élevage et passait des jours entiers à l’estancia de Rojas.
Que lui importait l’arrêt momentané des travaux!... Il était jeune et les années s’échelonnaient nombreuses devant lui. Il n’avait d’autre désir que de pénétrer la vie d’une estancia, mais sous la direction de Fleur du Rio Negro, qui du lever au coucher du soleil l’accompagnait à cheval dans la campagne.
Une lugubre découverte vint accroître la tristesse de l’Espagnol peu de temps après la fuite d’Hélène.
Gonzalez lui présenta un chapeau qu’un de ses clients avait trouvé au bord du fleuve, loin du campement. L’ingénieur le reconnut immédiatement. C’était celui que portait Torrebianca.
Il était depuis longtemps convaincu que son ami n’était plus au nombre des vivants. Souvent, pendant la nuit, quand la pénible situation financière{313} de ses entreprises l’inquiétait au point de lui ôter le sommeil, il reconstituait de déduction en déduction les actes du mari d’Hélène après sa sortie de la maison au petit jour. Sans aucun doute, son corps était au fond du fleuve.
Le patron du bar vint un autre jour lui faire part de la découverte qu’avaient faite quelques Espagnols, qui, se trouvant sans travail, s’adonnaient à la pêche. Deux lieues en aval du village ils avaient pris pied dans une île fangeuse entourée de roseaux, avec l’espoir de capturer quelques truites venues du lac lointain de Nahuel Huapi. Au milieu des roseaux de la rive ils avaient aperçu deux objets allongés et noirs que le courant balançait; c’étaient les jambes de Torrebianca.
Robledo n’eut pas le courage d’aller voir le cadavre. Après avoir séjourné un mois dans l’eau il n’était plus qu’une masse gluante que paraissait animer le grouillement de toute une faune éclose dans ses chairs. Son compatriote Gonzalez, quittant pour une fois le comptoir de son magasin, se chargea de faire le nécessaire pour donner à ces restes une sépulture.
—Allez à Buenos-Ayres, il le faut, répétait le cabaretier. Don Ricardo et moi nous vous remplacerons ici. Là-bas dans la capitale vous travaillerez pour nous bien mieux que si vous restez à la Presa.
Robledo reconnut enfin la justesse de ces conseils et partit pour Buenos-Ayres. Pendant plusieurs mois il courut les ministères, demanda instamment la reprise des travaux, lutta contre la routine des techniciens et des bureaux.
Il dut faire aussi tous ses efforts pour sauver son crédit dans les banques. Ceux qui avaient soutenu autrefois son entreprise exprimaient ouvertement des doutes et refusaient d’avancer encore l’argent qui aurait permis de la poursuivre. Une atmosphère de{314} scepticisme et de méfiance enveloppait peu à peu tout ce qui touchait à la Presa.
L’hiver arriva sans que Robledo eût pu quitter Buenos-Ayres. Parfois il était pris d’un brusque optimisme et il espérait obtenir le lendemain même ce qu’il désirait. Mais le jour suivant on lui répondait encore: «Revenez demain», et ce «demain» devenait un mot fatidique, symbole vague d’un avenir qui jamais ne serait réalisé.
Les journaux lui rapportèrent un soir l’inquiétude des populations riveraines du Rio Negro. Le débit des affluents augmentait avec une abondance inquiétante. C’était la crue que depuis plusieurs mois il n’avait cessé d’annoncer dans les ministères pour obtenir que l’on continuât à temps les travaux.
Il reçut ensuite un télégramme de ceux-là mêmes qui lui avaient conseillé d’aller à Buenos-Ayres. Ils lui demandaient maintenant de revenir, comme si sa présence eut été capable de dompter miraculeusement les forces de la nature.
Il revint à la Presa par un froid glacial. Il s’enfouit dans un manteau de chauffeur à longs poils qu’il avait toujours porté pendant les rudes journées d’hiver.
Le village était presque désert. Les maisons de bois les plus résistantes avaient barricadé portes et fenêtres. Les bâtiments d’argile montraient leurs toits écroulés; l’ouragan avait arraché les bâtis de bois de leurs orifices d’aération. Personne dans les rues. Il ne restait plus que les hommes qui habitaient le pays avant le commencement des travaux. Dix ans semblaient s’être écoulés pendant ces quatre mois d’absence.
Et ce fut alors la torture d’une attente longue et pleine d’angoisse.
Il restait des jours entiers au bord du fleuve et voyait avec une rage impuissante le danger devenir{315} plus pressant. Les eaux étaient chaque jour plus hautes et plus impétueuses; le fleuve rapide entraînait des troncs d’arbres arrachés sans doute aux pentes des Andes, ou roulait au fond de son lit d’énormes blocs invisibles.
Il ne redoutait pas le danger d’une inondation; ce qui le maintenait continuellement dans une affreuse inquiétude, c’était le sort des travaux inachevés et non le péril couru par les hommes. Tous les matins il examinait avec l’attention du médecin qui ausculte les malades la digue qui devait barrer le fleuve d’une rive à l’autre et dont l’insouciance amoureuse puis la rivalité mortelle des constructeurs avaient empêché l’achèvement.
Quelques mètres séparaient toujours le tronçon le plus long de la digue de celui qui de la rive opposée venait à sa rencontre. Les eaux, plus hautes chaque jour, recouvraient ces deux murs dont la présence invisible était décelée par des remous et des tourbillons écumeux.
Comme tous ceux qui vivent dans un perpétuel danger Robledo se sentit devenir superstitieux; il se recommandait mentalement à de vagues et puissants génies capables de réaliser un miracle.
«Si l’hiver passe sans que tout s’écroule, pensait-il, quel bonheur est le nôtre!»
Mais, un matin, sous ses yeux, un des tronçons de la digue inachevée, comme une de ces constructions de sable que les enfants construisent ou détruisent au gré de leur caprice, fut arraché par les eaux: puis elles le ployèrent comme une masse molle et flexible, et enfin les deux murailles qu’avait dressées dans le fleuve l’effort de centaines d’hommes, où s’étaient accumulées des milliers de tonnes de matériaux solides et en apparence indissolubles, roulèrent dans le courant et leurs débris échoués jon{316}chèrent les rives et le bord des îles. Alors Robledo pleura.
—Quatre années de travail! Et tout a fondu comme un peu de sucre dans l’eau!... Quatre années de labeur inutile!... Et tout à recommencer.
Son compatriote le patron du bar se jugeait ruiné comme lui. Le tiroir de sa caisse était vide. Adieu l’espoir de transformer ses champs sablonneux en riches parcelles de terre irriguée! Il était pauvre, plus pauvre que le jour où il était venu s’établir dans cette contrée maudite.
Mais il avait foi en Robledo et il voulait le réconforter; aussi se montrait-il optimiste.
—Tout s’arrangera, don Manuel, répétait-il souvent.
Mais il parlait sans conviction.
Don Manuel, voyant les eaux s’acharner à leur œuvre de destruction, passa de la tristesse à la colère. Ses yeux ne regardaient plus le fleuve. Ils vaguaient comme ceux de l’homme dont la pensée s’est enfuie très loin et qui voit ce que les autres ne peuvent pas voir.
Il se rappela Canterac et Pirovani aussi nettement que s’il les eût rencontrés la veille. Puis il vit un visage de femme sourire cruellement. Par-dessus le temps et la distance elle exerçait encore une influence maligne sur ce coin de la terre où elle était une fois passée. C’était elle en réalité qui venait de détruire la digue.
L’Espagnol serra les poings. Il se souvint de l’estanciero Rojas et du châtiment qu’il voulait infliger avec son rebenque à cette femelle vicieuse. Lui-même en ce moment aurait fait pire.
«Gualicho blond, pensa-t-il, démon funeste aux hommes et aux choses... maudit soit le jour où je t’ai conduit ici!»{317}
—Douze années ont passé depuis mon dernier séjour à Paris... Ah! je reconnais que j’ai bien changé d’aspect.
Et Robledo en prononçant ces mots se revit tel qu’il se voyait chaque matin avec mélancolie dans le miroir, en procédant à sa toilette.
Il était encore vigoureux et sa santé était excellente; mais la vieillesse avait commencé d’exercer sur lui ses ravages. Le sommet de son crâne était entièrement dénudé. Il avait par contre rasé sa moustache où les poils blancs étaient plus nombreux que les noirs; cette transformation lui avait donné, disait-il, un faux air de prêtre ou d’acteur, mais avait rendu à son visage un peu de la fraîcheur de la jeunesse.
Il était assis dans un fauteuil sous le hall d’un élégant hôtel parisien, près de l’Arc de Triomphe.
Devant lui se trouvait un jeune ménage, Watson et Celinda. La fuite des années avait seulement accentué les traits de la physionomie de Richard et frappé plus nettement sa beauté d’athlète calme. Celle qui{318} avait été la Fleur du Rio Negro montrait maintenant la beauté estivale d’un fruit doux en sa saison. Elle avait conservé sa sveltesse d’éphèbe sportif mais la maternité avait donné une majesté à ses formes épanouies.
Elle ne portait plus ses cheveux coupés comme la toison d’un petit page et elle n’eût plus osé en public les bonds et les espiègleries puériles de l’amazone de Patagonie qui étonnait les émigrants. Elle se devait maintenant de garder un sérieux de maman. Autour de la table du hall s’agitait un petit garçon de neuf ans volontaire et quelque peu désobéissant qui courait se mettre sous la protection de Robledo, autrement dit de «l’oncle Manuel» quand ses parents le grondaient. A l’un des étages du Palace deux nurses anglaises surveillaient les jeux de trois autres enfants plus jeunes.
Dans l’ensemble, ils offraient l’aspect bien connu de la famille sud-américaine qui vient s’établir pour quelques mois en Europe, comme une tribu joyeuse et riche, et qui transporte de l’autre côté de l’Océan la maison entière, sans oublier les domestiques. La famille n’était pas encore largement développée car le père et la mère étaient jeunes; quatre cabines sur le bateau et cinq chambres avec salon commun dans les hôtels suffisaient à la contenir. Encore dix années de vie et d’affaires heureuses et prospères et la caravane familiale retiendrait pour son prochain voyage en Europe tout un côté du paquebot et un étage entier du Palace.
—Et que d’événements depuis mon dernier séjour ici!
Le visage de Robledo s’assombrit au souvenir des luttes soutenues pendant deux ans pour obtenir la reprise des travaux du Rio Negro.
Il avait connu l’angoisse de dettes accumulées, les réclamations des créanciers qu’on ne peut payer.{319}
Presque tous les habitants de la Presa s’étaient dispersés après la destruction des digues par le fleuve. Les rares voyageurs qui visitaient le pays s’émerveillaient de ce village en ruines semblable dans cette terre sans souvenirs aux antiques cités mortes du vieux monde.
Le gouvernement s’était enfin décidé à reprendre les travaux. On avait vaincu peu à peu le fleuve qui s’était résigné à subir l’oppression de la digue; les canaux de Robledo et de Watson s’étaient mouillés des premières eaux, puis avaient accueilli dans leur lit fangeux l’irrigation vivifiante.
Les deux associés n’eurent plus alors qu’à laisser le temps s’écouler. L’eau miraculeuse faisait surgir une foule de miracles secondaires. Des hommes de tous pays affluaient vers le village mort pour défricher cette terre dont ils pouvaient espérer être un jour les propriétaires. Une nappe d’un vert tendre et lumineux s’étendait lentement sur les champs autrefois poudreux. Les buissons desséchés et piquants cédaient la place à de jeunes arbres qui, nourris par le suc d’une terre assoupie depuis des milliers d’ans et constamment baignés par l’eau qui courait à leurs pieds montaient prodigieusement en l’espace de quelques semaines.
Sur l’emplacement des cahutes d’argile séchée que la longue période de solitude et de misère avait détruites, on élevait des édifices de briques vastes et bas, avec un patio central, qui imitaient l’architecture espagnole de la période colonisatrice.
L’ancien bar du Gallego devenait un grand magasin avec de nombreuses annexes où l’on vendait tout ce qui peut être utile ou agréable aux gens que l’agriculture enrichit, où se traitaient toutes sortes d’affaires et où s’effectuaient même les opérations de banque.
Le propriétaire avait gagné des millions en trans{320}formant ses champs sablonneux en terres d’irrigation. Il avait enfin réalisé son rêve de regagner l’Espagne en laissant à la tête du magasin un gérant espagnol, intéressé à ses affaires.
—J’ai reçu hier une lettre de don Antonio, dit Robledo avec une indulgente ironie. Il voudrait que nous allions le voir à Madrid. Il veut nous faire admirer sa maison, ses automobiles et surtout ses hautes relations. Il me raconte fièrement que les journaux parlent des dîners qu’il donne. Il me dit aussi qu’on l’a décoré et qu’un de ces jours on doit le présenter au Roi. Voilà un homme heureux.
Le souvenir de la Patrie lointaine assombrit le visage de Celinda.
—Elle pense à son père, dit Watson à son associé. On ne peut parler de la Presa sans qu’elle s’attriste... Est-ce notre faute si le vieux n’a pas voulu venir?
Robledo approuva et tenta de consoler Celinda. Don Carlos n’avait pas voulu s’arracher à son estancia malgré les plus pressantes prières. Il ne tenait pas à revoir dans sa vieillesse cette Europe, où, jeune, il avait fait tant de folies. Il voulait conserver intactes ses illusions anciennes. Et puis il craignait de ne pas avoir tout le temps de jouir des grandes transformations que sa propriété avait subies.
—Il ne me reste que quelques années, disait-il, pourquoi irais-je les gaspiller en parcourant l’Europe, quand j’ai tant de choses à faire ici? Celinda me donnera beaucoup de petits-enfants et je ne veux pas qu’ils soient de pauvres diables.
Les canaux de Robledo avaient atteint les terres de l’estancia et transformé les pâturages maigres et brûlés en opulentes prairies de luzerne constamment humides et verdoyantes. Son bétail engraissait et se multipliait prodigieusement. Autrefois il lui fallait galoper longuement avant de trouver çà et là un animal osseux aux longues cornes qui cherchait à{321} découvrir quelque plaque d’herbe isolée au milieu de la plaine presque désertique. Aujourd’hui, les jeunes taureaux gras et lustrés ployaient les pattes sous le poids de leur chair, et ruminaient la luzerne succulente qu’ils tondaient autour d’eux sans besoin de se déplacer.
En outre, don Carlos était considéré là comme le premier personnage et pour lui c’était perdre son rang que de s’en aller vers ces pays de gringos où son histoire était inconnue et où nul ne lui prêterait attention. Il espaçait même ses voyages à Buenos-Ayres; les amis de sa jeunesse étaient morts et il y trouvait seulement leurs fils ou leurs petits-fils, qui avaient presque oublié son nom. Au contraire tout le monde à la Presa respectait en lui le plus grand propriétaire du pays. On l’avait fait aussi juge municipal et les immigrants qui cultivaient les parcelles de terrain reconnaissaient son autorité pleine de sagesse en le consultant sur toutes leurs affaires et en acceptant sans discussion ses sentences.
—Qu’irais-je faire à Paris?... J’y serais ridicule... Laissez-moi avec mes pareils... Chaque bœuf à son pâturage.
Certes, il regrettait d’être séparé de ses petits-fils, mais la séparation ne serait pas bien longue. Quand Celinda et son gringo de mari reviendraient, l’aîné aurait juste l’âge d’apprendre de son grand-père comment tout vrai criollo doit monter à cheval.
Pour le moment le petit garçon jouait avec Robledo, fort occupé d’escalader ses genoux pour se laisser ensuite retomber sur le tapis.
—Carlitos, mon trésor, supplia la mère, laisse donc en paix l’oncle Manuel.
Et elle ajouta pour répondre à ce que Robledo avait dit de son père.
—C’est vrai, il n’a pas voulu, mais cela ne m’em{322}pêche pas d’être triste quand je pense qu’il pourrait être ici et voir tout ce que nous voyons.
Une jeune dame élégamment vêtue s’approcha du groupe; c’était l’institutrice française chargée de l’éducation de Carlitos. Elle venait le chercher pour l’emmener au bois de Boulogne. La mère le couvrit de tendres caresses sans réussir à calmer ses protestations d’enfant gâté.
—Je veux rester avec l’oncle Manuel!
Mais l’oncle Manuel avait besoin de sortir seul, il l’expliqua au jeune tyran et s’excusa.
—Si tu obéis à ta maman et si tu vas au Bois avec la demoiselle, ce soir quand tu te coucheras je te raconterai une longue, longue histoire!
Carlitos prit acte de la promesse et se laissa emmener par l’institutrice sans se rebeller plus longtemps.
—Enfin le despote est parti, dit Robledo, feignant d’être fort heureux de sa délivrance.
Celinda le remercia d’un sourire. L’Espagnol avait concentré sur Carlitos tout le besoin d’aimer qu’éprouvent les célibataires au seuil de la vieillesse. Il était très riche et le cours des années accroîtrait encore sa richesse, à mesure que de nouvelles terres d’irrigation seraient livrées à la culture. Quand on lui parlait de ses millions il se tournait vers le fils de Celinda et l’appelait «mon prince héritier».
Il comptait léguer une partie de sa fortune à des neveux qu’il avait en Espagne et qu’il connaissait à peine, mais la plus grande part irait à Carlitos. Il aimait bien aussi les autres fils de Watson; mais celui-ci était né pendant la dure époque des inquiétudes et des indécisions, au moment où son œuvre était en péril, et c’est pourquoi il le préférait comme on préfère les compagnons des jours mauvais.
—Qu’allez-vous faire ce soir? demanda Robledo à Celinda. Même programme que les autres soirs,{323} sans doute: visite générale chez les grands couturiers de la rue de la Paix et des rues voisines?
Elle approuva de la tête, tandis que Watson riait.
—Quand vous lasserez-vous d’acheter des robes? continua l’Espagnol. Vous ne craignez pas que vos bagages ne trouvent pas place sur le transatlantique quand nous repartirons pour Buenos-Ayres?
Celinda s’excusa en faisant un retour vers sa lointaine patrie.
—Il faut que j’achète en prévision de l’avenir. Songez que là-bas dans notre colonie on ne trouve aucune de ces choses qu’on rencontre aussi facilement ici. Nous sommes des millionnaires du désert, nous en sommes aux premiers jours de la création d’un monde. Nous sommes pour ainsi dire des millionnaires sauvages...
Cette épithète les fit rire tous trois, puis ils demeurèrent songeurs. Leurs yeux ne virent plus le hall où ils se trouvaient, ni la foule élégante assise autour des tables voisines. Ils évoquaient l’ancien campement de la Presa, qui s’appelait maintenant «Colonia Celinda» et les champs arrosés, fertiles et riants que possédaient les deux ingénieurs. Les arbres n’étaient pas très hauts car les plus âgés n’avaient que neuf ans d’existence. Ils virent aussi la grande place de la colonie, entourée d’édifices neufs et sur la place, don Carlos Rojas que l’âge semblait avoir rapetissé, et dont le profil était chaque jour plus maigre et plus aquilin; il avait en écoutant hommes et femmes l’air autoritaire et bon des anciens patriarches.
Puis, tandis que Celinda pensait toujours à son père, les deux associés repassèrent en esprit leur prospérité actuelle. Des centaines d’agriculteurs venus de tous les pays d’Europe avaient acheté des parcelles de ces terres irriguées pour y établir leurs vergers. Les colons acquittaient par des versements échelon{324}nés sur dix ans le prix de ce sol auquel l’eau avait donné une valeur énorme. Chaque trimestre entraient dans leurs bureaux des sommes considérables qui s’en allaient dormir immobiles dans les banques.
Les canaux poussaient leurs tentacules à travers l’ancien bassin du Rio Negro et transformaient chaque année des terres sablonneuses en champs fertiles; de nouveaux émigrants étaient sans cesse attirés vers ce pays et les recettes de la société s’en trouvaient doublées ou triplées. Cela continuerait pendant des années et des années, jusqu’à ce qu’ils eussent amoncelé un total invraisemblable de millions.
Robledo pensait avec mélancolie à l’étrange destin qu’aurait cette énorme richesse. Elle était venue à lui alors qu’il était déjà vieux et n’était plus tenté par des plaisirs qui trompaient en les amusant les autres mortels. Les fils de Watson et de Celinda, archimillionnaires, ne connaîtraient jamais ni l’esclavage du travail ni les angoisses de la pauvreté; devenus des hommes ils iraient gaspiller à Paris une partie de leur patrimoine princier et se feraient connaître par leurs prodigalités et leurs qualités brillantes d’être inutiles et oisifs. L’insolence du contraste amusait Robledo, ce laborieux qui avait subi dans son existence tant de privations et de déceptions, et il acceptait avec un souriant fatalisme cet aboutissement de ses efforts; il le trouvait logique et bien d’accord avec l’ironie de l’existence.
Un autre contraste avait marqué la période où s’amassait sa richesse. Tandis qu’il devenait millionnaire, de l’autre côté des mers, la moitié du monde était livrée aux horreurs de la guerre. Au début, ce cataclysme avait mis sa propre entreprise en péril. Les colons étrangers abandonnaient les champs de l’Argentine pour aller servir leurs patries respectives. Puis, ce moment de retour vers{325} le nouveau monde s’arrêtait et un reflux humain ramenait vers ses terres de nouveaux cultivateurs.
Beaucoup de ceux qu’il avait laissés en Europe douze ans auparavant à la tête d’un capital énorme étaient pauvres maintenant ou avaient disparu. Par contre, lui, qui cherchait fortune et qui n’était qu’un colon ignorant de l’avenir se sentait comme écrasé par l’excès de sa prospérité. Il se trouvait semblable aux animaux de don Carlos Rojas, qui, gavés de nourriture, demeuraient accroupis dans la luzerne et regardaient sans appétit la riche pâture qui les entourait.
Watson et Celinda étaient jeunes; ils avaient des illusions et des désirs; ils savaient employer leur argent. Elle mordait aux délices de la vie luxueuse; son mari connaissait la plus grande joie des amoureux: plein d’une orgueilleuse satisfaction, il offrait à Celinda tout ce qu’elle pouvait désirer; mais lui... Il ne goûtait même pas l’innocente paresse qui donne à la vieillesse quelque douceur. La richesse l’avait comblé trop tard, et le temps lui avait manqué pour apprendre à être riche.
Pendant la plus grande partie de son existence il avait vécu simplement et sans confort; le confort ne lui était plus nécessaire maintenant. Devant la porte de l’hôtel une luxueuse automobile attendait dès les premières heures du matin Celinda l’ancienne amazone et son mari. Ils ne pouvaient vivre sans ce véhicule; on eût dit qu’ils en disposaient depuis leur naissance. Ah! la jeunesse! comme elle s’adapte merveilleusement à tout ce qui est richesse ou plaisir!
L’Espagnol ne pensait que dans les cas urgents à prendre une automobile de louage. Il aimait mieux marcher à pied ou employer les moyens de locomotion des gens peu fortunés.
—Ce n’est pas avarice, disait Celinda à son mari,{326} en parlant de Robledo qu’elle observait avec sa finesse de femme; il n’y pense pas et n’éprouve pas de besoin.
La voix de la jeune femme ramena les deux ingénieurs à la réalité.
—Et vous, don Manuel, que comptez-vous faire ce soir? Accompagnez-moi dans ma visite chez les couturiers et vous aurez le droit de parler de la frivolité des femmes.
Robledo n’accepta pas cette proposition.
—Je dois aller voir un ancien condisciple qui m’a demandé de l’aider dans une affaire. Le pauvre diable n’a pas fait fortune.
C’était un ingénieur qui pendant la guerre avait dirigé une fabrique de munitions. L’usine était maintenant fermée et son propriétaire n’en avait que faire, ayant réuni en quatre ans une grosse fortune. L’ingénieur recherchait sans succès un bailleur de fonds pour la transformer à son compte en fabrique de machines agricoles.
—Il habite derrière Montmartre, continua Robledo; il est chargé de famille et je vais tâcher de l’aider à s’en tirer en lui prêtant quelques douzaines de milliers de pesos, ce qui représente ici près d’un million de francs. Il veut me montrer chez lui les plans d’une machine à labourer dont il est l’inventeur.
Tous trois se levèrent et sortirent du hall. En sortant de l’hôtel, les deux époux montèrent dans une élégante automobile. L’Espagnol préféra marcher à pied jusqu’à la place de l’Etoile où il avait décidé de prendre simplement le Métro.
C’était une après-midi de printemps, l’air était doux et le ciel doré. Robledo marchait avec la vivacité d’un jeune homme. Soudain passa dans sa mémoire l’image de son malheureux camarade Torrebianca. Il n’y avait là rien que de très naturel. Depuis{327} son retour en Europe, le souvenir de Frédéric et de sa femme l’assaillait fréquemment car il avait vécu avec eux tout au long de son dernier séjour à Paris; c’est de Paris aussi qu’ils étaient partis ensemble pour l’Amérique. De plus cet ingénieur pauvre à qui il allait rendre visite lui rappelait son ancien compagnon d’études.
Pendant les douze dernières années qu’il avait passées sur les bords du Rio Negro, l’image de Torrebianca était restée vivante dans sa mémoire. Une vie de travail monotone où les incidents sont rares conserve entières les fortes impressions que ne viennent pas effacer les impressions nouvelles.
Souvent pendant ses longues heures de solitude pensive il s’était demandé quelle fin avait dû avoir Hélène.
Son influence néfaste s’était fait trop longtemps sentir dans ce coin perdu de la terre pour qu’on pût l’oublier facilement. Les plus anciens habitants de la Presa, ceux qui étaient restés fidèles à leur glèbe, et qui n’avaient pas voulu abandonner le village en ruines avaient même transmis aux nouveaux colons de la «Colonie Celinda» la mémoire d’une femme venue de l’autre côté de l’Océan et dont la beauté au pouvoir funeste avait semé la ruine et la mort.
Ceux qui n’avaient pu la connaître se la représentaient comme une espèce de sorcière, l’appelaient la «face peinte» et lui attribuaient toutes sortes de méfaits extraordinaires. Ils affirmaient même qu’elle surgissait aux points les plus solitaires du fleuve comme un fantôme à la beauté fatale, et qu’on la voyait se peigner les cheveux ou se peindre le visage; cette apparition portait malheur à ceux qui l’apercevaient et leur annonçait une mort prochaine.
Robledo essaya, au cours de divers séjours à Bue{328}nos-Ayres, d’obtenir quelques renseignements sur ce Moreno qui s’était enfui avec Hélène.
Il n’eut jamais de nouvelles certaines. Tous deux s’étaient perdus en Europe comme dans une mer qui se fût refermée sur leur tête en les engloutissant à jamais.
«Elle doit être morte, finissait par dire l’Espagnol. Elle est certainement morte. Une femme pareille ne saurait vivre longtemps.»
Et pendant quelques mois il cessait de penser à elle, puis des allusions lancées par quelque habitant primitif de la colonie venaient ranimer ses souvenirs.
Quand il descendit les marches de la station située près de l’Arc de Triomphe, il avait oublié complètement son compagnon et sa redoutable épouse. Il se sentit enveloppé et entraîné par le flot humain qui s’enfonçait dans les profondeurs du Métro et le train souterrain l’emporta à l’autre bout de Paris.
Il passa plus de deux heures chez son ami l’inventeur qui habitait un petit logement dans une rue donnant sur les boulevards extérieurs et, à la nuit tombante, il se retrouva à pied, marchant par le boulevard Rochechouart vers la place Pigalle.
Il se trouvait en pays presque inconnu.
Les excursions qu’il avait faites à Montmartre, pour accompagner des Sud-Américains avides de connaître les délices puériles et frelatées des restaurants nocturnes, ne l’avaient jamais conduit au delà de cette place. D’ailleurs, ce coin de Paris offre la nuit un spectacle trompeur qui fait contraste avec l’aspect médiocre qu’il présente pendant le jour.
Un public d’allure banale et vulgaire fréquentait le boulevard qu’il suivait.
Le soir tombait et peu à peu on voyait augmenter le nombre de ces femmes aux atours fallacieux qui attendent le crépuscule et sa lumière incertaine{329} pour se lancer à la chasse de l’homme et de leur pain.
Robledo les croisait sans paraître remarquer leurs œillades enflammées ni entendre les compliments qu’elles adressaient à sa belle mine.
«Pauvres femmes! Quels mensonges elles sont obligées de me dire pour pouvoir manger.»
Soudain son attention fut attirée par une de ces femmes. Elle était semblable aux autres et comme les autres elle le regardait avidement de ses yeux provocants. Mais... ces yeux!... où avait-il vu ces yeux?...
Elle était habillée avec une élégance misérable. Sa robe, vieille et déteinte, avait été très belle quelques années auparavant et, vue d’un peu loin, elle pouvait tromper encore les gens distraits. Elle avait conservé une certaine sveltesse et comme elle était grande, sa silhouette pouvait faire oublier un moment les ravages que la misère et le temps avaient exercés sur elle.
En voyant Robledo s’arrêter un instant pour l’examiner plus attentivement, elle sourit avec une joie sincère. C’était une bonne rencontre; la meilleure de la soirée. Ce monsieur avait l’aspect du riche étranger qui erre sans but dans un quartier excentrique où il ne reviendra jamais. Il fallait profiter de l’occasion.
Cependant, Robledo demeurait immobile et la regardait, le front plissé par un effort mental.
«Quelle est cette femme?... Où diable l’ai-je vue?»
Elle s’était arrêtée aussi et, tournant la tête pour lui sourire, elle l’invitait du geste à le suivre.
Sur le visage de l’ingénieur le doute et la surprise se reflétèrent tour à tour.
«Quoi, ce serait?... Et moi qui la croyais morte depuis des années! Non, c’est impossible. J’ai pensé{330} à elle ce soir et c’est cela qui me trouble... Ce serait là un hasard par trop extraordinaire!...»
Il continua de l’examiner de loin et crut bien reconnaître certains traits de cette physionomie flétrie, mais il demeurait indécis car d’autres traits lui étaient inconnus. Pourtant, les yeux! ces yeux!
La femme sourit encore et lui fit, sans parler, un nouveau signe de tête pour l’inviter à la suivre. Poussé par la curiosité, Robledo accepta d’un geste involontaire et elle se remit à marcher. Elle n’avança que de quelques pas et s’arrêta devant la porte grillée d’un bar d’aspect sordide dont les vitres étaient masquées par d’épais rideaux. Elle cligna de l’œil et, poussant le panneau, elle disparut à l’intérieur du crasseux établissement.
L’Espagnol hésita. La pensée d’aller rejoindre cette femme lui répugnait et cependant sa curiosité l’entraînait. Il sentit que s’il s’éloignait sans lui parler il subirait toujours cette torturante incertitude et regretterait jusqu’à la fin de sa vie d’avoir négligé une occasion d’apprendre si Hélène vivait encore ou si elle était morte.
Il eut peur de cette anxiété future et, décidé à agir, il ouvrit presque violemment la porte du bar.
Il aperçut six tables, un divan de toile cirée orné de fleurs le long du mur, des miroirs troubles et un comptoir derrière lequel on voyait des bouteilles sur des étagères. Une femme assez vieille, grosse comme un pachyderme, aux yeux noircis, à la face mouchetée de boutons et de croûtes, occupait le comptoir.
Robledo évoqua les souvenirs de ses jeunes ans passés à Paris et reconnut le petit établissement fréquenté par des femmes qui n’ont d’autres moyens d’existence que l’étreinte charnelle mais qui tiennent à conserver un certain air d’indépendance tout{331} en acceptant les conseils et l’entremise de la patronne.
Un garçon d’aspect efféminé servait les clientes. Elles étaient deux pour le moment: d’abord une toute jeune femme au visage exsangue et transparent au point qu’on croyait distinguer les creux et les arêtes des os de sa face. Une toux convulsive la secouait et entre deux quintes elle portait à sa bouche une cigarette. A une autre table il vit une femme âgée et d’aspect horrible qui, peut-être, avait été belle dans sa jeunesse. Elle avait aussi cette sveltesse hardie de la femme que Robledo avait suivie, mais sa robe et son visage révélaient une misère plus profonde. Elle buvait à lentes gorgées le contenu d’un grand verre, puis se renversait sur le divan et fermait les yeux, ivre déjà.
L’ingénieur se rendit compte en entrant que la femme était allée s’asseoir au fond de l’établissement, loin du comptoir et des autres clientes. Son arrivée provoqua une certaine émotion. La patronne l’accueillit avec un sourire qu’une obséquiosité exagérée rendait répugnant. La fillette phtisique lui lança un regard qui voulait être amoureux mais que Robledo compara à ceux des mendiants qui implorent l’aumône. La femme ivre sourit et laissa voir qu’il lui manquait plusieurs dents. Puis elle cligna de l’œil avec impudeur pour l’inviter, mais voyant que l’homme regardait ailleurs elle haussa les épaules et reprit son somme.
Le nouveau venu s’assit à une table en face de la femme qui l’avait précédé et put la contempler plus attentivement que dans la rue. Il se rendit compte que l’accoutrement de cette vagabonde n’était qu’un grossier trompe-l’œil et il eut presque un sourire de pitié.
D’un peu loin elle apparaissait vêtue pauvrement, mais avec une certaine prétention qui pouvait leur{332}rer des hommes simples ou imaginatifs, toujours prêts à trouver élégante la femme qui les remarque. De près, elle était grotesque. Son chapeau aux ailes majestueuses était rongé aux bords et les plumes en étaient brisées. Il aperçut ses pieds sous la table; comme sa jupe était remontée au moment où elle s’était assise, il put compter les trous et les reprises de ses bas. Un de ses souliers laissait voir sa semelle trouée par un long usage; la place de chaque doigt était marquée par une échancrure ronde. Le rouge et la pâte blanche dont était enduit le visage de cette femme ne parvenaient pas à cacher les rides de l’âge et les traces qu’avait laissées là une vie orageuse. Mais ces yeux!
Robledo était de plus en plus convaincu qu’il avait devant lui Hélène. Tous deux se regardèrent fixement. Puis elle demanda d’un geste si elle pouvait s’approcher et s’assit enfin à sa table.
—J’ai cru préférable d’entrer ici pour que nous puissions parler. Souvent les hommes n’aiment pas qu’on les voie dans la rue avec une femme. La plupart sont mariés. Vous l’êtes peut-être aussi, comme les autres.
La voix était rauque et ne ressemblait pas à celle qu’il avait entendue douze ans auparavant; et cependant sa conviction s’affermissait. «C’est elle, pensa-t-il. Le doute n’est plus possible.»
La femme continua de parler.
—Je me trompe peut-être. Vous devez être célibataire. Je ne vois pas votre alliance.
Et elle regardait en souriant les mains que l’Espagnol avait posées sur la table. Mais une chose semblait la préoccuper beaucoup plus que l’état civil du monsieur qui l’avait suivie. Elle tourna la tête avec anxiété vers le comptoir où le garçon attendait qu’elle l’appelât.
—Puis-je prendre quelque chose, demanda-{333}t-elle. Je vous avertis que le whisky qu’on boit ici est admirable. On n’en trouve pas de meilleur dans tout Paris.
Voyant que Robledo approuvait d’un mouvement de tête, le garçon s’approcha et, sans besoin de demander ce que désirait la cliente, il apporta de sa propre initiative une bouteille de whisky et deux verres qu’il emplit. Il s’éloigna ensuite non sans avoir lancé à Robledo un regard et un sourire qui rappelaient ceux de la patronne de l’établissement.
La femme but avidement son verre et, voyant que l’autre ne touchait pas au sien, elle le regarda d’un air suppliant.
—Avant la guerre le whisky était très bon marché, mais maintenant! Il n’y a que les rois et les millionnaires qui peuvent en boire. Vous permettez?
Robledo lui fit signe qu’il lui abandonnait sa part et elle se hâta de profiter de la permission.
La liqueur sembla dissiper une sorte d’engourdissement mental qu’on devinait à la lenteur de ses paroles, rendit un nouvel éclat à ses yeux et une agilité plus grande à sa langue. Elle cessa de parler français et lui demanda en espagnol:
—D’où êtes-vous? J’ai compris à votre accent que vous étiez Américain... Américain du Sud. De Buenos-Ayres, peut-être?
Robledo secoua la tête et, sans perdre son sérieux, il lança un mensonge.
—Je suis Mexicain.
—Je connais peu votre pays. Je me suis arrêtée quelques jours seulement à Vera-Cruz entre deux paquebots. Je connais bien l’Argentine; j’y ai vécu il y a bien longtemps... Où n’ai-je pas été? Il n’y a pas de langue que je ne parle. Les messieurs m’apprécient pour cela et beaucoup de mes amies m’envient.
Robledo la regardait fixement. C’était Hélène, il{334} n’en pouvait douter. Et cependant plus rien en elle ne rappelait la femme qu’il avait connue autrefois. Les douze dernières années avaient pesé sur elle plus lourdement que toute une existence banale et calme et avaient précipité sa décadence.
S’il l’avait reconnue, c’était que depuis des années il vivait dans la même solitude monotone et que rien n’avait troublé sa mémoire du passé. Par contre elle avait tant vécu, elle avait tant connu d’hommes, qu’elle ne pouvait se souvenir de l’Espagnol. D’ailleurs, l’ingénieur aussi avait changé de visage en vieillissant.
Cependant, par une sorte d’instinct professionnel, elle sentit que cet homme l’avait déjà approchée. Ses sens de femme de proie et de femelle poursuivie, obligée de se défendre et de vivre en perpétuelle alerte, semblèrent lui venir en aide.
—Je crois bien, dit-elle, que nous nous sommes déjà vus, mais j’ai beau chercher, je ne puis me rappeler à quel endroit. J’ai parcouru tant de pays!... J’ai connu tant d’hommes.{335}
Robledo, le regard sévère, lui demanda avec brusquerie:
—Comment vous appelez-vous?
Les yeux fixés sur le whisky, elle pensait à autre chose et elle répondit distraitement:
—Je m’appelle Blanche, d’autres m’appellent «la marquise». Me permettez-vous de prendre encore un verre?... Tout à l’heure, chez moi, nous n’aurons pas de bouteille pareille. Je suppose que nous irons chez moi... C’est tout près... Cependant, si vous préférez l’hôtel...
Le regard impassible de l’homme lui parut une approbation et elle se hâta de se verser un troisième verre, qu’elle dégusta en le soulevant dans sa main tremblante. Robledo l’interrompit en disant d’une voix lente:
—Vous vous appelez Hélène et si on vous appelle «la marquise» c’est parce que quelqu’un vous a connue mariée à un marquis italien.
La surprise de la femme fut telle qu’elle écarta{336} ses lèvres de la liqueur et regarda Robledo avec des yeux démesurément ouverts.
—Dès que vous avez commencé de parler, j’ai senti que vous me connaissiez.
Machinalement elle posa le verre sur la table.
Puis, regrettant son geste, elle le reprit et le vida d’un trait.
—Mais vous, qui êtes-vous?... Qui es-tu?... Qui es-tu donc?
En formulant la première question elle s’était approchée de Robledo, qui se rejeta en arrière pour éviter son contact. Elle répéta sa demande en portant ses mains à ses tempes comme si elle faisait un douloureux effort de mémoire. Elle dit enfin, découragée:
—Tant d’hommes ont passé dans ma vie!
Ses yeux reflétèrent une inquiétude, puis la crainte, et à son tour elle se rejeta en arrière, comme une bête effrayée. Elle semblait avoir pris peur de l’homme assis en face d’elle.
—Oui, je vous reconnais, murmura-t-elle. Oui, c’est bien vous; vous avez changé, mais c’est bien vous. Je ne vous aurais jamais reconnu si vous n’aviez pas rappelé le passé.
Elle parut retrouver sa volonté et son énergie, et elle regarda longuement son compagnon, sans ressentir de crainte.
Puis elle ajouta d’une voix farouche:
—Il aurait mieux valu ne jamais nous revoir.
Tous deux demeurèrent longtemps muets. Hélène semblait avoir oublié la bouteille que ses doigts continuaient machinalement à caresser. La curiosité de l’Espagnol rompit ce silence.
—Qu’est devenu Moreno?
Elle l’écouta d’un air étonné et parut ne pas le comprendre.{337}
On devinait à ses yeux qu’elle accomplissait un effort de pensée qui la troublait toute.
«Moreno? Qui était donc ce Moreno? Elle avait connu tant d’hommes!»
Elle se versa un autre verre comme si le whisky eût été son remède et but avidement; alors un sourire éclaira vaguement ses traits.
—Je sais maintenant de qui vous parlez... Moreno; c’était un pauvre homme, un égaré. Je ne sais rien de lui.
Robledo la pressa de questions, mais Hélène ne put retrouver dans sa mémoire une image claire et arrêtée du disparu.
—Je crois qu’il est mort. Il est parti dans son pays et il a dû mourir là-bas. Vous dites qu’il n’est jamais revenu?... Alors, il est sans doute mort ici. Peut-être s’est-il tué? Je ne sais plus... S’il fallait que je me rappelle l’histoire de tous les hommes que j’ai connus, je serais folle depuis longtemps! Elles ne tiendraient pas dans ma tête.
Robledo continua sa rigoureuse enquête.
—Et la fille de Pirovani?
Elle porta une autre fois ses mains à ses tempes et plongea ses doigts dans les fausses boucles de sa toison outrageusement blonde. En même temps une moue convulsive, qui trahissait le violent travail de son esprit, sépara un moment les deux rangées de ses dents, d’une blancheur également outrageuse.
—Pirovani?... Ah! oui. Cet Italien qui vivait à Rio Negro et que Moreno a volé... Je ne sais pas; je crois que nous n’avons plus jamais parlé de sa fille. Moreno dépensait sans compter et je lui apprenais les plaisirs de la vie. Pauvre fou!
Elle se tut et s’affaissa sur son siège, la tête basse. Elle semblait maintenant plus petite. Quand elle levait les yeux, elle rencontrait le regard sévère de{338} l’Espagnol; elle les baissait encore et les fixait sur la bouteille.
Ils avaient à nouveau cessé de parler. Robledo songeait: «Et dire que c’est pour cette loque que deux hommes se sont tués, que tant de femmes ont pleuré et que j’ai souffert d’horribles angoisses!»
Hélène parut deviner sa pensée et dit humblement:
—Vous ne savez pas combien ces dernières années furent terribles pour moi... La guerre venue, on s’est acharné à me poursuivre; on m’a interdit de vivre à Paris. On me soupçonnait, on me prenait pour une espionne, pour une Allemande, car chacun m’attribuait une nationalité différente. J’ai parcouru l’Italie, et bien d’autres pays. Je suis même allée dans votre patrie; car vous êtes bien Espagnol? Ne vous étonnez pas de ma question, je ne sais plus me rappeler tant de choses!... En rentrant à Paris, je n’ai retrouvé aucune des personnes de mon temps, absolument aucune. Le monde d’avant la guerre était un autre monde. Tous ceux que j’ai connus sont morts ou sont partis bien loin. Parfois il me semble que je suis tombée dans une autre planète. Quelle solitude!
Elle semblait accablée sous ce monde nouveau, qu’elle ne pouvait comprendre.
—Je trouve enfin sur ma route un homme qui me rappelle ma vie d’autrefois... et il faut que ce soit vous! Il aurait mieux valu ne jamais nous revoir!
Puis elle ajouta comme pour elle-même:
—Cette rencontre va me faire penser à bien des choses que ma mémoire n’aurait plus retrouvées... Pourquoi êtes-vous revenu de si loin? Pourquoi avez-vous eu l’idée de vous promener dans cette partie de Montmartre où les étrangers riches ne passent jamais? Oh! le hasard maudit!{339}
Soudain elle se dressa, un éclair bleu dans les pupilles.
—Laissez-moi boire. Comme je vous serais reconnaissante si vous m’offriez la bouteille entière! Il me la faut après cette maudite rencontre qui va ressusciter tant de choses... J’aime la vie par-dessus tout. Je ne crains ni les malheurs ni la misère pourvu que je continue à vivre... Mais j’ai peur des souvenirs et le whisky les tue ou les déguise en pensées agréables. Laissez-moi boire... ne dites pas non.
Comme Robledo gardait le silence, Hélène saisit la bouteille et remplit son verre qu’elle vida avec une lenteur voluptueuse. Tout en buvant elle indiqua de l’œil la triste fillette qui continuait à fumer et à tousser.
—Celle-là suit la mode d’aujourd’hui: morphine, cocaïne et cætera... Moi je reste de mon temps, de la vieille époque. Ces drogues me rendent malade. Je ne crois qu’aux moyens classiques.
Et elle caressa d’une main amoureuse les contours de la bouteille. Une clarté étrange, que la liqueur rendait de plus en plus intense, apparaissait sur son visage. Maintenant que le whisky était à elle, elle désirait être seule pour le déguster à loisir.
—Partez, dit-elle à Robledo, et oubliez-moi. Si vous voulez me donner quelque chose, je vous remercierai; si vous ne me donnez rien je me contenterai de la bouteille, c’est un cadeau de prince... Partez, Robledo, votre place n’est pas ici.
Mais il ne bougeait pas; il voulait ranimer sa mémoire et sonder encore son passé mystérieux.
—Et Canterac?... Avez-vous jamais rencontré le capitaine Canterac?
Ce nom semblait pour elle plus lointain encore que les autres.
Robledo lui rappela, pour l’aider, le parc artifi{340}ciel improvisé en son honneur sur les bords du Rio Negro.
—Oui, cette fête avait du chic. D’autres hommes ont fait pour moi des choses plus coûteuses, mais cela, c’était original!... Pauvre capitaine! Je l’ai rencontré souvent depuis; je crois qu’il est maintenant général. Comment dites-vous qu’il se nommait?
Et elle continua d’évoquer des souvenirs; mais l’Espagnol se rendit compte qu’elle confondait Canterac avec un autre officier de ses amis et fondait en une seule personne deux hommes qu’elle avait connus à des moments distincts de sa vie.
Robledo était sûr que Canterac était mort. Quand la guerre avait éclaté il errait dans les républiques du Pacifique et changeait souvent de métier, passant des salpêtrières du Chili aux mines de la Bolivie et du Pérou. Il était rentré en France pour rejoindre l’armée et il était mort à Verdun comme tant d’autres héros obscurs. Mais cette femme, qui avait si affreusement troublé sa vie, n’avait même pas gardé de lui une image précise. Elle avait oublié son nom, quand Robledo le répéta.
Pourtant les questions renouvelées de l’Espagnol allèrent fouiller dans sa mémoire et la torpeur finit par céder; alors les souvenirs l’assaillirent en foule. Ce fut elle qui demanda soudain:
—Comment s’appelait ce jeune Américain, votre associé?... Je crois que c’est le seul homme qui m’ait un peu intéressée parmi tous ceux qui me poursuivaient... Peut-être l’ai-je aimé, justement parce qu’il ne m’a jamais désirée vraiment. Je me suis quelquefois souvenue de lui... de loin en loin... il s’est marié?
Robledo fit un signe affirmatif et elle continua:
—Ne me parlez plus. Quand je vous regarde, il me semble que les années écoulées défilent à rebours devant moi et peu à peu je me rappelle tout... Ce{341} jeune homme s’appelait Richard; sans doute a-t-il épousé cette fille de la Pampa à qui on avait donné le nom d’une fleur.
Ces souvenirs, les seuls à surgir distincts et vivaces dans sa mémoire, lui faisaient goûter l’amère tristesse qu’inspire aux déchus le bonheur d’autrui.
Elle se contempla avec une pitié méprisante comme si elle se voyait pour la première fois. Elle s’était crue le centre de l’univers; maintenant elle avait roulé jusqu’aux bas-fonds et elle pressentait de nouveaux abîmes où elle tomberait encore, car le malheur n’a jamais de fin.
D’autres pouvaient évoquer leur passé avec une douce mélancolie. C’était pour eux un plaisir comparable à celui que nous donne une tendre musique ancienne, ou le parfum d’un bouquet de fleurs fanées.
Ses souvenirs à elle mordaient comme des loups furieux et la poursuivraient jusqu’à la mort. C’est pour cela qu’elle avait besoin de vivre dans une inconscience de bête et d’assassiner chaque jour ses pensées avec de l’alcool.
Elle voulut exprimer tout son désespoir et, montrant l’autre femme qui, à moitié ivre, sommeillait sur le divan:
—Voilà comme je serai, bientôt.
Sur son visage parut passer l’ombre de la dernière heure, et, baissant les yeux, elle ajouta:
—Et puis, la mort.
Robledo demeura silencieux. Il avait sorti en cachette son portefeuille d’une poche intérieure et il comptait des papiers sous la table. Elle continuait à parler dans un murmure sans se rendre compte qu’elle dévoilait ses pensées les plus intimes.
—Peut-être alors un journaliste consacrera-t-il quelques lignes à celle qu’on appelait «la marquise» et peut-être dans le monde quelques douzai{342}nes de personnes se souviendront-elles de moi. Et encore!... Peut-être resterai-je pour toujours au fond du fleuve. Mais, aurai-je ce courage?
Robledo chercha sa main sous la table et lui remit un rouleau de petits papiers.
—Je ne devrais pas le prendre, dit la femme; je n’accepte d’argent que des gens qui ne me connaissent pas.
Mais elle cacha dans sa poitrine les billets de banque. Ses yeux soudain joyeux démentaient les paroles qu’elle avait prononcées sur un ton de dignité résignée pour s’excuser d’accepter le don.
Robledo la regardait maintenant avec pitié. Pauvre «Belle Hélène»! Elle était passée dans la vie comme passent sur les mers australes les grands albatros, qui, fiers de la force de leurs ailes blanches, s’abattent avec une voracité implacable sur la proie découverte au milieu des vagues et qui croient que tout dans le monde a été créé pour leur servir de pâture. Aigle de l’Atlantique majestueux et farouche, elle avait eu le parfum salin de l’immensité et la chair dure des êtres forts. Mais les années en passant avaient dissipé l’illusion orgueilleuse de la jeunesse, prompte à se croire immortelle, et maintenant le fier oiseau de l’azur infini était forcé de chercher son aliment parmi les débris que l’Océan crache sur la côte. Quand le froid et les ténèbres le poussaient, cet aigle, vers la lumière, ses ailes défaillantes venaient heurter les vitres gardiennes du feu. Il courait à la fenêtre où semblait briller la flamme hospitalière du foyer, et il se cognait à la lanterne du phare, insensible et dure comme un mur afin d’affronter la rage des tempêtes.
Un jour, un de ces heurts lui briserait à jamais les ailes et l’océan de la vie engloutirait son corps comme il avait précédemment, avec la même indif{343}férence, happé toutes les victimes de l’oiseau de proie.
Et, entraîné par son image, Robledo se vit lui-même, ainsi que ses amis, sous une forme animale. Ils étaient des bœufs bien nourris, calmes et bons comme les bêtes grasses qui paissaient dans les champs humides et fertiles de leur colonie. Ils avaient les solides vertus de ceux qui voient leur existence assurée, à l’abri de tout risque, et qui n’ont pas besoin pour vivre de faire le malheur des autres... Ils continueraient à vivre ainsi, tranquilles, privés de joies violentes, mais exempts de douleurs, jusqu’à leur dernière heure.
Qui avait le mieux vécu sa vie? Etait-ce cette femme à la biographie fabuleuse qui ne pouvait exactement se rappeler son origine ni ses aventures comme si son cerveau humain eût été incapable de contenir son histoire aussi vaste qu’un monde? ou bien eux, qui ruminaient honnêtement leur bonheur après avoir fini leur tâche sur la terre?
Il n’eut pas le loisir de réfléchir plus longtemps. Le garçon du bar, qu’un individu venait d’appeler, était sorti dans la rue. Il rentra, l’air inquiet, et dit quelques mots à voix basse à la patronne.
—Envolez-vous, mes colombes! cria de son comptoir la mégère en s’adressant aux deux clientes les plus proches.
Elle expliqua que la police était en train de faire une rafle de femmes dans le quartier et qu’elle viendrait peut-être visiter son établissement. Un ami fidèle venait de l’avertir.
La fillette phtisique jeta sa cigarette et s’enfuit. Elle tremblait de peur et sa toux en devenait plus effrayante encore. La femme ivre ouvrit les yeux pour regarder autour d’elle et les referma en murmurant:{344}
—Qu’ils viennent! Au violon on dort aussi bien qu’ici.
Hélène se hâta de fuir. Elle avait peur; cependant, elle prit soin de gagner la porte avec une certaine dignité, parce qu’un homme était derrière elle. Elle ne voulait pas qu’on la confondît avec les autres.
Demeuré seul, l’Espagnol tendit un billet au garçon pour payer la bouteille et sortit sans attendre la monnaie. Une fois sur le boulevard il regarda vainement de tous côtés. Hélène avait disparu.
Il ne la reverrait plus. Quand elle mourrait, il ne recevrait pas la nouvelle de sa mort. Jusqu’à la fin de ses jours il ne saurait jamais de façon certaine si l’autre vivait encore. Mais, après l’avoir rencontrée, il devinait quelle serait sa fin. Elle était de celles qui quittent la vie tragiquement, mais sans fracas, sans que leur nom soit prononcé, car elles ont survécu des années durant à leur histoire morte.
—Et c’est là cette Hélène, se dit-il, qui, semblable à celle dont parle le vieux poète, a déchaîné la guerre entre les hommes dans un coin de la terre.
Indécis, il se demandait encore si cette femme avait été vraiment mauvaise et pleinement responsable de sa perversité... Dans sa quête avide des plaisirs de la vie avait-elle marché, inconsciente, sans voir ce qu’elle écrasait sous ses pieds?
Tout en cherchant une voiture il conclut:
«Il aurait mieux valu pour elle qu’elle fût morte douze ans plus tôt... Pourquoi vit-elle encore?»
Il sourit avec tristesse en pensant à la relativité dès valeurs humaines; comme l’importance d’un être dépendait du milieu où il était jeté!
«Cette loque a été semblable à l’héroïne d’Homère dans un pays à demi sauvage où on connaît très peu de femmes! Que diraient maintenant ceux qui{345} ont fait tant de folies pour elle, s’ils la voyaient telle que je viens de la voir?»
Quand il arriva à l’hôtel, Watson et sa femme venaient de rentrer de leur promenade.
Deux domestiques portaient derrière Celinda d’énormes paquets: les achats de l’après-midi.
Watson regarda sa montre avec impatience.
—Il est près de sept heures et nous devons nous habiller et dîner avant d’aller à l’Opéra... Quand les femmes se mettent à acheter des robes et des chapeaux, elles n’en finissent plus.
Avec des mines gracieuses, Celinda calma l’indignation qu’affectait son mari. Elle l’embrassa à la fin. Puis elle entra dans la pièce voisine pour changer de robe.
Watson demanda à Robledo s’il comptait les accompagner à l’Opéra.
—Non; je me fais vieux et je n’ai pas envie de mettre un habit et des gants blancs pour aller entendre de la musique. J’aime mieux rester à l’hôtel. J’assisterai au coucher de Carlitos... Je lui ai promis une histoire.
Une indécision lui causait une gêne intérieure. Devait-il raconter à Celinda et à son mari sa rencontre de l’après-midi? N’était-il pas plus prudent d’en parler seulement à Watson?
Dans leurs conversations ils avaient rarement fait mention de la femme de Torrebianca. Celinda, ordinairement si heureuse et si gaie, fronçait le sourcil d’un air hostile quand on prononçait devant elle le nom de la marquise.
Peut-être éprouverait-elle une joie cruelle en apprenant dans quelle abjection l’autre était tombée? Mais Robledo repoussa cette supposition. Celinda, en plein bonheur, eût répugné à se venger et son récit ne ferait que réveiller la tristesse de souvenirs mauvais.{346}
«Pourquoi ressusciter le passé?... Que la vie continue!»
Et il ne songea plus qu’à imaginer, pour la conter à son prince héritier, une merveilleuse histoire.
FIN
E. GREVIN—IMPRIMERIE DE LAGNY—1799-11 23
NOTES:
[1] Voir le livre de Camille Pitollet: «V. Blasco Ibañez, ses romans et le roman de sa vie», Calmann-Lévy, éditeurs.
[2] Sorte de manteau en forme de chasuble.
[3] Nom que l’on donne, en Argentine, aux habitants de la campagne qui vivent en général d’élevage.
[4] Établissement de culture et d’élevage.
[5] Journaliers, gardiens de troupeaux.
[6] Nom qu’on donne, en Argentine, aux descendants de familles fixées depuis longtemps dans le pays.
[7] Propriétaire d’une estancia.
[8] Nom qu’on donne, en Argentine, aux étrangers établis dans le pays.
[9] Diminutif de gringo.
[10] Les Argentins appellent gallegos (galiciens), les Espagnols établis en Argentine. Les Galiciens ont, en Espagne même, la réputation d’être un peu lourdauds.
[11] Litt. «mains dures».
[12] Nom qu’on donne en Espagne à la plaine fertile de Valence.
[13] Vastes maisons des quartiers pauvres de Buenos-Ayres.
[14] Sorte de sabre court en usage au Mexique et autres pays américains.
[15] Juron argentin.
[16] Monnaie argentine qui vaut 5 francs.
[17] Centième de peso.
[18] Le moine.
[19] Chilien.
[20] Surnom familier qu’on donne aux gens du peuple au Chili. Littéralement: déchiré. Allusion aux haillons dont le bas peuple est habillé.
[21] Petite patronne.
[22] Petit établissement d’élevage.
[23] Descendants d’animaux nés dans le pays.
[24] Don. placé devant le nom de famille, est incorrect. On ne doit le placer que devant le prénom. Ex.: don Manuel Robledo.
[25] Le malicieux.
[26] Le mot chapeton (maladroit), comme le mot gringo, s’applique aux étrangers établis en Argentine.
[27] La ficelle.
[28] Littéralement petites chinoises. Nom qu’on applique aux jeunes filles du pays.
End of the Project Gutenberg EBook of La tentatrice, by Vicente Blasco Ibáñez
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LA TENTATRICE ***
***** This file should be named 63284-h.htm or 63284-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/6/3/2/8/63284/
Produced by Chuck Greif and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was
produced from images at Bibliothèque nationale de France
(BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.